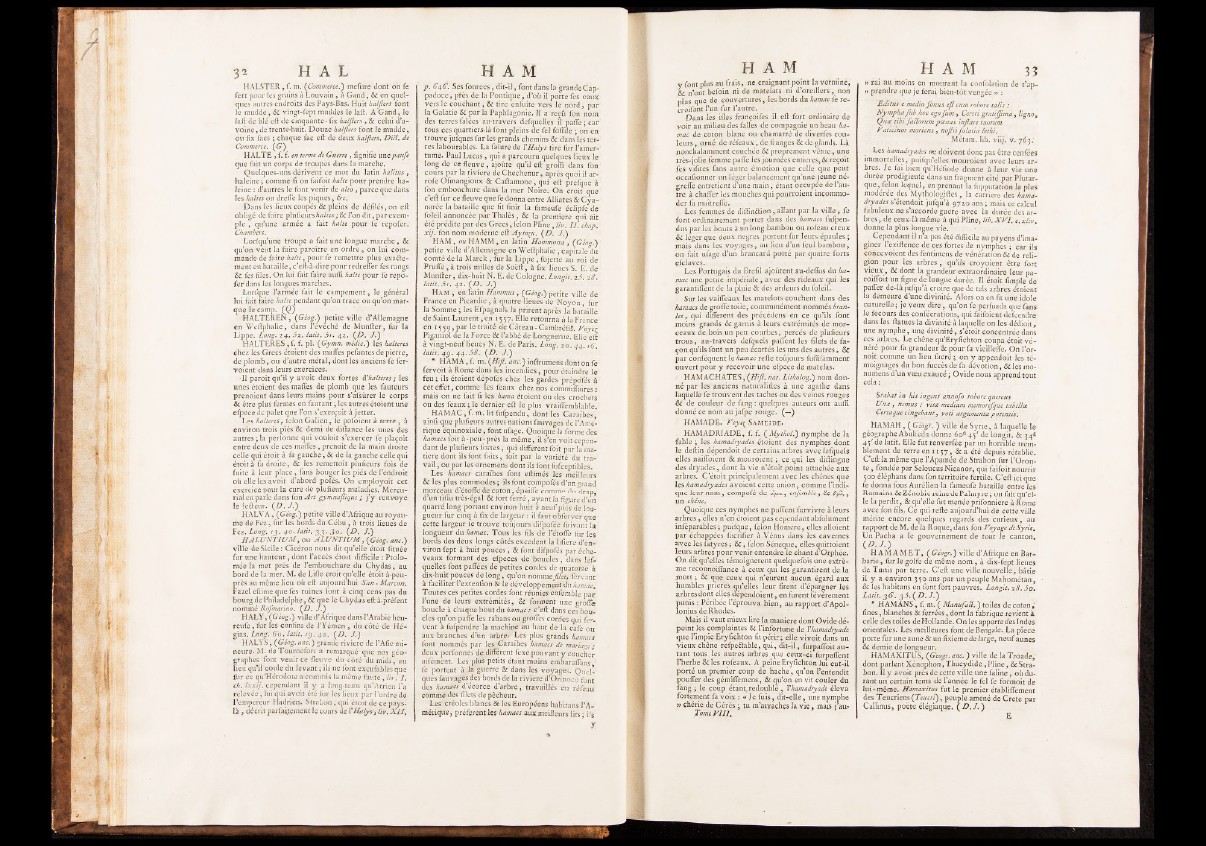
3* H A L HALSTER, f. m. {Comment.') mefure dont on fe
fert pour les grains à Louvain, à Gand, 8c en quelques
autres endroits des Pays-Bas. Huit halfiers font
Je mudde, 8c vingt-fept muddes le laft. A Gand, le
laft de blé eft de cinquante - fix haljlers, & celui d’avoine
, de trente-huit. Douze halfitrs font le mudde,
ou fix facs ; chaque fac eft Comment. (G) de deux halfitrs. Dict. dt
'HALTE , f. f. en terme de Guerre, lignifie unepaufe
que fait un corps de troupes dans la marche.
Quelques-uns dérivent ce mot du latin halitus,
haleine ; comme fi on faifoit halte pour prendre haleine
: d’autres le font venir de alto, parce que dans
les haltes on dreffe les piques, &c.
Dans les lieux coupés 8c pleins de défilés, on eft
obligé de faire plufieurs haltes ; 8c l’on dit, par exemple
, qu’une armée a fait halte pour fe repofer.
Chambers.
Lorlqu’une troupe a fait une longue marche, &
qu’on veut la faire paroître en ordre, on lui commande
de faire halte, pour fe remettre plus exactement
en bataille, c’eft-à-dire pour redreffer fes rangs
8c fes files. On lui fait faire auffi halte pour fe repo-
fer'dans les longues marches.
Lorfque l’armée fait le campement, le général
lui fait faire halte pendant qu’on trace ou qu’on marque
le camp. (Q)
HALTEREN, (Géog.) petite ville d’Allemagne
en Weftphalie, dans l’évêché de Munfter, fur la
Lippe. Long. 24. Sx. latit. Si. 42. (JD. J.)
HALTERES , f . f. pl. (Gymn. médic.) les haltères
chez les Grecs étoient des maffes pefantes de pierre,
de plomb, ou d’autre métal, dont les anciens fe fer-
voient dans leurs exercices.
•II paroît qu’il y avoit deux fortes d'haltères; les
unes étoient des maffes de plomb que les fauteurs
prenoient dans leurs mains pour s’afsûrer le corps
& être plus fermes en fautant ; les autres étoient ime
efpece de palet que l’on s’exerçoit à jetter.
Les haltères, félon G alien, le pofoient à terre, à
environ trois piés 8c demi de diftance les unes des
autres ; la perfonne qui vouloit s’exercer fe plaçoit
entre deux de ces maffes , prenoit de la main droite
celle qui étoit à fa gauche, & de la gauche celle qui
étoit à fa droite, 8c les remettoit plufieurs fois de
fuite à leur place, fans bouger les piés de l’endroit
où elle les avoit d’abord pofés. On employoit cet
exercice pour la cure de plufieurs maladies. Mercu-
rial en parle dans (on Art gymnafiique ; j’y renvoyé
le lefteur. (JD. J.)
HA LVA, ( Géog.) petite ville d’Afrique au royaume
de Fez, fur les bords du Cébu , à trois lieues de
Fez. Long. 13. 40. latit. 3 3 . 30. (JD. J.)
HA LUNTIUM, ou ALUNTIUM, (Géog. anc.)
ville de Sicile : Cicéron nous dit qu’elle étoit fituée
fur une hauteur, dont l’accès étoit difficile : Ptolo-
mée la met près de l’embouchure du Chydas, au
bord de la mer. M. de Lifte croit qu’elle étoit à-peu-
près au même lieu où eft aujourd’hui San- Marcon.
Fazel eftime que fes ruines font à cinq cens pas du
bourg de Philadelphe, 8c que le Chydas eft à-préfent
nommé Rofmarino. (D . J.)
HALY, (Géog.) ville d’Afrique dans l’Arabie heu-
reufe, fur les confins de l’Yémen , du côté de Hé-
gias. Long. 60. latit. 13. 40. (D . J.)
HALYS, (Géog. anc.) grande riviere de l’Afie mineure.
M. deTournefort a remarqué que nos géographes
font venir ce fleuve du côté du midi, au
lieu qu’il coule du levant ; ils ne font excufables que
fur ce qu’Hérodote a commis la même faute, liv. 1.
ch. lx x ij.e e pendant il y a long-tems qu’Arrien l’a
relevée, lui qui avoit été fur les lieux par l ’ordre de
l ’empereur Hadrien. Strabon, qui étoit de ce pays-
là , décrit parfaitement le cours de YHalys, liv. X I I ,
H A M p. C4S. Ses fources, dit-il, font dans la gfandeCàp*
padoce, pf ès de la Pontiaue, d’où il porte fes eau*
vers le couchant, 8c tire enfuite vers le nord, par
la Galatie 8c par la Paphlagonie. Il a reçu fon nom
dés terres falées au-travers defquelles il paffe ; car
tous ces quartiers-là font pleins de fel foffile ; on en
trouve jufques fur les grands chemins 8c dans les terres
labourables. La falure de YHalys tire fur l’amertume.
Paul Lucas, qui a parcouru quelques lieux le
long de ce fleu ve, ajoute qu’il eft grofli dans fon
cours par la riviere deChechenur, après quoi il ar-
rofe Ofmangioux & Caftamone, qui eft prefque à
fon embouchure dans la mer Noire. On croit que
c’eft fur ce fleuve quefe donna entre Alliâtes & Ç ya-
narée la bataille que fit finir la fameufe éclipfe de
foleil annoncée parThalès, 8c la première qui ait
été prédite par des Grecs, félon Pline, liv. II. chap.
xij. fon nom moderne eft Ayto[u. (D . J.)
HAM , ou HAMM, en latin Hammona , (Géog.)
petite ville d’Allemagne en Weftphalie, capitale du
comté de la Marck, fur la Lippe, fujette au roi de
Pruffe, à trois milles de Soëft, à fix lieues S. E. de
Munfter, dix-huit N. E. de Cologne. Longit. xS;x8.
latit. Si. 42. (D . J.)
H AM , en latin Hammus »-(Géog.) petite ville de
France en Picardie , à quatre lieues de Noyon, fur
la Somme ; les Efpagnôls la prirent après la bataille
de Saint-Laurent, en 1557. Elle retourna à la France
en 15 5 9 ,par le traité de Câtèau-GambrélîS. Foyer
Piganiol de la Force & l’abbé de Longuerue. Elle eft
à vingt-neuf lieues N. E. de Paris. Long. xo . 4 4 .16
latit. '4$. 4 4 .58. (D . J.)
* HAMA, fi m. (Hifi. anc.) inftrumens dont on fe
fervoit à Rome dans les incendies, pour éteindre le
feu ; ils étoient dépofés chez les gardes prépo’fés à
cet effet, comme les féaux chez nos commiffaires :
mais on ne fait fi les hama étoient ou des crochets
ou des féaux ; le dernier eft le plus vraiffemblable.
HAMAC , f. m. lit fufperidu, dont les Caraïbes,
ainfi que plufieurs autres nations fauvages de l’Amérique
équinoxiale, font ufage. Quoique la forme des
hamacs foit à-peu-près la même, il s’en voit cependant
de plufieurs fortes, qui different foit par la matière
dont ils font faits, foit par la yariété du travail
, ou par les ornemens dont ils font fufceptibles.
Les hamacs caraïbes font eftimés les meilleurs
8c les plus commodes; ils font compôfés d’un grand
morceau d’étoffe de coton, épaiffe comme du drap,
d’un tiffu très-égal 8c fort ferré, ayant la figure d’un
quarré long portant environ huit à neuf piés de longueur
fur cinq à fix de largeur : il faut obferver que
cette largeur fe trouve toujours difpofée fuivant la
longueur du hamac. Tous les- fils de Fétoffe fur les
bprds des deux longs côtés excédent la lifiere d’environ
fept à huit pouces, & font difpofés par éche-
veaux formant des efpeces de boucles, dans léf-
quelles font paffées de petites cordes de quatorze à
dix-huit pouces de long, qu’on nomme filet, fervant
à faciliter l’extenfion & le développement du hamacI
Toutes ces petites cordes font réunies enfemble par
l’une de leurs extrémités, & forment une groffe
boucle à chaque bout du hàtnac : c ’eft dans ces boucles
qu’on paffe lès.rabans ou groffes cordes qui fervent
à fufpendre la machine au haut de la café ou
aux branches d'un arbre. Les plus grands hamacs
font nommés par les Caraïbes hamacs de mariage *
deux perfonnes de différent fexe pouvant y coucher
aifément. Les plus petits étant moins embaraffans '
fe portent à .la'guerre & dans les voyages. Quelques
fauvagés des bords de la riviere d’Orinoco font
des hamacs d’écorce d’arbre, travaillés en refeau
comme des filets de pêcheur.
Les créoles blancs & les Européens habitans l’Amérique,
préfçrentles hamacs aux meilleurs lits ; iis
y,
H A M
y font plus au frais, ne craignant point la vermine,
& n’ont befoin ni de matelats ni d’oreillers, non
plus que de couvertures, les bords du hamac fe re-
croifant l’un fur l’autre.
Dans les ifles françoifes il eft fort ordinaire de
voir au milieu des falles de compagnie un beau hamac
de coton blanc ou chamarré de diverfes couleurs
, orné de réfeaux, de franges 8c de. glands. Là
nonchalamment couchée 8c proprement vêtue, une
très-jolie femme paffe les journées entières, & reçoit
fes vifites fans autre émotion que celle que peut
occafionner un léger balancement qu’une jeune né-
greffe entretient d’une main, étant occupée de l ’autre
à chaffer les mouches qui pourroient incommoder
fa maîtreffe.
Les femmes de diftin&ion, allant par la v ille , fe
font ordinairement porter dans des hamacs fufpen-
dus par les bouts à un long bambou ou rofeau creux
& léger que deux negres portent fur leurs épaules ;
mais dans les voyages, au lieu d’un feul bambou,
on fait ufage d’un brancard porté par quatre forts
efclaves. ..
Les Portugais du Brefil ajoutent au-deffus du hamac
une petite impériale, avec des rideaux qui les
garantiffent de la pluie & des ardeurs du foleil.
Sur les vaiffeaux les matelots couchent dans des
hamacs de groffe toile, communément nommés branles,
qui different des précédens en ce qu’ils font
moins grands & garnis à leurs extrémités de morceaux
de,bois un peu courbes, percés de plufieurs
trous, au-travers defquels paffent les filets de façon
qu’ils font un peu écartés les uns des autres, &
par conféquent le hamac refte toûjours fuffifamment
ouvert pour y recevoir une efpece de matelas.
HAMACHATES, (Hifi. nat. Litholog.) nom donné
par les anciens naturaliftes à une agathe dans
laquelle fe trouvent des taches ou des veines rouges
8c de couleur de fang : quelques auteurs ont auffi
donné ce nom au jafpe rouge. (—)
HAMADE. Foye^ Sameid e.
HAMADRIÀDE, f. f. (Mythol.) nymphe de la
fable ; les hamadryades étoient des nymphes dont
le deftin dépendoit de certains arbres avec lefquels
elles naiffoient & mouroient ; ce qui les diftingue
des dryades, dont la v ie n’étoit point attachée aux
arbres. C ’étoit principalement avec les chênes que
les hamadryades avoient cette union, comme l’indique
leur nom , compofé de «/**, enfemble , 8c S'pvç,
un chêne,
. Quoique ces nymphes ne puffent furvivre à leurs
arbres , elles n’en étoient pas cependant abfolument
inféparables ; puifque, félon Homere, elles alloient
par échappées facrifier à Vénus dans les cavernes
avec les iatyres ; 8c, félon Séneque, elles quittoîent
leurs arbres pour venir entendre le chant d’Orphée.
On dit qu’elles témoignèrent quelquefois une extrême
reconnoiffance à ceux qui les garantirent de la
mort ; 8c que ceux qui n’eurent aucun égard aux
humbles prières qu’elles leur firent d’épargner les
arbres dont elles dépendoient, en furent fé vérement
punis : Péribée l’éprouva bien, au rapport d’Apollonius
de Rhodes.
Mais il vaut mieux lire la maniéré dont O vide dépeint
les complaintes 8c l’infortune de Yliamadryade
que l’impie Eryfichton fit périr; elle vivoit dans un
vieux chêne refpe&able, qui, dit-il, furpaffoit autant
tous les autres arbres que ceux-ci furpaffent
l’herbe 8c les rofeaux. A peine Eryfichton lui eut-il
porté un premier coup de hache, qu’on l’entendit
pouffer des gémiffemens, 8c qu’on en vit couler du
fang ; le coup étant, redoublé , Yhamadryade éleva
fortement fa voix : « Je fuis, dit-elle, une nymphe
» chérie de Cérès ; tu m’arraches la v ie , mais j’au-
Tome V IH,
H A M 33
« rai au moins en mourant la confolation de t’ap-
» prendre que je ferai bien-tôt vengée » :
Ediitis e medio fonus efl curn robore talis ;
Nympha fub hoc ego fum » Cereri gratifiima , ligno,
Qu a iibi faclorum pce nas infiare tuorum
Vaticinor moriens , nofiri folatia lethi.
Métam. lib. viij. v. 763.'
Les hamadryades ne doivent donc pas être cenfées
immortelles, puifqu’elles mouroient avec leurs arbres.
Je fai bien qu’Héfiode donne à leur vie une
durée prodigieufe dans un fragment cité par Plutarque,
félon lequel, en prenant la fupputation la plus'
modérée des Mythologiftes, la carrière des /W æ-
dryades s’ëtendoit jufqu’à 9720 ans ; mais ce calcul
fabuleux ne s’accorde guere avec la durée des arbres,
de ceux-là même à qui Pline, lib. X F I . c.xliv.
donne la plus longue vie.
Cependant il n a pas été difficile au payens d’imaginer
l’exiftence de ces fortes de nymphes'; car ils
concevoient des fentimens de vénération 8c de religion
pour les arbres , qu’ils croyoient être fort
v ieu x, 8c dont la grandeur extraordinaire leur pa-
roiffoit un ligne de longue durée. Il étoit fimple de
paffer de-là jufqu’a croire que de tels arbres étoient
la demeure d’une divinité. Alors on en fit une idole
naturelle ; je veux dire, qu’on fe perfuada que fans
le fecours des confécrations, qui faifoient defeendre
dans les ftatues la divinité à laquelle on les dédioit,
une nymphe, une divinité, s’étoit concentrée dans
ces arbres. Le chêne qu’Eryfichton coupa étoit v é-
néré pour fa grandeur 8t pour fa vieilleffe. On l’or-
noit comme un lieu facré ; on y appendoit les témoignages
du bon fuccès de fa dévotion, 8c les mo-
numens d’un voeu exaucé ; Ovide nous apprend tout
cela :
Stabal in lus ingens annofo robore quercus
Una , nemus : vttee mediam memorefque tabellce
Cirtaque cingebant, voti argumenta potentis.
HAMAH, ( Géogr. ) ville de Syrie, à laquelle le
géographe Abulfcda donne 6od 45' de longit. & 34^
4 5 'de latit. Elle fut renverfée par un horrible tremblement
de terre en 1 15 7 , 8c a été depuis rétablie.
C’eft la même que l’Apamée de Strabon fur l’Oron-
t e , fondée par Seleucus Nicanor, qui faifoit nourrir
500 éléphans dans fon territoire fertile. C ’eft ici que
le donna fous Aurélien la fameufe bataille entre les
Romains. 8c Zénobie reine de Palmyre ; on fait qu’elle
la perdit, 8c qu’elle fut menée prifonniere à Rome
avec fon fils. Ce qui refte aujourd’hui de cette ville
mérite encore quelques regards des curieux, au
rapport de M. de la Roque, dans fon Foyage de Syrie.
Un Pacha a le gouvernement de tout le canton.
(■ ».ƒ.)
H A M AM E T , ( Géogr.) ville d’Afrique en Barbarie
, fur lé golfe de même nom, à dix-fept lieues
de Tunis par terre. C ’eft une ville nouvelle, bâtie
il y a environ 3 50 ans par un peuple Mahométan,
8c les habitans en font fort pauvres. Longit. z8. S o.
Latit. 3 6 . 3 5. ( D . J .)
* HAMANS , f. m. ( Manufacl. ) toiles de coton ,
fines, blanches 8c ferrées, dont la fabrique revient à
celle des toiles de Hollande. On les apporte des Indes
orientales. Les meilleures font de Bengale. La piece
porte fur une aune 8c un fixieme de large, neuf aunes
8c demie de longueur.
HAMAXITUS, (Géogr. anc. ) ville de la Troade,’
dont parlent Xénophon, Thucydide , Pline, 8c Strabon.
II y avoit près de cetté ville une faline, où durant
un certain tems de l’année le fel fe formoit de
lui-même. Hàmaxitus fut le premier établiffement
des Teucriens(7 e«cri), peuple amené de Crete par
Callinus, poëte élégiaque. ( D , J . )
E