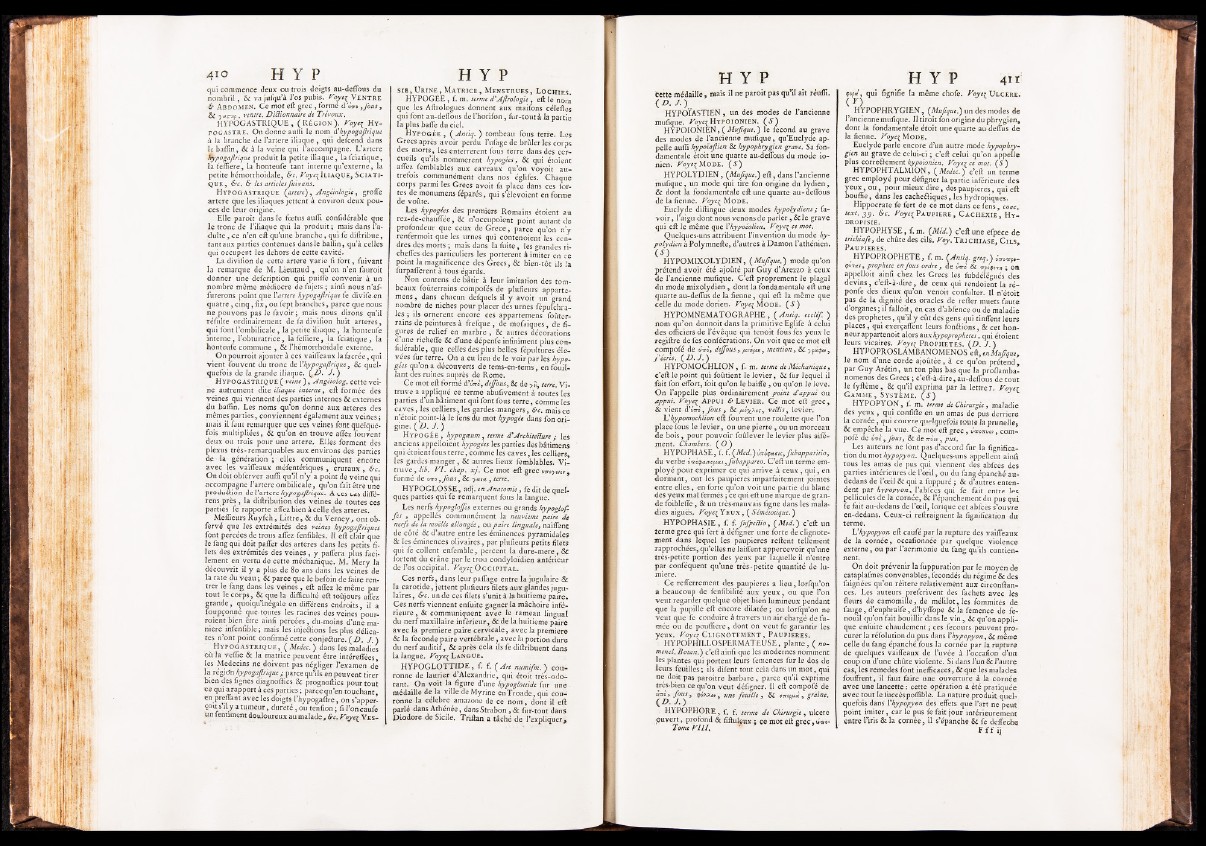
qui commence deux ou trois doigts au-deffous du
nombril, & va jufqu’à l’os pubis. Voye^ Ve n t r e
& Ab d om en . Ce mot eft grec , formé d ’uVo y fous ,
& yctç->tp, ventre. Dictionnaire de Trévoux.
HYPOGASTRIQUE , ( R é g io n ). Voyc{ H y-
POGASTRE. On donne auffi le nom d’hypogafrique
à la branche de l’artere iliaque, qiii defcend dans
le baffin, & à la veine qui l’accompagne. L’artere
iïypogajlrique produit la petite iliaque, la fciatique,
la feflîere, la honteufe tant interne qu’externe, la
petite hémorrhoïdale, &c. Voye[Ilia q u e , Sc ia t iq
u e , &c. & les articles fuivans.
H y po g a s t r iq u e (artere), Angêiologie, groffe
artere que les iliaques jettent à environ deux pouces
de leur origine.
Elle paroît dans le foetus auffi confidérable que
le tronc de l’iliaque qui la produit ; mais dans l’adulte
, ce n’en eft qu’une branche, qui fo diftribue,
tant aux parties contenues dans le baffin, qu’à .celles
qui occupent les dehors de cette cavité.
La divifton de cette artere varie fi fo r t , fuivant
la remarque de M. Lieutaud , qu’on n’en fauroit
donner une defoription qui puifle convenir à un
nombre même médiocre de fujets ; ainfi nous n’af-
furerons point que l’artere hypogajlrique fe divife.en
quatre, c inq, fix, ou fept branches, parce que nous
ne pouvons pas le favoir ; mais nous dirons qu’il
réfulte ordinairement de fa divifion huit arteres,
qui font l’ombilicale, la petite iliaque, la honteufe
interne, l’obturatrice, la feffiere, la fciatique, la
honteufe commune , & l’hémorrhoïdale externe.
Onpourroit ajouter à ces vaifleaux lafacrée, qui
vient Souvent du tronc de l’hypogajlrique, & quelquefois
de la grande iliaque. (^Z>. J. )
H y po g a st r iq u e ( veine'), Angéiolog. cette veine
autrement dite iliaque interne, eft formée des
veines qui viennent des parties internes & externes
du baffin. Les noms qu’on donne aux arteres des
mêmes parties, conviennent également aux veines ;
mais il faut remarquer que ces veines font quelquefois
multipliées, & qu’on en trouve affez fou vent
deux ou trois pour une artere. Elles forment des
plexus très-remarquables aux environs des parties
de la génération ; elles communiquent encore
avec les vaifTeaux méfentériques , cruraux &c.
On doit obforver auffi qu’il n’y a point de veine qui
accompagne l’artere ombilicale, qu’on fait être une
production de l’artere hypogajlrique. A ces cas diffé-
rens près , la diftribution des veines de toutes ces
parties fe rapporte affez bien à celle des arteres.
Meffieurs Ruyfch, Littré, & du V erney, ont ob-
fervé que les extrémités des veines hyppgaflriques
font percées de trous affez fenfibles. Il èft clair que
le fang qui doit palier des arteres dans les petits filets'des
extrémités des veines , y paffera plus facilement
en vertu de cette méchanique. M. Mery la
découvrit il y a plus de 8o ans dans les veines de
la rate du veau ; & parce que le befoin de faire rentrer
le fang dans les veines , eft affez le même par
tout le corps, & que la difficulté eft toûjours affez
grande, quoiqu’inégale en différens endroits, il a
foupçonné (pie. toutes les racines des veines pourraient
bien être ainfi percées, du-moins d’une manière
infenfible ; mais les injeâions les plus délicates
n’ont point confirmé cette conjeâure. ( D . J .)
‘ H y p o g a s t r iq u e , ( Medec. ) dans les maladies
oh la vëffie & la matrice peuvent être intéreffées,
les Médecins ne doivent pas négliger l’examen de
la région hypogajlrique ; parce qu’ils en peuvent tirer
tien des figiies diagnoftics & prognoftics pour tout
t e qui a rapport à ces parties ; parce qu’en touchant,
eirpreflUiit avec les doigts l’hypôgaftre, on s’apper-
Ç°it s’il y a tumeur , dureté, ou tendon ; fi l’oncaufe
un fentiment douloureux au malade, &c. Vass
ie ,U r in e ,M a t r ic e , Me n s t r u e s , Lo c h ie s .
HYPOGÉE , f. m. terme d'AJlrologie , eft le nom
que les Aftrologues donnent aux maifons céleftes
qui font au-deffous del’horifon, fur-tout à la partie
la plus baffe du ciel.
Hy po g é e , ( Antiq. ) tombeau fous terre. Les
Grecs après avoir perdu l’ufage de brider les corps
des morts, les enterrerent fous terre dans des cercueils
qu’ils nommèrent hypogées, & qui étoient
affez^ femblables aux caveaux qu’on voyoit autrefois
communément dans nos églifes. Chaque
corps parmi les Grecs avoit fa place dans ces fortes
de monumens féparés, qui s’élevoient en forme
de voûte.
Les hypogées des premiers Romains étoient au
rez-de-chauffée, & n’occupoient point autant de
profondeur que ceux de Grece, parce qu’on n’y
! renfermoit que les urnes qui contenoient les cendres
des morts ; mais dans la fuite, les grandes ri-
cheffes des particuliers les portèrent à imiter en ce
point la magnificence des Grecs, & bien-tôt ils ia
furpafferént à tous égards.
Non contens de bâtir à leur imitation des tombeaux
foûterrains compofés de plufieurs apparte-
mens, dans chacun defquels il y avoit un grand
nombre de niches pour placer des urnes fépulchra-
les ; ils ornèrent encore ces appartemens foûterrains
de peintures à frefque , de mofaïques, de figures
de relief en marbre , & autres décorations
d’une richeffe & d’une dépenfe infiniment plus confidérable,
que celles des plus belles fépultures élevées
fur terre. On a eu lieu de le voir par les hypogées
qu’on a découverts de tems-en-tems, en fouillant
des ruines auprès de Rome.
Ce mot eft formé d’JW, dejfous, 8c de >«, terre. V i-
truve a appliqué ce terme abufivement à toutes les
parties d’un bâtiment qui font fous terre, comme les
ca ves, les celliers, les gardes-mangers, &c. mais ce
n’étoit point-là le fens du mot hypogée dans fon origine.
( D . J . )
Hy po g é e , hypogceum, terme d'Architecture ; les
anciens appelloient hypogées les parties des bâtimens
qui étoient fous terre, comme les caves, les celliers,
les gardes-manger, & autres lieux femblables. Vi-
truve, lib. VI. chap. x j. Ce mot eft grec v?royuov,
formé de mro ,fous, 8c yctta., terre.
HYPOGLOSSE, adj. en Anatomie , fe dit de quelques
parties qui fe remarquent fous la langue.
Les nerfs hypoglojfes externes ou grands hypoglof-
fes y appellés communément la neuvième paire de
nerfs de la moelle allongée, ou paire linguaky naiffent
de côté 8c d’autre entre les éminences pyramidales
& les éminences olivaires, par plufieurs petits filets
qui fe collent enfemble, percent la dure-mere, &
fortent du crâne par le trou condyloïdien antérieur
de l’os occipital. Voye^O c c ip it a l .
Ces nerfs, dans leur paffage entre la jugulaire &
la carotide, jettent plufieurs filets aux glandes jugulaires
, &c. un de ces filets s’unit à la huitième paire.
Ces nerfs viennent enfuite gagner la mâchoire inféf
rieure, & communiquent avec le rameau lingual
du nerf maxillaire inférieur, & de la huitième paire
avec la première paire cervicale, avec la premier®
& la fécondé paire vertébrale, avec la portion dure
du nerf auditif, 8c après cela ils fe diftribuent dans
la langue. Voyc{ Lan g u e.
HY PO G LO T TID E , f. f. (A r t nttmifm. ) couronne
de laurier d’Alexandrie, qui étoit très-odorant.
On voit la -figure d’une hypoglottide fur une •
médaille de la ville de Myrine enTroade, qui couronne
la célébré amazone de ce nom, dont il eft
parle dans Athenee, dans Strabon, & fur-tout dans
Diodore. de Sicile. Triûan a tâché de l’expliquer *
cette médaille, mais il ne paroit pas qu’il ait réuffi.
( i > . / . )
HYPOÏASTIEN , un des modes de l’ancienne
mufique. Voye{ H yp O IONIEN. ( S )
HYPOIONIEN, ( Mujique. ) le fécond au grave
des modes de l’ancienne mufique, qu’Euclyde ap-
jpelle auffi hypoiajlien 8c hypophrygien grave. Sa fondamentale
étoit une quarte au-deffous du mode ionien.
Voyt{ M ode. (A )
HYPOLYDIEN, (Mufique.) eft, dans l’ancienne
mufique, un mode qui tire fon origine du lydien,
& dont la fondamentale eft une quarte au-deffous
de la fienne. Voyeç Mo de.
Euclyde diftingue deux modes hypolydiens ; fav
o ir , l’aigu dont nous venons de p arler, & le grave
qui eft le même que Yhypoèolien. Voyeç ce mot.
Quelques-uns attribuent l’invention du mode hy-
polydien à Polymnefte, d’autres àDamon l’athénien.
( •*)H
YPOMIXOLYDIEN, ( Mujique.') mode qu’on
prétend avoir été ajouté par G uy d’Arezzo à ceux
de l’ancienne mufique. C’eft proprement le plagal
du mode mixolydien, dont la fondamentale eft une
quarte au-deffus de la fienne, qui eft la même que
celle du mode dorien. Voye{ M ode. ( S )
HYPOMNEMATOGRAPHE, ( Antiq. eccléf )
nom qu’on donnoit dans la primitive Eglife à celui
des officiers de l’évêque qui tenoit fous fes yeux le
regiftre de fes confécrations. On voit que ce mot eft
compofé de wVo',, dejfous, p.vnp.n, mention, 8c ypâtpa,
j ’écris. (D . J.')
HYPOMOCHLION, f. m. terme de Méchanique,
c’eft le point qui foûtient le levier, 8c fur lequel il
fait fon effort, foit qu’on le baiffe, ou qu’on le leve.
On l’appelle plus ordinairement point d'appui ou
appui. Voye^ Ap p u i & Lev ie r . Ce mot eft grec,
& vient dWo, fou s , & [xo%\o<;, veclis, levier.
Vhypomochlion eft fouvent une roulette que l’on
place fous le levier, ou une pierre , ou un morceau
de bois, pour pouvoir foûlever le levier plus aifé-
ment. Chambers. ( O )
HYPOPHASE, f. f. (Med.')Ù7To<pa.fiÇy fubapparitioy
du verbe vnsô^a.ivcfM.i yfubappareo. C ’eft un terme employé
pour exprimer ce qui arrive à ceu x, qui, en
dormant, ont les paupières imparfaitement jointes
entre elles, en forte qu’on voit une partie du blanc
des yeux mal fermés ; ce qui eft une marque de grande
foibleffe, & un très-mauvais ligne dans les maladies
aiguës. Voyt{ Y EUX, ( Séméiotique. )
HYPOPHASIE, f. f. fufpeclioy (Med.') c’eft un
terme grec qui fort à défigner une forte de clignotement
dans lequel les paupières reftent tellement
rapprochées, qu’elles ne laiffent appercevoir qu’une
très-petite portion des yeux par laquelle il n’entre
par conféquent qu’une très-petite quantité de lumière.
Ce refferrement des paupières a lieu , lorfqu’on
a beaucoup de fenfibilité aux y e u x , ou que l’on
veut regarder quelque objet bien lumineux pendant
que la pupille eft encore dilatée ; ou lorfqu’on ne
veut que fe conduire à travers un air chargé de fumée
ou de pouffiere, dont on veut fe garantir les
yeux. Voye? C l ig n o t em e n t , Pa u piè r e s.
HYPOPHILLOSPERMATEUSE, plante, ( no-
mencl. Botan.) c’eft ainfi que les modernes nomment
les plantes qui portent leurs fomences fur le dos de
leurs feuilles ; ils difont tout cela dans un mot, qui
ne doit pas paroitre barbare, parce qu’il exprime
tres-bien ce qu’on veut défigner. Il eft compofé de
wno^y fo™ 9 <pùXMv, une feuille , & omp/Mt, graine.
'. HYPOPHORE, f. f. terme de Chirurgie, ulcéré
Ouvert, profond & fiftulgux j çe 'mot eft grec, mifo-
Tome V l l l . ' b
çopd, qui lignifie la même Kl chofo. Voye? U l c é ré. HYPOPHRYGIEN, (Afa/T^ac.) un des modes de
l’ancienne mufique. Il tiroit fon origine du phrygien,
dont la fondamentale étoit une quarte au-deffus de
la fienne. Voye£ Mo d e .
Euclyde parle encore d’un autre mode hypophrygien
au grave de celui-ci ; c’eft celui qu’on appelle
plus correftement hypoïonien. Voye? ce mot. (S )
HYPOPHTALMION, (Medec.) c’eft un terme
grec employé pour défigner la partie inférieure des
y e u x , o u , pour mieux dire, des paupières, qui eft
bouffie, dans les cacheâiques, les hydropiques.
Hippocrate fo fort de ce mot dans ce fens, coaci
text‘ 39• &c. Voye^ Pa u p iè r e , C a c h e x ie , Hy-
DROPISIE.
HYPOPHYSE, f. m. (Méd.) c’eft une efpece de
trichiafe, de chute des cils. Voy. T r ic h ia s e , C il s,
PAUPIERES.
HYPOPROPHETE, f. m. (Antiq. greq. ) C„0*,p.-
tptTai, prophète en fous ordre , de î><tto & -npoipir» ; on
appelloit ainfi chez les Grecs les fubdélegués des
devins, c’eft-à-dire, de ceux qui rendoient la ré-
ponfo des dieux qu’on venoit confulter. Il n’étoit
pas de la dignité des oracles de refter muets faute
d’organes; il falloit, en cas d’abfence ou de maladie
des prophètes, qu’il y eût des gens qui tinffent leurs
places, qui exerçaffent leurs fondions, & cet honneur
appartenoit alors aux hypoprophetes, qui étoient
leurs vicaires. Voye^ Pr o p h è t e s . (D . J . )
HYPOPROSLAMBANOMENOS eft, enMufique,
le nom d’une corde ajoûtée, à ce qu’on prétend,
par Guy Arétin, un ton plus bas que la proflamba-
nomenos des Grecs ; c’eft-à-dire, au-deffous de tout
le fyftème, & qu’il exprima par la lettre r. Voyez
Ga m m e , Sy s t èm e . ( S )
HYPOPYON, 1. m. terme de Chirurgie y maladie
des yeux , qui confifte en un amas de pus derrière
la cornée, qui couvre quelquefois toute la prunelle,
ôc empeche la vue. Ce mot eft g rec, u'utoorvov y corn—
pofé de vvo, fous y & de nvov, pus.
Les auteurs ne font pas d’accord fur la fignifica-
tion du mot hypopyon. Quelques-uns appellent ainfi
tous les amas de pus qui viennent des abfcès des
parties intérieures de l’oeil, ou du fang épanché au-
dedans de l’oeil & qui a fuppuré ; & d’autres entendent
par hypopyon y l’abfcès qui fe fait entre les
pellicules de la cornée, & l ’épanchement du pus qui
fe fait au-dedans de l’oeil, lorlque cet abfcès s’ouvre
en-dedans. Ceux-ci reftraignent la lignification du
terme.
L 'hypopyon eft caiifé par la rupture des vaifleaux
de la cornée, occafionnée par quelque violence
externe, ou par l’acrimonie du fang qu’ils contiennent.
On doit prévenir la fuppuration par le moyen de
cataplafmes convenables, fécondés du régime & des
faignées qu’on réitéré relativement aux circonftan-
ces. Les auteurs preferivent des fachets avec les
fleurs de camomille, de mélilot, les fommités de
fauge, d’euphraife, d’hyffope & la femence de fenouil
qu’on fait bouillir dans le v in , & qu’on applique
enfuite chaudement ; ces fecours peuvent procurer
la réfolution du pus dans M hypopyon, & même
celle du fang épanché fous la cornée par la rupture
de quelques vaifleaux de l’uvée à l’occafion d’un
coup ou d’une chûte violente. Si dans l’un & l’autre
cas, les remedes font inefficaces, & que les malades
fouffrent, il faut faire une ouverture à la cornée
avec une lancette : cette opération a été pratiquée
avec tout le fuccèspoffible. La nature produit, quelquefois
dans Y hypopyon des effets que l’art ne peut
point imiter, car le pus 1e fait jour intérieurement
entre l’iris & la cornée, il s’épanche & fe deffeche
F f f ij