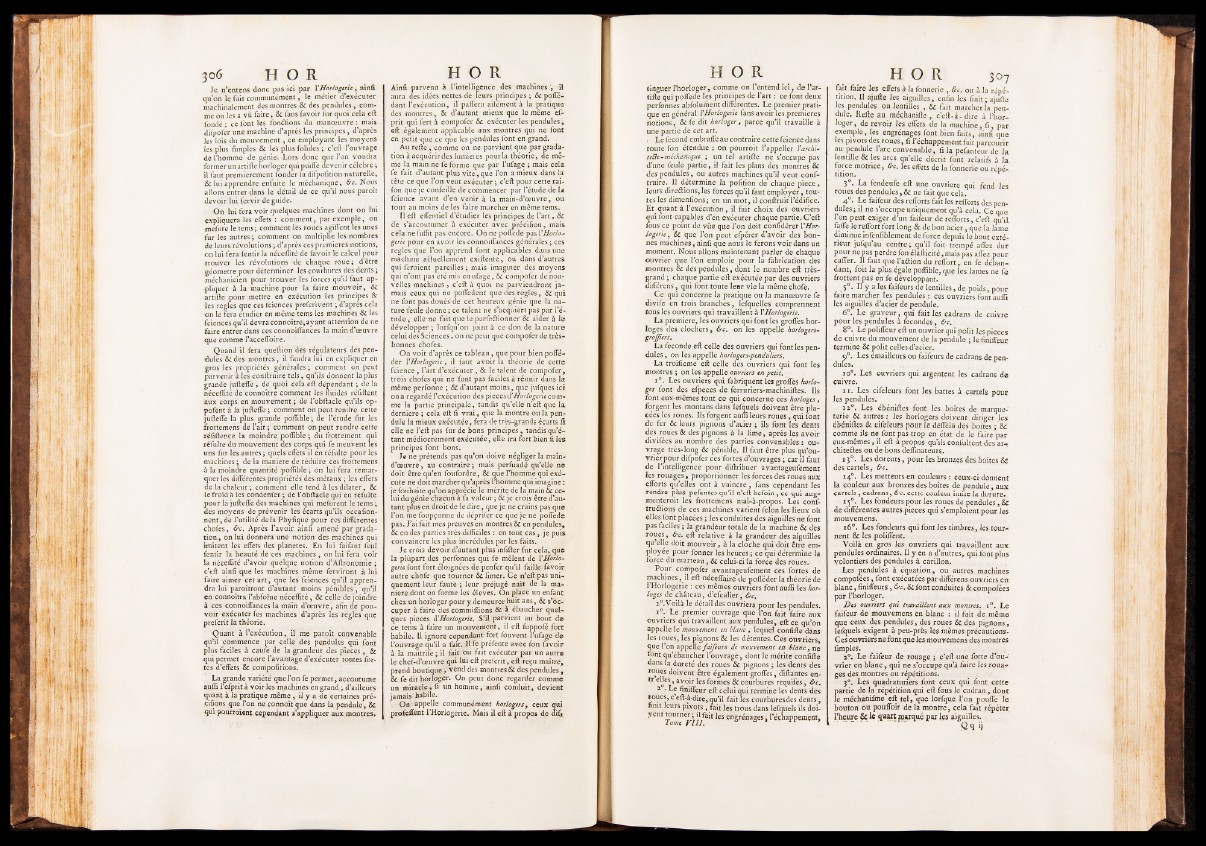
Je n’entens donc pas ici par VHorlogerie, ainfi
qu’on le fait communément, le métier d’exécuter
machinalement des montres & des pendules , comme
on les a vû faire, & fans favoir lur quoi cela eft
fondé ; ce font les fondions du manoeuvre : mais
difpofer une machine d’après les principes, d’après
les lois du mouvement en employant les moyens
les plus fimples & les plus folides ; c’eft l’ouvrage
de l’homme de génie. Lors donc que l’on voudra
former un artifte horloger qui puiffe devenir célébré ;
il faut premièrement fonder là difpofition naturelle,
& lui apprendre enfuite le méchanique, &c. Nous
allons entrer dans le détail de ce qu’il nous paroît
devoir lui fervir de guide.
On lui fera voir quelques machines dont on lui
expliquera les effets : comment, par exemple, on
mefure le tems; comment les roues agiffent les unes
fur les autres ; comment on multiplie les nombres
de leurs révolutions ; d’après ces premières notions,
on lui fera fentir la néceffité de favoir le calcul pour
trouver les révolutions de chaque roue; d’être
géomètre pour déterminer les courbures des dents ;
méchanicien pour trouver les forces qu’il faut appliquer
à la machine pour la faire mouvoir, &
artifte pour mettre en execution les principes &
les réglés que ces fciences prefcrivent ; d’ après cela
on le fera étudier en même tems les machines & les
fciences qu’il devra connoître, ayant attention de ne
faire entrer dans ces connoiffances la main d’oeuvre
que comme l’acceffoire.
Quand il fera quéftion des régulateurs des pendules
'& des montres, il faudra lui en expliquer en
gros les propriétés générales ; comment on peut
parvenir à les conftruire tdls, qii’iis donnent la plus
grande juftefle , de quoi cela eft dépendant ; de la
néceffité de connoître comment les fluides rëfiftent
aux corps en mouvement.;' de l ’obftacle qu’ils op-
pofent à la juftefle ; comment on peut rendre cette
juftefle la plus grande poflible; de l’étude fur les
frottemens de l’a ir;' comment on peut rendre cette
réliftence la moindre, poflible ; du frottement qui
réfulte du mouvement des~Corps qui fe meuvent les
uns fur les autres ; quels effets il en réfulte pour les
machines ; de la maniéré de réduire ces frottemens
à la moindre quantité poflible ; on lui fera remarquer
les différentes propriétés des métaux ; les effets
de la chaleur; comment elle tend à les dilater, 8c
le froid à les condenfer ; de t’obftacle qui en réfulte
pour la juftefle des machines qui mefurent le tems ;
des moyens de prévenir les écarts qu’ils occafion-
nent, de l’utilité delà Phylique pour ces différentes
chofes, &c. Après l’avoir ainû amené par gradation,
on lui donnera une notion des machines qui
imitent lès effets des planètes. En lui faifant feul
fentir la beauté de ces machines , on lui fera voir
la néceffité d’avoir quelque notion d’Aftronomie ;
c’eft ainfi que les machines même ferviront à lui
faire aimer cet art, que les fciences qu’il apprendra
lui paroîtront d’autant moins pénibles", qu’il
en connoîtra l’abfohxe néceffité, 8c celle de joindre
à ces connoiffances la main d’oeuvre, afin de pouvoir
exécuter fes machines d’après les règles que
prefcrit la théorie.
Quant à l’exécution, il me paroît convenable
qu’il commence par celle des pendules qxii font
plus faciles à caufe de la grandeur des pièces , &
qui permet encore l’avantage d’exécuter toutes fortes
d’effets 8c compofitions.
La grande variété que l’on fe permet, accoutume
auffi l’efprit à voir les machines en grand ; d’ailleurs
quant à la pratique même , il y a de certaines prêchions
que l’on ne connoît que dans la pendule, 8c
qui pourroicnt cependant s’appliquer aux montres.
Ainfi parvenu à l ’intelligence des machines il
aura des idées nettes de leurs principes ; 8c poffé-
dant l’exécution, il paffera ailément à la pratique
des montres, & d’autant mieux que le même ef-
prit qui fert à compofer 8c exécuter les pendules-,
eft également applicable aux montres qui ne font
en petit que ce que les pendules font en grand.
Au refte, comme on ne parvient que par gradation
à acquérir des lumières pour la théorie, de même
la main ne fe forme que par l’ufage ; mais cela
fe fait d’autant plus v ite , que l’on a mieux dans la
tête ce que l’on veut exécuter ; c’eft pour cette rai-
lon que je confeiüe de commencer par l’étude de la
fcience avant d’en venir à la main-d’oeuvre, ou
tout au moins de les faire marcher en même tems.
Il eft effentiel d’étudier les principes de l’art, 8c
de s’accoutumer à exécuter avec précifion, mais
cela ne fuffit pas encore. On ne poffede pas VHorlogerie
pour en avoir les connoiffances générales ; ces
regies que l’on apprend font applicables dans une
machine actuellement exiftente, ou dans d’autres
qui feroient pareilles ; mais imaginer des moyens
qui n ’ont pas été mis enufage, 8c compofer de nouvelles
machines, c’eft à quoi ne parviendront jamais
ceux qui ne poffedent que des regies, & qui
ne font pas doués de cet heureux génie que la nature
feule donne ; ce talent ne s’acqùiert pas par l’étude
, elle ne fait que le perfectionner 8c aider à le
développer ; lorfqu’on joint à ce don de la nature
Celui des Sciences, on ne peut que compofer de très-
bonnes chofes.
On voit d’après ce tableau, que pour bien poffé-
der l'Horlogerie, il faut avoir la théorie de cette
fcience, l’art d’exécuter , & le talent de compofer,
trois chofes qui ne font pas faciles à réunir dans la
même perfonne ; 8c d’autapt moins, que jufques ici
on a regardé l’exécution des pièces à!Horlogerie comme
la partie principale, tandis qu’elle n’eft que la
derniere ; cela eft fi v ra i, que la montre ou la pendule
la mieux exécutée, fera de très-grands écarts fi
elle ne l’eft pas fur de bons principes , tandis qu’étant
médiocrement exécutée, elle ira fort bien fi les
principes font bons.
Je ne prétends pas qu’on doive négliger la main-
d’oeuvre , au contraire ; mais perfuadé qu’elle ne
doit être qu’en foufordre, 8c que l’homme qui exécute
ne doit marcher qu’après l’homme qui imagine :
je fouhaite qu’on apprécié le mérite de la main 8c celui
du génie chacun à fa valeur; 8c je crois être d’autant
plus en droit de le dire, que je ne crains pas que
l’on me foupçonne de déprifer ce que je ne poffede
pas. J’ai fait mes preuves en montres 8c en pendules,
8c en des parties très-difficiles : en tout cas, je puis
convaincre les plus incrédules par les faits.
Je crois devoir d-’autant plus infifter fur cela, que
la plupart des perfonnes qui fe mêlent de VHorlogerie
font fort éloignées de penfer qu’il faille favoir
autre chofe que tourner 8c limer. Ce n’eft pas Uniquement
leur faute ; leur préjugé nait de la ma- •
niere dont on forme les éleves. On place un enfant
chez un horloger pour y.demeurer huit ans, 8c s’occuper
à faire des commiffions 8c à ébaucher quelques
pièces d’Horlogerie. S’il parvient au bout d®
ce tems à faire un mouvement, il eft fuppofé fort
habile. Il ignore cependant fort fouvent l ’ufage de
l’ouvrage qu’il a fait. Il fo préfente avec fon favoir
à la maîtrife ; il fait ou fait exécuter par un autre
le chef-d’oeuvre qui lui eft prefcrit, eft reçu maître,
prend boutique, vend des montres & des pendules ,
8c fe dit horloger. On peut donc regarder comme
un miracle, fi un homme, ainfi conduit, devient
jamais habile.
On appelle communément horlogers, ceux qui profeffent l’Horlogerie. Mais il eft à propos de aiü
tinguer l’horloger, comme on l’entend ic i, de l ’ar-
tifte qui poffede les principes de l’art : ce font deux
perfonnes abfolument différentes. Le premier pratique
en général l'Horlogerie fans avoir les premières
notions, 8c fe dit horloger, parce qu’il travaille à
une partie de cet art.
> Le fécond embraffe au contraire cette fcience dans
toute fon étendue : on pourroit l’appeller l’architecte
-mécha/iique ; un tel artifte ne s’occupe pas
d’une feule partie, il fait les plans des montres 8c
des pendûles, ou autres machines qu’il veut conf-
truire. Il détermine la pofition de chaque piece,
leurs directions, les forces qu’il faut employer, toutes
les dimenfions; en un mot, il conftruitl’édifice.'
Et quant à l’exécution, il fait choix des ouvriers
qui font capables d’en exécuter chaque partie. C ’eft
fous ce point de vue que l’on doit confidérer VHorlogerie
, 8c que l’on peut efpérer d’avoir des bonnes
machines, ainfi que nous le ferons voir dans un
moment. Nous allons maintenant parler de chaque
ouvrier que l ’on emploie pour la fabrication des
montres 8c des pendules, dont le nombre eft très-
grand ; chaque partie eft exécutée par des ouvriers
différens, qui font toute leur v ie la même chofe.
Ce qui concerne la pratique ou la manoeuvre fe
divife en trois branches, lefquelles comprennent
fous les ouvriers qui travaillent à l'Horlogerie.
La première, les ouvriers qui font les groffes horloges
des clochers, &c. on les appelle horlogcrs-
grojjiers.
La fécondé eft celle des ouvriers qui font les pendules
, on les appelle horlogers-penduliers.
La troifieme eft celle des ouvriers qui font les
montres ; on les appelle ouvriers en petit,
i° . Les ouvriers qui fabriquent les groffes horloges
font des efpeces de ferruriers-machiniftes. Ils
font eux-mêmes tout ce qui concerne ces horloges ,
forgent les montans dans lefquels doivent être placées
les roues. Ils forgent auffi leurs roues, qui font
de fer & leurs pignons d’acier ; ils font les dents
des roues & des pignons à la lime, après les avoir
divifées au nombre des parties convenables : ouvrage
très-long 8c pénible. Il faut être plus qu’ouvrier
pour difpofer ces fortes d’ouvrages ; car il faut
de l ’intelligence pour diftribuer avantageufement
les rouages , proportionner les forces des roues aux
efforts qu’elles ont à vaincre, fans cependant les
rendre plus pefantes qu’il n’eft befoin, ce qui aug-
menteroit les frottemens mal-à-propos. Les conf-
truâions de ces machines varient félon les lieux oii
elles font placées ; les conduites des aiguilles ne font
pas faciles ; la grandeur totale de la machine & des
roues, &c. eft relative à la grandeur des aiguilles
qu’elle doit mouvoir, à la cloche qui doit être employee
pour fonner les heures; ce qui détermine la
force du marteau, 8c celui-ci la force des roues.
Pour compofer avantageufement ces fortes de
machines, il eft néceffaire de pofféder la théorie de
l’Horlogerie : ces mêmes ouvriers font auffi les horloges
de château, d’efcalier, &c.
z°. Voilà le détail des ouvriers pour les pendules.
i° . Le premier ouvrage que l ’on fait faire aux
ouvriers qui travaillent aux pendules, eft ce qu’on
appelle le mouvement en blanc, lequel confifte dans
les roues, les pignons 8c les détentes. Ces ouvriers,
que l’on appelle faifeurs de mouvement en blanc, ne
font qu’ébaucher l’ouvrage, dont le mérite confifte
dans la dureté des roues & pignons ; les dents des
roues doivent être également groffes, diftantes en-
tr elles, avoir les formes 8c courbures requifes, &c.
2 • Le finiffeur eft celui qui termine les dents des
roues, c’eft-à-dire, qu’il fait les courbures des dents,
finit leurs pivots , tait les trous dans lefquels ils doi-
yent tourne^iMait les engrenages, l’échappement,
fait faire les effers à la fonnerie , &c. oit a la répétition.
Il ajufte les aiguilles’ , enfin les finit ; ajufte
les pendules ou lentilles , & fait marcher la pendule.
-Refte au méchanifte , c’eft-à - dire à l'horloger,
de revoir les effets de la machine, f i , par
exemple, les engrénages font bien faits, ainfi que
les pivots des roues, f i l’échappement fait parcourir
au pendule l’arc convenable, fi la pefanteur de la
lentille & les arcs qu’elle décrit font relatifs à la
force motrice, &c. les effets de la fonnerie ou répétition.
3 • La fendeufe eft une ouvrière qui fend les
roues des pendules, & ne fait que cela?
4°. Le faifcur des refforts fait les refforts des pendules;
il ne s’occupe uniquement qu’à cela. Ce que
l’on peut exiger d’un faifeur de refforts, e’eft qu’il
faffe le rçffort fort long & de bon acier, que la lame
diminue infenfiblement de force depuis le bout exté.
rieur jufqu’au centre ; qu’il foit trempé affez dur
pour ne pas perdrefonélafticité, mais pas affez pour
caffer. Il faut que l’aftion du reffort, en fe débandant,
foit la plus égale poflible, que les lames ne fe
frottent pas en fe développant.
5°. Il y a les faifeurs de lentilles, de poids, pour
faire marcher les pendules : ces ouvriers font auffi
les aiguilles d’acier de pendule.
6°. Le graveur, qui fait les cadrans de cuivre
pour les pendules à fécondés, &c.
8°. Le poliffeur eft un ouvrier qui polit les pièces
de cuivre du mouvement de la pendule ; le finiffeur
termine & polit celles d’acier.
90. Les émailleurs ou faifeurs de cadrans de pendilles.
io°. Les ouvriers qui argentent les cadrans do
cuivre.
1 1. Les cifeleurs font les battes à cartels pour
les pendules.
12°. Les ébéniftes font lés boîtes de marqueterie
8c autres : les horlogers doivent diriger les
ébéniftes & cifeleurs pour le deffein des boîtes ; 8c
comme ils ne font pas trop en état de le faire par
eux-mêmes, il eft à propos qu’ils confultent des architectes
ou de bons deffinateurs.
130. . Les doreurs, pour les bronzes des boîtes 8c
des cartels, & c .
140. Les metteurs en couleurs : ceux-ci donnent
la couleur aux bronzes des boîtes de pendule, aux
cartels, cadrans, &c. cette couleur imite la dorure.
1 50. Les fondeurs pour lès roues de pendules, 8c
de différentes autres pièces qui s’emploient pour les
mouvemens.
160. Les fondeurs qui font les timbres, les tour-:
nent 8c les poliffent.
Voilà en gros les ouvriers qui travaillent aux
pendules ordinaires. Il y en a d’autres,, qui font plus
volontiers des pendules à carillon.
Les pendules à équation , ou autres machines
composées, font exécutées par différens ouvriers en
blanc, finiffeurs, &c. 8c font conduites & çompofées
par l’horlogér.
Des ouvriers qui travaillent aux montres, i ° . Le
faifeur de mouvemens en blanc : il fait de même
que ceux des pendules, des roues 8c des pignons,
lefquels exigent à peu-près les mêmes: précautions.
Ces ouvriers ne font que les mouvemens des montres
fimples.
20. Le faifeur de rouage ; c’eft une forte d ’ouvrier
en b lanc, qui ne s’occupe qu’à faire les roua-
ges des montres ou répétitions.
30. Les quadraturièrs font ceux qui font cette
partie de la répétition qui eft fous le cadran, dont
lé méchânifiiie eft te l, que lorfque l’on pouffe le
bouton ou pouffoir de la montre, cela fait répéter l’heure & le quart marqué par les aiguilles.
Q q i j