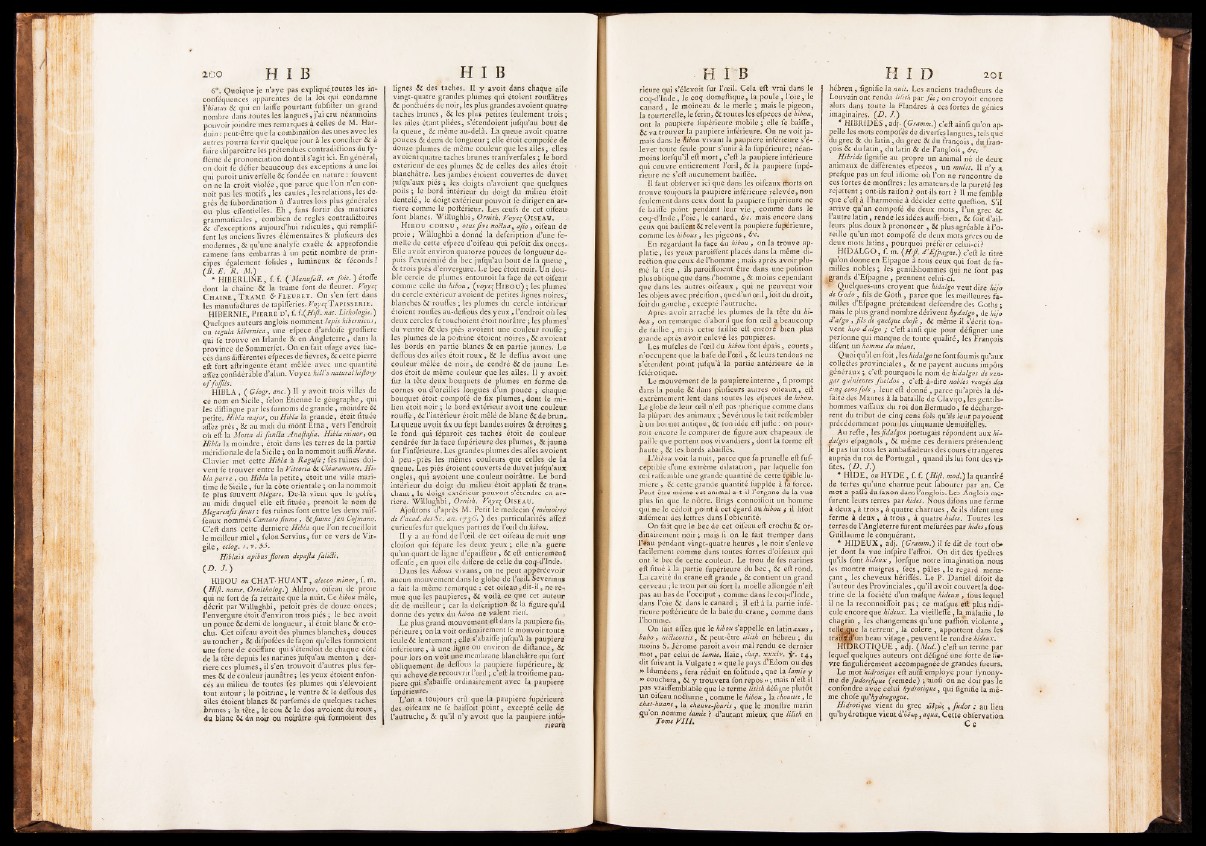
220000 H I B
6°. Quoique je n’aye pas expliqué.toutes les in-
conféquences apparentes de la loi qui condamne
Y hiatus 6c qui en laifle pourtant fubfifter un grand
nombre dans /toutes les langues, j’ai cru néanmoins
pouvoir joindre mes remarques à celles de M. Har-
duin ; peut-être que la combinaifon des unes avec les
autres pourra fervir quelque jour à les concilier 6c à
faire difparoître les prétendues contradittions du fy-
ftème de prononciation dont il s’agit ici. En général,
on doit fe défier beaucoup des exceptions à une loi
qui paroît universelle 6c fondée en nature : Souvent
on ne la croit violée, que parce que 1 on n en con-
noît pas les motifs, les caufes, les relations, les degrés
de Subordination à d’autres lois plus generales
ou plus effentielles. Eh , Sans Sortir des matières
grammaticales , combien de réglés contradictoires
& d’exceptions aujourd’hui ridicules, qui remplit-
Sent les anciens livres élémentaires & plufieurs des
modernes, & qu’une analyfe exatte & approfondie
ramene fans embarras à un petit nombre de principes
également Solides , lumineux 6c féconds i
( B. E. R. M.) I
* HIBERLINE, f . f . ( Manufacl. en foie. ) étoffé
dont la chaîne 6c la trame font de fleuret. Fiye{ Chaîne , T rame & Fleuret. On s’en Sert dans
les manufactures de tapifferies.J'qycçTAPisSERiE. HIBERNIE, Pierre d’, i.i.(Hift. nat. Lithologie.)
Quelques auteurs anglois nomment lapis hibtrnicus,
ou tegula hibernica, une efpece d’ardoife grofliere
qui fe trouve en Irlande & en Angleterre, dans la
province deSommerfet. On en fait ufage avec Succès
dans différentes efpeces de fievres, 6c cette pierre
eft fort aftringente étant mêlée avec une quantité
affez confidérable d’alun. Voyez hilTs naturalhifiory
o f foffils. j '
HIBLA , ( Géogr. anc.) Il y avoit trois villes de
ce nom en Sicile, Selon Etienne le géographe, qui
les diftingue par les Surnoms de grande, moindre 6c
petite. Hibla major, ou Hibla la grande, etoit fituee
affez près, & au midi du mont Etna, vers l’endroit
où eft la Motta di fancta Anaflafia. Hibla ininor, ou
Hibla la moindre, étoit dans les terres de la partie
méridionale de la Sicile ; on la nommoit auffi Heraa.
Clavier met cette Hibla à Ragufa; Ses ruines doivent
Se trouver entre la Vittoria & Chiaramonte. Hibla
parva , ou Hibla la petite, étoit une ville maritime
de Sicile, fur la côte orientale ; on la nommoit
le plus Souvent Mègare. De-là vient que le golfe,
au midi duquel elle eft Située, prenoit le nom de
Megarenfis finus : Ses ruines font entre les deux ruif-
feaux nommés Cantarofume, 6cfiume fan CoJ'tnano.
C ’eft dans cette dêrniere Hibla que l ’on recueilloit
le meilleur miel, Selon Servius, fur ce vers de Virg
ile , eclog. i . v . 55.
Hibloeis apibus fiorem depajla falicli.
( 2). J .)
HIBOU ou CHAT- HUANT, alecco minor, f. m.
( Hifl. natur. Ornitholog.) Aldrov. oifeau de proie
qui ne Sort de fa retraite que la nuit. Ce hibou mâle,
décrit parWillughbi, pelbit près de douze oricès ;
l ’envergure étoit d’environ trois piés ; le bec avoit
un pouce & demi de longueur, il étoit blanc & crochu.
Cet oifeau avoit des plumes blanches, douces
au toucher, 6c difpofées dé façon qu’elles formoient
une forte de coëffure qui s’étendoit de chaque côté
de la tête depuis les narines jufqu’au menton ; derrière
ces plumes, il s’en trouvoit d’autres plus fermes
6c de couleur jaunâtre ; les yeux étoient enfoncés
au milieu de toutes Ses plumes qui s'élevaient
tout autour ; la poitrine, le ventre 6c le deffous des
ailes étoient blancs 6c parfemés de quelques taches
brunes ; la tête, le cou 6c le dos avoient du roux,
du blanc 6c du noy; ou noirâtre qui formoient des
H I B
lignes 6c des taches. Il y avoit dans chaque aîle
vingt-quatre grandes plumes qui étoient rouffâtres
6c ponctuées de noir, les plus grandes avoient quatre
taches bûmes, 6c les plus petites Seulement trois ;
les ailes étant pliées, s’étendoient jufqu’au bout de
la queue, 6c même au-delà. Là queue avoit quatre
pouces & demi de longueur ; elle étoit compolée de
douze plumes de même couleur que les aîles, elles
avoient quatre taches brunes tranfverfales ; le bord
extérieur de ces plumes 6c de celles des aîles étoit
blanchâtre. Les jambes étoient couvertes de duvet
jusqu’aux piés ; les doigts n’a voient que quelques
poils ; le bord intérieur du doigt du milieu étoit
dentelé, le doigt extérieur pouvoit fe diriger en arriéré
comme le poftérieur. Les oeufs de cet oifeau'
font blancs. Willughbi, Ornitk. Foyer OiSEAU.
Hibou cornu , otusfive noB.ua, afio , oifeau de
proie ; Willughbi a donné la description d’une femelle
de cette efpece d’oifeau qui pefoit dix onces-.
Elle avoit environ quatorze pouces de longueur depuis
l’extrémité du bec jufqu’au bout de la queue ,
& trois piés d’envergure. Le bec étoit noir. Un double
cercle de plumes èntouroit la face de cet oifeau
comme celle du hibou, (yoye{Hibo u ) ; les plumes’
du cercle extérieur avoient de petites lignes noires,’
blanches 6c rouffes ; les plumes du cercle intérieur
étoient rouffes au-deffous des y e u x , l’endroit où les
deux cercles fe touchoient étoit noirâtre ; les plumes'
du ventre 6c des piés avoient une couleur rouffe ;
les plumes de la poitrine étoient noires, 6c avoient
les bords en, partie blancs & en partie jaunes. Le
deffous des aîles étoit roux, 6c le deffus avoit une
couleur mêlée de noir, de cendré 6c de jaune Le*
dos étoit de même couleur que les aîles. Il y avoit.
fur la.tête deux, bouquets de plumes en forme de.
cornes ou d’oreilles longues d’un pouce ; chaque;
bouquet étoit compofé de fix plumes, dont le mi-;
lieu étoit noir ; le bord extérieur avoit une couleur
rouffe, 6c l’intérieur étoit mêlé de blanc & de brun*
La queue avoit fix ou fept bandes-noires & étroites ;
le fond qui féparoit ces taches étoit de couleur
cendrée fur la face fupérieure des plumes, & jaune
fur l’inférieure. Les grandes plumes des aîles avoient
à peu-près les mêmes couleurs que celles de la
queue. Les piés étoient couverts de duvet jufqu’aux
ongles, qui avoient une.couleur noirâtre. Le bord
intérieur du doigt du milieu étoit applati & trann
chant ; le doigt extérieur pouvoit s’étendre en arriéré.
Willughbi, Ornith. Foye^OlSTLAX).
Ajoûtons d’après M. Petit le médecin ( mémoires
de Vacad. desSc. an. lygG.) des particularités affei
curieufes fur quelques parties de l’oeil du hibou.
Il y a au fond de l’oeil de cet oifeau de nuit une
cloifori qui fépare les deux yeux ; elle n’a guère
qu’un quart de ligne d’épaiffeur, 6c eft entièrement
offeufe, en quoi elle différé de celle du coq-d’Inde.
Dans les hibous vivans, on ne peut apperéevoir
aucun mouvement dans le globe de l’oeil. Severinus
a fait la même remarque : cet oifeau, dit-il, ne re-i
mue .que les paupières, & voilà ce que cet auteur
dit de meilleur ; car la defeription & la figure qu’il
donne des yeux du hibou ne valent rien. ,
Le plus grand mouvement eft dans la paupière fu-j
périeure ; on la voit ordinairement fe mouvoir toute
feule & lentement ; elle s’abaiffe jufqu’à la paupière
inférieure, à une ligne on environ de diftance, 6c
pour lors on voit une membrane blanchâtre qui fort
obliquement de deffous la paupière fupérieure, &
qui achevé de recouvrir l’oeil ; c’eft la troifieme paupière
qui .s’abaiffe ordinairement avec la paupière
fupérieure.
L’on a toujours crû. que la paupière fupérieure
des oifeaux ne fe baiffoit point, excepté celle de
l’autruche , & qu’il n’y avoit que la paupière inférieure
H I B
rîeure qui s’élevoit fur l’oeil. Cela eft vrai dans le
coq-d’Inde, le coq domeftique, la poule , l ’o ie ,' le
canard , le moineau 6c le merle ; mais le pigeon,
la tourterelle, le ferin, & toutes les efpeces de hibou,
ont la paupière fupérieure mobile ; elle fe baiffe,
& va trouver la paupière inférieure. On ne voit jamais
dans le 'Hibou vivant la paupière inférieure s’élever
toute feule pour s’unir à la fupérieure ; néanmoins
lorfqu’il eft mort, c’eft la paupière inférieure
qui couvre entièrement l’oeil, 6c la paupière fupérieure
ne s’eft aucunement baiffée.
Il faut obfèrver ici que dans les oifeaux iftorts on
trouve toujours la paupière inférieure relevée, non
feulement dans ceux dont la paupière fupérieure ne
fe baiffe point pendant leur v ie , comme dans le
coq-d’Inde, l’o ie , le canard, &c. mais encore dans
ceux qui baiffeiit& relevent la paupière fupérieure,
comme les hibous, les pigeons, &c.
En regardant la face du hibou, on la trouve ap-
platie, les yeux paroiffent placés dans la même direction
que ceux de l’homme ; mais après avoir plumé
la tête , ils paroiffoient être dans une pofition
plusobiiqueque dans l’homme * & moins cependant
que dans les autres oifeaux, qui ne peuvent voir
les objets avec précifion, que d’un oeil, foit du droit,
foit du gauche, excepté l’autruche.
Apres avoir arraché les plumes de la tête du hibou,
on remarque d’abord que fon oeil a beaucoup
de faillie , mais cette faillie eft encore bien plus
grande après avoir enlevé les paupières.
Les mufcles de l’oeil du hibou font épais, courts,
n’occupent que la bafe de l’oe i l , 6c leurs tendons ne
s’étendent point jufqu’à la partie antérieure de la
felérotique.
Le mouvement de la paupière interne , fi prompt
dans la poule 6c dans plufieurs autres oifeaux, eft
extrêmement lent dans toutes les efpeces de hibou.
Le globe de leur oeil n’eft pas tphérique comme dans
la plupart des animaux ; Sévérinus le fait reflëmbler
à un bonnet antique, 6c Ion idée eft jufte : on pour-
xoit encore le comparer de figure aux chapeaux de
paille que portent nos vivandiers, dont la forme eft
haute , 6c les bords abaiffés.
L'hibou voit la nuit, parce que fa prunelle eft fuf-_
ceptible d’une extrême dilatation , par laquelle fon
oeil raffcmble une grande quantité de cette fpible.lumière
, 6c cette grande quantité fupplée à la force.
Peut-être même cet animal a-t-il l’organe de la vue
plus fin que le nôtre. Brigs connoiffoit un homme
qui ne le cédoit point à cet égard au hibou ; il liloit
aifément des lettres dans l’obfcurité.
On fait que le bec de cet oifeau eft crochu & ordinairement
noir ; mais fi on le fait tremper dans
l’êau pendant vingt-quatre heures , le noir s’enleve
facilement comme dans toutes fortes d’oifeaux qui
ont le bec de cette couleur. Le trou de fes narines
eft fitué à la partie fupérieure du b ec, 6c eft rond.
La cavité du crâne eft grande, 6c contient un grand
cerveau ; le trou par où fort la moelle allongée n’eft:
pas au bas de l’occiput, comme dans le coq-d’Inde,
dans l’oie 6c dans le canard ; il eft à la partie inférieure
poftérieure de la baie du crâne, comme dans
l’homme.
On fait affez que le hibou s’appelle en latin axus ,
lubo, niclicortis, 6c peut-être lilith en hébreu ; du
moins S. Jérome paroît avoir mal rendu ce dernier
mot, par celui de lamie. Ifaie, chap. xxxiv. ÿ . 14,
dit fuivant la Vulgate : « que le pays d’Edom ou des
» Iduméens, fera réduit en folitude, que la lamie y
» couchera, 6c y trouvera fon repos »; mais n’eft il
pas vraiffemblable que le terme litith défigne plutôt
un oifeau notturne , comme le hibou, la chouette, le
chat-huant, la chauve-fouris, que le monftre marin
qu’on nomme lamie ? d’autant mieux que lilith en
Tome F I I I . ^
ÏI I D 201
hébreu, fignifîe la nuit. Les anciens tradu&eurs de
Louvain ont rendu lilith par fée y on croyoit encore
alors dans toute la Flandres à ces fortes de génies
imaginaires. (D . J.)
* HIBRIDES, adj. (Gramm.) c’eft ainfi qu’on appelle
les mots compofés de diverfes langues, tels que
du grec & du latin, du grec & du François, du fran-
çois & du latin, du latin & de l’anglois, &c.- *
Hibride fignifie au propre un animal né de deux
animaux de différentes efpeces , un mulet. Il n’y a
prefque pas un feul idiome où l’on ne rencontre de
ces fortes de monftres : les amateurs de la purçté les
rejettent j ont-ils raifon ? ont-ils tort ? Il me femble
que c’eft à l’harmonie à décider cette queftion. S’il
arrive qu’un compofé de deux mots, l’un grec 6c
l’autre latin, rende les idées auflx-bien, 6c foit d’ailleurs
plus doux à prononcer , & plus agréable à l’o reille
qu’un mot compofé de deux mots grecs ou de
deux mots latins, pourquoi préférer celui-ci?
HIDALGO, f. m. (H f . d ’Êfpagne.) c’eft le titré
qu’on donne en Efpagne à tous ceux qui font de familles
nobles ; les gentilshommes qui ne font pas
^grands d’Efpagne , prennent celui-ci.
“ Quelques-uns croyent que hidalgo veut dire hijo
de Godo , fils de G oth , parce que les meilleures familles
d’Efpagne prétendent defeendre des Goths ;
mais le plus grand nombre dérivent kydalgo, de hijo
d'algo , fils de quelque chofe, 6c même il s’écrit fou-
vent hijo d'algo ; c’eft ainfi que pour défigner une
perfonne qui manque de toute qualité, les François
difent un homme du néant.
Quoi qu’il en foit, les hidalgo ne font fournis qu’aux
collettes provinciales, & ne payent aucuns impôts
généraux c’eft pourquoi le nom de hidalgos de ven-
gar qui nient es fueldos , c’eft-à-dire nobles vengés des
cinq cens fols , leur eft donné , parce qu’après la défaite
des Maures à la bataille de Clavijo,les gentilshommes
vaffaux du roi donBermudo, fe déchargèrent
du tribut de cinq cens fols qu’ils leur payoient
précédemment pour-les cinquante demoifelles.
Au refte, \esfidalgos portugais répondent aux hidalgos
efpagnols , 6c même ces derniers prétendent
le pas fur tous les ambaffadeurs des cours étrangères
auprès du roi de Portugal, quand ils lui font des vi-
fîtes. (£>. J.)
* H IDE, ou H YD E , f. f. {Hifl. mod.) la quantité
de terres qu’une charrue peut labourer par an. C e
mot a paffé du faxon dans l’anglois. Les Anglois me-
furent leurs terres par hides. Nous difons une ferme
à deux, à trois, à quatre charrues, 6c ils difent une
ferme à deux, à trois , à quatre hides. Toutes les
terres de l’Angleterre furent mefurées par hides, fous
Guillaume le conquérant.
* HIDEUX, adj. (.Gramm.) il fe dit de tout ob»
jet dont la vue infpire l’effroi. On dit des fpettres
qu’ils font hideux, lorfque notre imagination nous
les montre maigres, fecs, pâles , le regard menaçant
, les cheveux hérifles. Le P. Daniel difoit de
l’auteur des Provinciales, qu’il avoit couvert la doctrine
de la fpciété d’un mafque hideux , fous lequel
il ne la reconnoiffoit pas ; ce mafque eft: plus ridicule
encore que hideux;. La vieillefle, la maladie, le
chagrin , les changemens qu’une paflion violente.,
tellegiue la terreur , la colere , apportent dans les
t r a ^ d ’ün beau vifage, peuvent le rendre hideux.
HIDROTIQUE , adj. (Med.) c ’eft un terme.par
lequel quelques auteurs ont défigne une forte de fièvre
finguliérement accompagnée de grandes fueurs.
Le mot hidrotique eft auîfi employé pour lynony-
me de fudorifiqut (remede) ; 'ainfi on ne doit pas le
confondre avec celui hydrotique, qui fignifie la même
chofe qu 'hydragogue.
Hidrotique vient du grec mS'pùç , fudor ; au lieu
qu’hy drotique vient d’w<P«p, aqua. Cette ohfervation. Ce