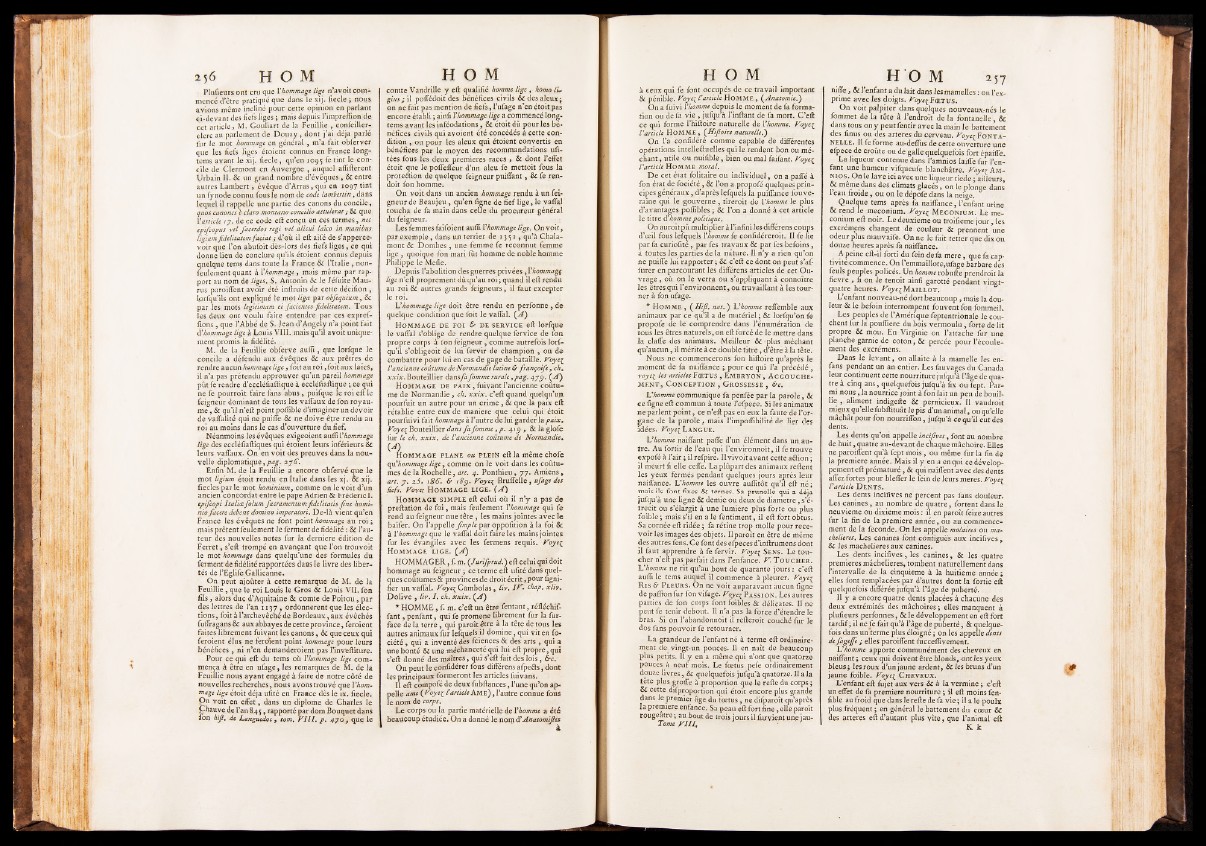
Plufieurs ont cru que [’hommage lige n’avoit commencé
d’être pratiqué que dans le xij. fiecle ; nous
avions même incliné pour cette opinion en parlant
ci-devant des fiefs liges ; mais depuis l’impreflion de
cet article, M. Gouliart de la Feuillie , confeiller-
clerc au parlement de D o u a y , dont j’ai déjà parlé
liir le mot hommage en général , m’a fait obferyer
que les fiefs liges étoient connus en France long-
tems avant le xij. fiecle, qu’en 1095 fe tint le concile
de Clermont en Auvergne , auquel aflifterent
Urbain II. & un grand nombre d’évêques , & entre
autres Lambert, évêque d’Arras, qui en 1097 tint
un fynode connu fous le nom de code lambertin, dans
lequel il rappelle une partie des canons du concile,
quos canones è claro montano concilio attulerat ; ÔC que
l’article 1 y. de ce code eft conçu en ces termes, nec
epifcopus vel facerdos régi vcl alicui laico in manibus
ligiam fidelitatem faciat ; d’où il eft aifé de s’apperce-
voir que l’on ahufoit dès-lors des fiefs liges, ce qui
donne lieu de conclure qu’ils étoient connus depuis
quelque tems dans toute la France & l’Italie , non-
feulement quant à l’hommage, mais même par rapport
au nom de liges. S. Antçnin &c le Jéluite Mau-
rus paroiflent avoir été inftruits de cette décifion ,
lorfqu’ils ont expliqué le mot liga par obfequium, &
par les mots légitimant ei façientes fidelitatem. Tous
les deux ont voulu faire entendre par ces expref-
fions , que l’Abbé de S. Jean d’Angely n’a point fait
d’hommage lige à Louis VIII. mais qu’il avoit uniquement
promis fa fidélité. ? i • :
M. de la Feuillie obferve aufii', que lorfque le
concile a défendu aux évêqües & aux prêtres de
rendre aucun hommage lige , foit au ro i, foit aux laïcs,
il n’a pas prétendu approuver qu’un pareil hommage
pût fe rendre d’eccléfiaftique à eccléfiaftique ; ce qui
ne fe pourroit faire fans abus, puifque le roi eft le
feigneur dominant de tous les vaflaux de fon royaume
, & qu’il n’eft point ppflible d’imaginer un devoir
de vaffalité qui ne puifle & ne doive être rendu au
roi au moins dans le cas d’ouverture du fief.
Néanmoins les évêques exigeoient aufii l’hommage
lige des eccléfiaftiques qui étoient leurs inférieurs Ei
leurs vaflaux. On en voit des preuves dans la nouvelle
diplomatique, pag. xy6.
Enfin M. de la Feuillie a encore obfervé que le
mot ligium étoit rendu en Italie dans les xj. & xij.
fiecles par le mot hominium9 comme on le voit d’un
ancien concordat entre le pape Adrien & Frédéric I.
epifeopi Ita lice fiolum facramentumfidelitatis fine homi-
nio facere debent domino imperatori. De-là vient qu’en
France les évêques ne font point hommage au roi ;
mais prêtent feulement le ferment de fidélité : & l’auteur
des nouvelles notes fur la derniere édition de
Ferret, s’eft trompé en avançant que l’on trou voit
le mot hommage dans quelqu’une des formules du
ferment de fidélité rapportées dans le livre des libertés
de l’Eglife Gallicanne.
On peut ajouter à cette remarque de M. de la
Feuillie, que le roi Louis le Gros & Louis VII, fon
fils , alors duc d’Aquitaine & comte de Poitou, par
des lettres de l’an 1 1 3 7 , ordonnèrent que les élections,
foit à l’archevêché de Bordeaux, aux évêchés
fuffragans& aux abbayes de cette province, feroient
faites librement fuivant les canons, & que ceux qui
feroient élus ne feraient point hommage pour leurs
bénéfices , ni n’en demanderaient pas l’invieftiture.
Pour ce qui eft du tems où Yhommage lige commença
à être en ufage, les remarques de M. de la
Feuillie nous ayant engagé à faire de notre côté de
nouvelles recherches, nous avons trouvé que l ’hommage
lige étoit déjà ufité en France dès le ix. fiecle.
On voit en effet, dans un diplôme de Charles le
Chauve de l’an 845, rapporté par dom Bouquet dans
fon hifi. de Languedoc , tom, V I I I . p, 4 7 0 , que le
comte Vandrille y eft qualifié homme lige , homo Ligues
; il poffédoit des bénéfices civils & des aïeux ;
on ne fait pas mention de fiefs, l’ufage n’en étoit pas
encore établi ; ainfi Yhommage lige a commencé Ipng-
tems avant les inféodations, & étoit dû pour les bénéfices
civils qui avoient été concédés à cette condition
, 011 pour lçs aïeux qui étoient convertis en
bénéfices par le moyen des recommandations ufi-
tées fous les deux premières races , & dont l’effet
étoit que le poffeffeur d’un aleu fe mettoit fous la
proteâion de quelque feigneur puiffant, & fe ren-
doit fon homme.
On voit dans un ancien hommage rendu à un feigneur
de Beaujeu, qu’en figne de fief lige, le vaflal
toucha de fâ main dans celle du procureur général
du feigneur.
Les femmes faifôient aufii Yhommage lige. On voit,
par exemple, dans un terrier de 1 3 5 1 , qu’à Chala-
mont & Dombes , une femme fe reconnut femme
lige , quoique fpn mari fût homme de noble homme
Philippe le Melle.
Depuis l’abolition des guerres p rivées, Yhommage
lige n’eft proprement dû qu’au roi ; quand il eft rendu
au roi Ô£ autres grands feigneurs, il faut excepter
le roi.
L’hommage lige doit être rendu en perfonne , de
quelque condition que foit le vaflal. (A )
H o m m a g e de f q i & d e s e r v ic e eft lorfque
le vafial s?oblige de rendre quelque fervice de fon
propre corps à Ion feigneur, comme autrefois lorsqu'il
s’obligeoit de lui fervir de champion , ou de
combattre pour lui en cas de gage de bataille. Voye^
l'ancienne coutume de Normandie latine & françotfe, ch.
xxix. Bouteillier dansfafomme rurale, pag. 4y<). (A )
H o m m a g e de pa ix , fuivant l’ancienne coûtu-
me de Normandie, ch. xxix. c’eft quand quelqu’un
pourfuit un autre pour un crime , & que la paix eft
rétablie entre eux de maniéré que celui qui étoit
pourfuivi fait hommage à l’autre de lui garder la paix.
Voye^ Bouteillier dans fa fomme , p. 41g , & la glofe
fur le ch. xxix. de l ’ancienne coutume de Normandie.
WH o m m a g e pla ne ou pl e in eft la même chofe
qu’hommage lige, comme on le voit dans les coûtu-
mes de la Rochelle, art. 4. Ponthieu, 7 7 . Amiens ,
art. y. z 5. 186. & 18$. Voye[ Bruffelle, ufage des
fiefs. Voye{ H o m m a g e l ig e . (A )
Ho m m a g e s im p l e eft celui où il n’y a pas de
preftation de fo i , mais feulement Yhommage qui fe
rend au feigneur nue tê te , les mains jointes avec le
baifer. On l’appelle Jimple par oppofition à la foi &
à Yhommage que le vafial doit faire les mains jointes
fur les évangiles avec les fermens requis. Voyeç
Ho m m a g e l ig e . (A )
HOMMAGER, f. m. ( Jurifprud.) eft celui qui doit
hommage au feigneur ; ce terme eft ufité dans quelques
coûtümes & provinces de droit écrit, pour lignifier
un vaflal, Voye^ Cambolas, liv. I V , chap. xliv.
Dolive , liv. I . ch. x x ix . (A )
* HOMME, f. m. c’eft un être Sentant, réfléchif-
fant, penfant, qui fe promene librement fur la fur-
face de la terre, qui paroît être à la tête de tous les
autres animaux fur lefquels il domine, qui vit en fo-
ciété, qui a inventé des fciences & des arts , qui a
une bonté & une méchanceté qui lui eft propre, qui
s’eft donné des maîtres, qui s’eft fait des lo is , &c.
On peut le confidérer fous différens afpefts, dont
les principaux formeront les articles fuivans.
Il eft compofé de deux fubftances, l’une qu’on appelle
ame (Voyeç tarticle Am e ) , l’autre connue fous
le nom de corps.
Le corps ou la partie matérielle de l’homme a été
beaucoup étudiée. On a donné le nom d’Anatomifies
à
à ceux qui fe font occupés de ce travail important
& pénible. Voye5; l ’article Ho m m e , (Anatomie.)
On a fuivi l’homme depuis le moment de fa formation
ou de fa vie , jufqu’à l’inftant de fa mort. C’eft
ce qui forme l’hiftoire naturelle de Y homme. Voye{
l'article HOMME, (Hifioirc naturelle.)
On l’a confidéré comme capable de différentes
opérations intellectuelles qui le rendent bon ou méchant,
utile ou nuifible, bien ou mal faifant. Voye1
l'article H om m e moral.
D e cet état folitaire ou individuel, on a paffé à
fon état de fociété , & l’on a propofé quelques principes
généraux, d’après lefquels la puiffance fouve-
raine qui le gouverne , tireroit de l 'homme le plus
d’avantages poflibles ; & l ’on a donné à cet article
le titre d’homme politique.
On auroitpû multiplier à l’infini les différens coups
d’oeil fous lefquels Y homme fe confidéreroit. Il fe lie
par fa curiofite, par fes travaux & par fes befoins,
à toutes les parties de la nature. Il n’y a rien qu’on
ne puiffe lui rapporter ; & c’eft ce dont on peut s’af-
furer en parcourant les différens articles de cet Ouvrage
, où on le verra ou s’appliquant à connoître
les êtres qui l ’environnent, ou travaillant à les tourner
à fon ufage.
* H om m e , (Hifi. nat.) L’homme reffemble aux
animaux par ce qu’il a de matériel ; & lorfqu’on fe
propofe de lé comprendre dans l’énumération de
tous les êtres naturels, on eft forcé de le mettre dans
la claffe des animaux. Meilleur & plus méchant
qu’aucun, il mérite à ce double titre, d’être à la tête.
Nous ne commencerons fon hiftoire qu’après le
moment de fa naifiance ; pour ce qui l’a précédé ,
•yoye{ lés articles FOETUS , EMBRYON , ACCOUCHEMENT,
C o n c e p t io n , G rossesse , &c.
\Jhomme communique fa penfée par la parole, &
ce figne eft commun à toute l’efpece. Si les animaux
ne parlent point, ce n’eft pas en eux la faute de l’organe
de la parole , mais l’impofiibilité de lier des
idées. Voye[ La ng ue.
L ’homme naiflant paffe d’un élément dans un, autre.
Au fortir de l’eau qui l’environnoit, il fe trouve
expofé à l’air ; il refpire. Il vivoit avant cette aétion ;
il meurt fi elle ceffe. La plûpart des animaux reftent
les yeux fermés pendant quelques jours après leur
naifiance. L’homme les ouvre auflitôt qu’il eft né;
mais ils font fixes & ternes. Sa prunelle qui a déjà
jufqu’à une ligne & demie ou deux de diamètre, s’étrécit
ou s’élargit à une lumière plus forte ou plus
foible ; mais s’il en a le fentiment, il eft fort obtus.
Sa cornée eft ridée ; fa rétine trop molle pour recevoir
les images des objets. Il paroît en être de même
des autres fens. Ce font des efpecesd’inftrumens dont
il faut apprendre à fe fervir. Voye[ Sens. Le toucher
n’eft pas parfait dans l’enfance. V. T o u c h e r .
L ’homme ne rit qu’au bout de quarante jours : c’eft
aufii le tems auquel il commence à pleurer. Voye£
R is & Pleurs. On ne voit auparavant aucun figne
de paflronfur fon vifage. Voye1 Pa s sio n . Les autres
parties de fon çorps font foibles & délicates. Il ne
peut fe tenir debout. Il n’a pas la force d’étendre le
bras. Si on l’abandonnoit il refteroit couché fur le
dos fans pouvoir fe retourner.
La grandeur de l’enfant né à terme eft ordinairement
de vingt-un pouces. Il en naît de beaucoup
plus petits. Il y en a même qui n’ont que quatorze
pouces à neuf mois. Le foetus pefe ordinairement
douze livres, & quelquefois jufqu’à quatorze. Il a la
tete plus greffe à proportion que le refte du corps ;
& cette difproportion qui étoit encore plus grande
dans le premier âge du foetus, ne difparoît qu’après
la première enfance. Sa peau eft fort fine, elle paroît
rougeâtre ; au bout de trois jours il furvient une jau-
Tome V III«
niffe, & l’enfant ad u la it dans les mamelles : on l’exprime
avec les doigts. Voye{ Foe t u s .
On voit palpiter dans quelques nouveaux.-nés le
fommet de la tête à l’endroit de la fontanelle, &
dans tous on y peutfentir avec la main le battement
des finus ou des arteres du cerveau. Voyez Fo n t a n
e l l e . Il fe forme au-deffus de cette ouverture une
efpece de croûte ou de galle quelquefois fort épaiffe.
La liqueur contenue dans l’amnios laiffe fur l’enfant
une humeur vifqueufe blanchâtre. Voye£ Am-
nios; On le lave ici avec une liqueur tiede ; ailleurs,
& meme dans des climats glacés, on le plonge dans
l’eau froide , ou on le dépofe dans la neige.
Quelque tems après fa naifiance, l’enfant urine
&rend le méconium. Voye^ Mé c o n iu m . Le méconium
eft noir. Le deuxieme ou troifieme jour, les
excremens changent de couleur & prennent une
odeur plus mauvaife. On ne le fait tetter que dix ou
douze heures après fa naifiance.
A peine eft-il forti du fein de fa mere, que fa captivité
commence. On l’emmaillote,ufage barbare des
feuls peuples policés. Un. homme robufte prendroit la
fievre , fi on le tenoit ainfi garotté pendant vingt-
quatre heures. Voye^ Ma il l o t .
L’enfant nouveau-né dort beaucoup, mais la douleur
& le befoin interrompent fouvent fon fommeil.
Les peuples de l’Amérique feptentrionale le couchent
fur la poufîiere du bois vermoulu, forte de lit
propre & mou. En Virginie on l’attaché fur une
planche garnie de coton, & percée pour l’écoulement
des excrémens.
Dans le levant, on allaite à la mamelle les en-
fans pendant un an entier. Les fauvages du Canada
leur continuent cette nourriture jufqu’à l’âge de quatre
à cinq ans, quelquefois julqu’à fix ou lèpt. Parmi
nous, la nourrice joint à fon lait un peu de bouillie
, aliment indigefte & pernicieux. Il vaudrait
miqux qu’elle fubftituât le pis d’un animal, ou qu’elle
mâchât pour fon nourrifion, julqu’à ce qu’il eut des
dents,
Les dents qu’on appelle incifives, font au nombre
de huit, quatre au-devant de chaque mâchoire. Elles
ne parùiffent qu’à fept mois, "ou même fur la fin de
la première année. Mais il y en a en qui ce développement
eft prématuré, & qui naiffent avec des dents
affezfortes pour bleffer le lein de leurs mères. Voye{
l ’article D en t s.
Les dents incifives ne percent pas fans douleun
Les canines, au nombre de quatre, fortent dans le
neuvième ou dixième mois : il en paroît feize autres
fur la fin de la première année, ou au commencement
de la fécondé. On les appelle molaires ou ma-
chelieres. Les canines font contiguës aux incifives ,
& les machelieres aux canines.
Les dents incifives, les canines, & les quatre
premières mâchelieres, tombent naturellement dans
l’intervalle de la cinquième à la huitième année ;
elles font remplacées par d’autres dont la fortie eft
quelquefois différée jufqu’à l’âge de puberté.
Il y a encore quatre dents placées à chacune des
deux extrémités des mâchoires ; elles manquent à
plufieurs perfonnes, & Ie développement en eft fort
tardif ; il né fe fait qu’à l’âge de puberté, & quelquefois
dans un terme plus éloigné ; on- les appelle dents
de fagejfe ; elles paroiflent lucceffivement.
U homme apporte communément des cheveux en
naiflant ; ceux qui doivent être blonds, ont les yeux
bleus; les roux d’un jaune ardent, & les bruns d’un
jaune foible. Voye[ C h e v eu x .
L’enfant eft fujet aux vers & à la vermine ; c’eft
un effet de fa première nourriture ; il eft moins fen-
fible au froid que dans le refte de fa vie ; il a le poulx
plus fréquent ; en général le battement du coeur &
des arteres eft d’autant plus v îte , que l’animal eft
K k