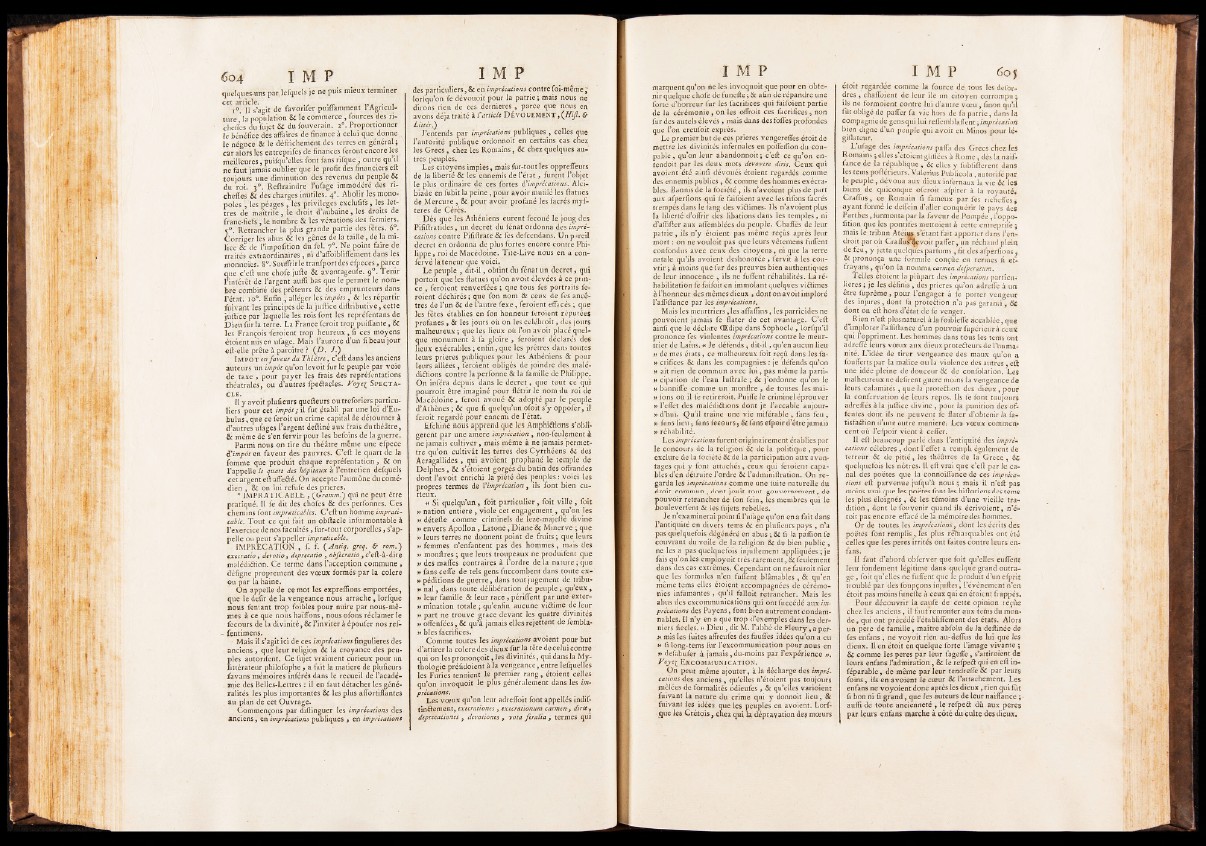
quelques-uns par lefquels je ne puis mieux terminer
cet article. „ . . .
i° . Il s’agit de favorifer puiflamment 1 Agriculture
,* la population 6c le commerce , fources des ri-
chefles du fujet & du fouverain. 2°. Proportionner
le bénéfice des affaires de finance à celui que donne N
le négoce & le défrichement des terres en général ;
car alors les entreprifes de finances feront encore les
meilleuresj puifqu’ellei font fans rifque, outre qu’il
ne faut jamais oublier que le profit des financiers eft
toujours une diminution des revenus du peuple 6c
du roi. 30. Reftraindre l’ufage immodéré des ri-
chefïes & des charges inutiles. 40. Abolir les monopoles
, les péages , les privilèges exclufifs, les lettres
de maîtrife, le droit d aubaine, les droits de
franc-fiefs., le nombre & les véxations des fermiers.
50. Retrancher la plus grande partie des fêtes. 6°.
Corriger lès abus & les gênes de la taille, dé la milice
6? de l’impofition du fel. 7°. Ne point faire de
traités extraordinaires , ni d’affoibliffement dans les
monnoiès. 8°. Souffrir le tranfportdes efpeces, parce
que c’eft une chofe.jufte 6c avantageufe. 90. Tenir
rinférêt de. l’argent auffi bas que le permet le nombre
combiné des prêteurs 6c des emprunteurs dans
l'état. 1b0. Enfin , alléger les impôts , & les répartir
fuivant les principes de la juftice diftributive, cette
juftice par laquelle les rois font les repréfentans de
Dieu fur la terre. La France feroit trop puiffante, &
les François.■ feroient trop heureux, fi ces moyens
étoient mis en ufage. Mais l’aurore d’un fi beau jour
eft-elle prête à paroître ? (Z>. /.) Im pô t en faveur du Théâtre, c’eft dans les anciens
auteurs un impôt qu’on levoit fur le peuple par voie
de taxe , pour payer les frais des repréfentations
théâtrales, ou d’autres fpeftacles. Foye^ Specta-
cle. '
U y avoit plufieurs quefteurs outreforiërs particuliers
pour cet impôt; il fut établi par une loi d’Eu-
bulus, que ce feroit un crime capital de détourner à
d’autres ufages l’argent deftiné aux frais du théâtre,
& même de s’en fervir pour les befoins de la guerre.
Parmi nous on tire du théâtre même une efpece
d'impôt en faveur des pauvres. G’eft le quart de la
fomme que produit chaque repréfentation, & on
l’appelle le quart des hôpitaux à l’entretien defquels
cet argent eft affe£té. On accepte l’aumône du comédien
, 6c on lui refufe des prières.
* IMPRATICABLE , (Gramm.') qui ne peut être
pratiqué. Il fe dit des chofes 6c des perfonnes. Ces
chemins font impraticables. C ’eft un homme Impraticable.
Tout ce qui fait un obftacle infurmontable à
l ’exercice de nos facultés, fur-tout corporelles, s’appelle
ou peut s’appeller impraticable.
IMPRÉCATION , f. f. ( Antiq. greq. & rom.')
execratio, devotio, deprecatio , obfecratio , c’eft-à-dire
malédiôion. Ce terme dans l’acception commune ,
défigne proprement des voeux formés par la colere
ou par la haine.
On appelle de ce mot les expreflions emportées,
que le defir de la vengeance nous arrache, lorfque
nous fentant trop foibles pour nuire par nous-mêmes
à ce que nous haiffons, nous ofons réclamer le
fecours de la divinité, 6c l’inviter à époufer nos ref-
- fentimens.
• Mais il s’agit ici de ces imprécations fingulieres des
anciens, que leur religion 6c la croyance des peuples
autorifent. Ce fujet vraiment curieux pour un
littérateur phiiofophe, a fait la matière de plufieurs
lavans mémoires inférés dans le recueil de l’académie
des Belles-Lettres : il en faut détacher les généralités
les plus importantes 6c les plus affortiffantes
au plan de cet Ouvrage.
Commençons par diftinguer les imprécations des
anciens, en imprécations publiques , en imprécations
des particuliers, 6c en imprécations contre foi-même ;
lorfqu’on fe dévouoit pour la patrie ; mais nous ne
dirons rien de ces dérnieres , parce que nous en
avons déjà traité à Üàrticle D évouement , (JliJl. &
Littér?)
J’entends par imprécations publiques , celles que
l’autorité publique ordonnoit en certains cas chez
les Grecs, chez les Romains, 6c chez quelques autres
peuples.
Les citoyens impies, mais fur-tout les opprefleurs
de la liberté 6c les ennemis de l’état , furent l’pbjet
le plus ordinaire de ces fortes à’imprécations. Alcibiade
en fubit la peine , pour avoir mutilé les ftatucs
de Mercure , & pour avoir profané les facrés myf-
teres de Cérès.
Dès que les Athéniens eurent fecôué le joug des
Pififtratidés, un decret du fénat ordonna des imprécations
contre Pififtrate 6c fes defeendans. Un pareil
decret en ordonna de plus fortes encore contre Philippe,
roi de Macédoine. Tite-Live nous en a con-
fervé la teneur que voici.
Le peuple , dit-il, obtint du fénat un decret, qui
portoit que les ftatues qu’on avoit élevées à ce prince
, feroient renverfées ; que tous fes portraits feroient
déchirés ; que fon nom & ceux de fes ancêtres
de l’un 6c de l’autre fexe, feroient effacés ; que
les fêtes établies en fon honneur feroient réputées
profanes , & les jours oit on les çélébroit, des jours
malheureux ; que les lieux pù l’on avoit placé quelque
monument à fa gloire , feroient déclarés des
lieux exécrables ; enfin, que les prêtres dans toutes
leurs prières publiques pour les Athéniens & pour
leurs alliées, feroient obligés de joindre des malé-
dittions contre la perfonne & la famille de Philippe.
On inféra depuis dans le decret, que tout ce qui
pourroit être imaginé pour flétrir le nom du roi de
Macédoine, feroit avoué & adopté par le peuple
d’Athènes ; 6c que fi quelqu’un ofoit s’y oppofer, il
feroit regardé pour ennemi de l’état.
Efchine nous apprend que les Amphiâions s’obligèrent
par une amere imprécation, non-feulement à
ne jamais cultiver, mais même à ne jamais permettre
qu’on cultivât les terres des Cyrrhéens 6c des
Acragallides , qui avôient prophané le temple de
Delphes, 6c s’étoient gorgés du butin des offrandes
dont l’avoit enrichi la piété des peuples : voici les
propres termes de l’imprécation, ils font bien curieux.
« Si quelqu’u n , foit particulier, foit ville , foit
» nation entière , viole cet engagement, qu’on les
» dételle comme criminels de leze-majefté divine
» envers Apollon , Latone, Diane & Minerve ; que
>» leurs terres ne donnent point de fruits ; que leurs
» femmes n’enfantent pas des hommes, mais des
» monftres ; que leurs troupeaux ne produifent que
» des maffes contraires à l’ordre de la nature ; que
» fans ceffe de tels gens fuccombent dans toute ex-
» péditions de guerre, dans tout jugement de tribu-
» nal, dans toute délibération de peuple ; qu’eu x ,
» leur famille & leur race, périffent par une exter-
» mination totale ; qu’enfin aucune viftime de leur
» part ne trouve grâce devant les quatre divinités
» offenfées, 6c qu’à jamais elles rejettent de fembla-
» blés facrifices.
Comme toutes les imprécations avoient pour but
d’attirer la colere des dieux fur la tête de celui contre
qui on les prononçoit, les divinités, qui dans la Mythologie
préfxdoient à la vengeance, entre lefquelles
les Furies tenoient le premier rang, étoient celles
qu’on invoquoit le plus généralement dans les imprécations.
Les voeux qu’on leur adreffoit font appellés indif-
tintement, execrationes , execrationum carmen , dirce ,
deprecationes , devotiones , vota feralia , termes qui
marquent qu’on ne les invoquoit que pour en obtenir
quelque chofe de funefte ; & afin de répandre une
forte d’horreur fur les facrifices qui faifoient partie
de la cérémonie , on les offrpit ces facrifices * non
fur des autels élevés, mais dans des folles profondes
que l’on creufoit exprès.
Le premier but de ces prières vengereffes étoit de
mettre les divinités infernales en pofl'eflîon du coupable
, qu’on leur abandonnoit ; c’eft ce qu’on en-
tendoit par les deux mots devovere diris. Ceux qui
avoient été aiofi dévoués étoient regardés comme
des ennemis publics , 6c comme des hommes exécrables.
Bannis de la fociété , ils n’a voient plus de part
aux afperfions qui fe faifoient avec les tifons facrés
trempés dans le fang des viâimes. Ils n’avoient plus
la liberté d’offrir des libations dans les temples, ni
d’aflifter aux affemblées du peuple. Chaffés de leur
patrie, ils n’y étoient pas même reçus après leur
mort : on ne vouloit pas que leurs vêtemens fuffent
confondus avec ceux des citoyens, ni que la terre
natale qu’ils avoient déshonorée, fervît à les couvrir
; à moins que fur des preuves bien authentiques
de leur innocence , ils ne fuffent réhabilités. La réhabilitation
fe faifoit en immolant quelques viélimés
à l’honneur des mêmes dieux , dont on avoit imploré
l’alîïftance par les imprécations.
Mais les meurtriers, les affafiîns, les parricides ne
pouvoient jamais fe flater de cet avantage. C ’eft
ainfi que le déclare OEdipe dans Sophocle, lorfqu’il
prononce fes violentes imprécations contre le meurtrier
de Laïus. « Je défends, d it- ilq u ’en aucun lieu
» de mes états, ce malheureux foit reçu dans les fa-
» crifices 6c dans les compagnies : je défends qu’on
» ait rien de commun avec lu i, pas même la parti-
» cipation de l’eau luftrale ; 6c j’ordonne qu’on le
» banniffe comme un monflre , de toutes les mai-
» fons où il fe retireroit. Piaffe le criminel éprouver
» l’effet des malédiâions dont je l’accable aujour-
» d’hui. Qu’il traîne une vie miférable , fans feu ,
» fans lieu , fans fecours, & fans efpoir d’être jamais
» réhabilité.
Les imprécations furent originairement établies par
le concours de la religion1 6c de la politique , pour
exclure de la fociété 6c de la participation aux avantages
qui y font attachés, ceux qui feroient capables
d’en détruire l’ordre 6c l’adminiftration. On regarda
les imprécations comme une luire naturelle du
droit commun , dont jouit tout gouvernement, de
pouvoir retrancher de fon fein, les membres qui le
bouleverfent & les fùjets rebelles.
Je n’examinerai point fi l’ufage qu’on en a fait dans
l’antiquité en divers tems & en plufieurs pays , n’a
pas quelquefois dégénéré en abus ; 6c fi la paflion fe
couvrant du voile de la religion 6c du bien public ,
ne les a pas quelquefois injuftement appliquées ; je
fais qu’on les employoit très-rarement, 6c feulement
dans des cas extrêmes. Cependant on nefauroit nier
que les- formules n’en fuffent blâmables , & qu’en
même tems elles étoiçnt accompagnées de cérémonies
infamantes, qu’il falloit retrancher. Mais les
abus des excommunications qui ontfuccédé aux imprécations
des Payens, font bien autrement condamnables.
Il n’y en a que trop d’exemples dans les derniers
fiecles. « Dieu , dit M. l’abbé de Fleury, a per-
.» mis les fuites affreufes des fauffes idées qu’on a eu
» fi long-tems fur l’excommunication pour nous en
» defabufer à jamais, du-moins par l ’expérience »,
Voye1 Excommunication.
On peut même ajouter, à la décharge des imprécations
des anciens , qu’elles n’étoient pas toujours
jnelees de formalités odieufes , & qu’elles varioient
fuivant la nature du crime qui y donnoit lieu , &
fuivant les idées que les peuples en avoient. Lorfque
les C retois, chez qui la dépravation de? moeurs
étoit regardée comme la fource de tous les defor-
dres ; chaffoient de leur île un citoyen corrompu ;
ils ne formoient contre lui d'autre voeu , linon qu’il
fût obligé de paffer fa vie hors de fa patrie, dans la
compagnie de gens qui lui reffemblaffent ; imprécation
bien digne d’un peuple qui avoit eu Minos pour lé-
giflateur.
L’ufage des imprécations paffa des Grecs chez les
Romains ; elles s etoient gbllées à Rome, dès la naif-
fance de la république, 6c elles y fubfifterent dans
les tems poftérïeurs. Valerius Publicola, autorifé par
le peuple, dévoua aux dieux infernaux la vie 6c Ie$
biens de quiconque ©feroit afpirer à la royautés
Craffus, ce Romain fi fameux par fes richeffes $
ayant forme le deffein d’aller conquérir le pays des
Parthes, furmonta par la faveur de Pompée , l’oppo-
fition que les pontifes mettoient à cette entreprilë ;
mais le tribun Atéiws s’étant fait apporter dans l’endroit
par où Crallusqievoir paffer, un réchaud plein
de feu , y jetta quelques parfums , fit des afperfions
& prononça une formule conçue en rennes fi ef-
frayans, qu’on la nomma carmen defperatum.
Telles etoient la plupart des imprécations particulières
; je les définis , des prières qu’on adreffe à un
être fuprême, pour l’engager à fe porter vengeur
des injures, dont fa proteélion n’a pas garanti, 6c
dont on eft hors d’état de fe venger.
Rien n’eft plus naturel à la foibleffe accablée, que
d’implorer l’affiftance d’un pouvoir fupéiieur à ceux
qui l'oppriment. Les hommes dans tous les tems ont
adreffé leurs voeux aux dieux protefteurs de l’humanité.
L’idée de tirer vengeance des maux qu’on a
foufferts par la malice ou la violence des autres , eft
une idée pleine de douceur & de confblation. Les
malheureux ne défirent guere moins la vengeance de
leurs calamités , que la proteétion des dieux , pouf
la confervation de leurs repos. Ils fe font toujours
adreffés à la juftice divine , pour la punition des of-
f en les dont ils ne peuvent fe flater d’obtenir la fa-
tisfaflion d’une autre maniéré. Les voeux cofnmen*
cent où l’efpoir vient à ceffer.
II eft beaucoup parlé dans l’antiquité des impré*
cations célébrés , dont l’effet a rempli également dè
terreur 6c de pitié, les théâtres de la Grece , 8c
quelquefois les nôtres. Il eft vrai que c’eft par le canal
des poètes que la connoiffance de ces imprécations
eft parvenue jufqu’à nous ; mais il n’ell pas
moins vrai que les poètes font les hiftoriens des tems
les plus, éloignés , 6c les témoins d’une vieille tradition
, dont le fouvenir quand ils écrivoient, n’é-
toit pas encore effacé de la mémoire des hommes.
Or de toutes les imprécations., dont les écrits des
poètes font remplis, les plus rêTharquables ont été
celles que les peres irrités ont Faites contre Leurs en-
fans.
Il faut d’abord obfervèr que foit qu’elles euffertt
leur fondement légitime dans quelque grand outrage
, foit qu’ elles ne fuffent que le produit d’un efprit
troublé par des foupçons injuftes, l’événement n’en
étoit pas moins funefte à ceux qui en étoient frappés.
Pour découvrir la caufe de cette opinion reçu©
chez les anciens, il faut remonter aux teftts du monde
, qui ont précédé l’établiffement des états. Alors
un pere de famille, maître abfolu de la deftinée de
fes enfans , ne voyoit rien au-deffus de lui que les
dieux. li en étoit en quelque forte l’image vivante ;
6c comme les peres par leur fageffe, s’attiroient de
leurs enfans l’admiration, & le refpe& qui en eft in-
féparable, de même par leur tendreffe & par leurs
foins,.ils en avoient le coeur & l’attachement. Les
enfans ne voyoient donc après les dieux, rien qui fût
fi bon ni fi grand, que les auteurs de leur naiffance ;
| aufli de toute ancienneté , le refpeâ dû aux pere$
par leurs enfans marche à côté du culte des dieux.