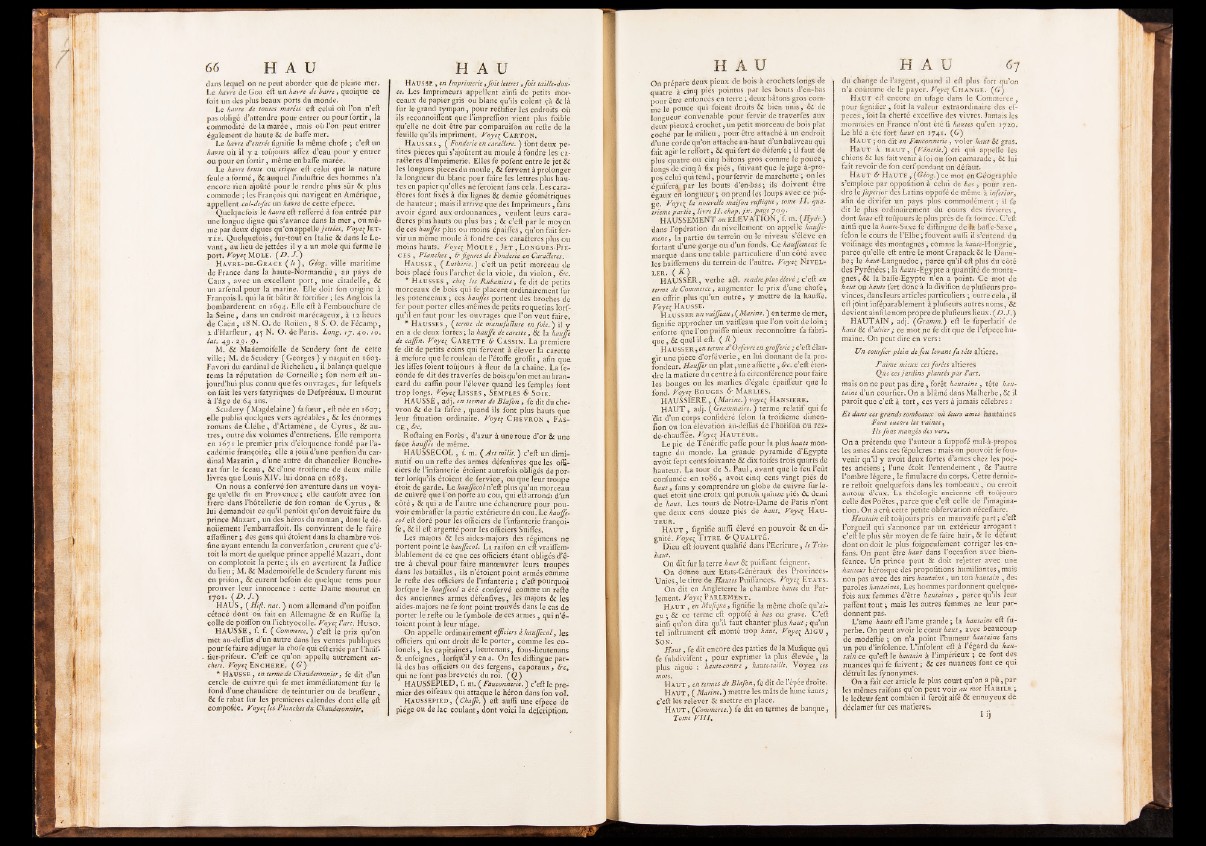
dans lequel on ne peut aborder que de pleine mer.
Le havre de Goa eft un havre de barre, quoique ce
foit un des plus beaux ports du monde.
Le havre de toutes marées eft celui où l’on n’eft
pas obligé d’attendre pour entrer ou pour fértir, la
commodité de la marée , mais où l’on peut entrer
également de haute & de baffe mer.
Le havre d'entrée lignifie la même chofe ; c’eft un
havre où il y a toujours affez d’eau pour y entrer
ou pour en fortir, même en baffe marée.
Le havre brute ou crique eft celui que la nature
feule a formé, & auquel l’induftrie des hommes n’a
encore rien ajoùté pour le rendre plus sûr & plus
commode ; les François qui navigent en Amérique,
appellent cul-de-J'ac un havre de cette efpece. '
Quelquefois le havre eft refferré à fon entrée par
une longue digue qui s’avance dans la mer, ou même
par deux digues qu’on appelle jettées. Foye^ Jet-
tée. Quelquefois, fur-tout en Italie & dans le Levant
, au lieu de jettées il y a un mole qui ferme le
port. Foye{ Mole. (D .J . ) Havre-de-Grace ( l e ) , Géog. ville maritime
de France dans la haute-Normandie, au pâÿs de
C a u x , avec un excellent port, une citadelle, &
lin arfenal pour la marine. Elle doit fon origine à
François I. qui la fit bâtir & fortifier ; les Anglois la
bombardèrent en 1694. Elle eft à l’embouchure dé
la Seine, dans un endroit marécageux, à 12 lieues
de Caën, 18 N. O. de Rouen, 8 S. O. de Fécamp,
2 d’Harfleur, 45 N. O. de Paris. Long. iy. 4 0 .10.
1 * 1 .4 9 . 1 9 .9 .
M. & Mademoifelle de Scudery font de cette
ville ; M. de Scudery (Georges ) y naquit en 1603.
Favori du cardinal de Richelieu, il balança quelque
teins la réputation de Corneille ; fon nom eft aujourd’hui
plus connu que fes ouvrages, fur lefquels
on fait les vers fatyriques de Defpréaux. Il mourut
à l’âge de 64 ans.
Scudery (Magdelaine ) fafoeur, eft née en 1607;
elle publia quelques vers agréables, & les énormes
romans d eC lé lie , d’Artamène, de Cyru s , & autres
, outre dix volumes d’entretiens. Elle remporta
en 1671 le premier prix d’éloquence fondé par l’académie
françoife; elle a joiii d’une penfion du cardinal
Mazarin, d’une autre du chancelier Bouche-
rat fur le fceau, & d’une troifieme de deux mille
livres que Louis XIV. lui donna en 1683.
On nous a confervé fon aventure dans un voyage
qu’elle fit en Provence ; elle caufoit avec Ion
frere dans l’hôtellerie de fon roman de Cyrus , &
lui demandoit ce qu’il penfoit qu’on devoit faire du
prince Mazart, un des héros du roman, dont le dénouement
l’embarraffoit. Ils convinrent de le faire
affafliner ; des gens qui étoient dans la chambre voi-
fine ayant entendu la converfation, crurent que c’é-
toit la mort de quelque prince appellé Mazart, dont
on complotoit la perte ; ils en avertirent la Juftice
du lieu ; M. & Mademoifelle de Scudery furent mis
en prifon, & eurent befoin de quelque tems pour
prouver leur innocence : cette Dame mourut en
1701. ( D . J . )
HAUS, ( Hift. nat. ) nom allemand d’un poiffon
cétacé dont on fait en Allemagne & en Ruffie la
colle de poiffon ou l’ichtyocolle. Foyt{ Part. Huso.
HAUSSE, f. f. ( Commerce. ) e’eft le prix qu’on
met au-deffüs d’un autre dans les ventés publiques
pour fe faire adjugèr la chofe qui eft criée par l’huif-
fier-prifeur. C’eft ce qu’on appelle autrement enchère.
Foye[ Enchère. (G )
* Hausse , en terme de Chauderonnier, fe dit d’un
cercle de cuivre qui fe met immédiatement fur le
fond d’une chaudière de teinturier ou de braffeur,
& fe rabat fur les premières calendes dont elle eft
compofée. Voyelles Planches du Chauderonnier.
HAUSSE , en Imprimerie, foit lettres ,foit taille-douce.
Les ceaux deIm pparpiimere gurriss aopup eblllaennct qauin’iflsi cdoe lepnett itçsà m&o lrà
iflusr rleec ognrannodif fteynmt pqaune, lp’imouprr erfelâioifni evri elenst epnldurso iftosi bolùe
fqeuu’iellllee qnue’ ildso iimt pêrtirme epnatr. comparaifon au refte de la Foye[ Carton.
Hausses , ( Fonderie en caractère. ) font deux petites
pièces qui s’ajoutent au moule à fondre les caractères
d’imprimerie. Elles fe pofent entre le jet &
les longues pièces du moule, & fervent à prolonger
la longueur du blanc pour faire les lettres plus hautes
en papier qu’elles ne feroient fans cela. Les caractères
font fixés à dix lignes & demie géométriques
de hauteur ; mais il arrive que des Imprimeurs, fans
avoir égard aux ordonnances, veulent leurs caractères
plus hauts ou plus bas ; & c’eft par le moyen
de ces haujfes plus ou moins épaiffes, qu’on fait fer-
vir un même moule à fondre ces caraCteres plus ou
moins hauts. Foye{ Moule , Jet , Longues-Pie-
C ES , Planches , & figures de Fonderie en Caractères. Hausse, ( Lutherie.) c’eft un petit morceau de
bois placé fous l’archet de la viole , du violon, &c. mo*r cHeaauuxs sdees b ,o icsh eqçu ile fse R pulbaacnenietr os,r dfien adiirte dmee npte tfiutsr les potenceaux ; ces haujfes portent des broches de
fqeur’ ipl oenu rf apuotr tpeoru erl lleess mOêumverasg dees pqeutiet sl ’roonq uveetuint sf aloirref.-
* HAUSSES , ( terme de manufacture en foie.') il y
en a de deux fortes ; la hauJJ'e de carette, & la hauffe
de cajjin. Foye1 Carette & CassiN. La première
fe dit de petits coins qui fervent à élever la carette
à mefure que le rouleau de l’ étoffe groflît, afin que.
les liffes foient toûjours à fleur de la chaîne. La fécondé
fe dit des traverfes de bois qu’on met au brancard
du caflin pour l’élever quand les femples font
trop longs. Foye{ Lisses , Semples & Soie.
HAUSSÉ, adj. en termes de Blafon, fe dit du chelveruorn
f<u daeti olan foarfdeein ,a iqruea. nd ils font plus hauts que Foye^ Chevron , Fas-
ce , &c.
Roftaing en Forés, d’azur à une roue d’or & une
face hauffèe de même.
HAUSSECOL , f. m. (A r t milit. ) c’eft un diminutif
ou un refte des armes défenfives que les officiers
de l’infanterie étoient autrefois obligés de porter
lorfqu’ils étoient de fervice, ou que leur troupe
étoit de garde. Le hauffecol n’eft plus qu’un morceau
de cuivre que l’on porte au cou, qui eft arrondi d’un
cô té , & qui a de l’autre une échancrure pour pouvoir
embraffer la partie extérieure du cou. Le hauffecol
eft doré pour les officiers de l’infanterie françoife
, & il eft argenté pour les officiers Suiffes.
Les majors & les aides-majors des régimens ne
portent point le hauffecol. La raifon en eft vraiffem-
blablement de ce que ces officiers étant obligés d’être
à cheval pour faire manoeuvrer leurs troupes
dans les batailles, ils n’étoient point armés comme
le refte des officiers de l’infanterie ; c’eft pourquoi
lorfque le hauffecol a été confervé comme un refte
des anciennes armes défenfives, les majors & les
aides-majors ne fe font point trouvés dans le cas de
porter le refte ou le fymbole de ces armes, qui n’étoient
point à leur ufage.
On appelle ordinairement officiers à hauffecol, les
officiers qui ont droit de le porter, comme les colonels
, les capitaines, lieutenans, fous-lieutenans
& enfeignes, lorfqu’il y en a. On les diftingue par-
là des bas officiers ou des fergens, caporaux, &c,
qui ne font pas brevetés du roi. (Q )
HAUSSEPIED, f. m. ( Fauconnerie. ) c’eft le premier
des oifeaux qui attaque le héron dans fon vol. Haussepied, ( Chaffe.) eft aufli une efpece de
piège ou de lac coulant, dont voici la description.
On prépare deux pieux de bois à crochets longs de
quatre à cinq pies pointus par les bouts d’en-bas
pour être enfoncés en terre ; deux bâtons gros comme
le pouce qui foient droits & bien unis, & de
longueur convenable pour fervir de traverfes aux
deux pieux à crochet, un petit morceau de bois plat
coché par le milieu , pour être attaché à un endroit
d’une corde qu’on attache au-haut d’un baliveau qui
fait agir le reffort, & qui fert de défenfe ; il faut de
plus quatre ou cinq bâtons gros comme le poucè -,
longs de cinq à fix piés, fuivant que le juge à-propos
celui qui tend j pour fervir demarchette ; on les
éguifera par les bouts d’en-bâs ; ils doivent être
égaux en longueur ; on prend lés loups avec ce piège.
Foye{ la nouvelle maifon ruflique, tome I I . quatrième
partie, livre II. chap.jx. page y 09.
HAUSSEMENT ou ÉLÉVATION, f. m. (.Hydr.)
dans l’opération du nivellement on appelle hautement,
la partie du terrein ou le niveau s’élève en
fortant d’une gorge ou d’un fonds. Ce hauffement fe
marque dans une table particulière d’un côté avec
les baiffemens du terrein de l’autre. Foyei Nivel-
ler. ( K-) HAUSSER, verbe a£t. rendre plus élevé ; c’eft en
terme de Commerce, augmenter le prix d’une chofe,
en offrir plus qü’un autre, y mettre de la hauffe.
FoHyeaç uHsaseurs se. . s un vaiffiau, ( Marine. ) en terme de mer,
lignifie approcher un vaiffeau que l’on voit de loin ;
enforte que l’onpuiffe mieux reconnoître fa.fabriqua
, & quel il eft.. ( R )
HAUSSER, en terme d'Orfevre en grofferie ; c’eft élarfgoirn
duenuer p. iece d’orféverie, en lui donnant de la proHauffer
un plat, une afliette, &c. c’eft étendre
la matière du centre à fa circonférence pour faire
les bouges ou les marlies d’égale épaiffeur que le
fond. Fcrye% Bouges <5* Marlies.
HAUSSIERE, (Marine.) voye{ Hansiere,
H A U T , adj. ( Grammaire. ) terme relatif qui fe
dit d’un corps confidéré félon fa troifieme dimen-
fion ou fon élévation au-deffus de l’horifon ou rez- de-chauffée. Foye^ Hauteur.
Le pic de Ténériffe paffe pour la plus haute montagne
du monde. La grande-pyramide d’Egypte
avôit fept cents foixante & dix toifes trois quarts de
hauteur. La tour de S. Paul, avant que le feu l’eût
confumée en 1086, avoiteinq cens vingt piés de
haut y fans y comprendre un globe de cuivre fur lequel
étoit une croix qui portoit quinze piés & demi
de haut. Les tours de Notre-Dame de Paris n’ont
que deux cens douze piés de haut. Fyye{ HauteHur.
. aut , fignifïe aufli élevé en pouvoir & en dignité.
Foye^ T itre & Qualité.
Dieu eft fôuvent qualifié dans l’Ecriture, le Très»
haut.
On dit fur la terre haut & puiffant feigneur.
On dcùinè aux Etats-Générauk des Provinces-
Uniès, le titre de Hautes PuiffanCes. Foye^ Etats.
On dit en Angleterre la chambre haute du ParlemHent.
Foyef9 arlEMent . aut , en Mufque, fignifie la même chofe qu’ai-
gu ; &C ce terme eft oppofé à bas ou grave. C ’eft
ainfi qu’on dira qu’il faut chanter plus haut ; qu’un
tel infiniment eft monté trop haut. Foye{ Aigu ,
Son. . Haut, fe dit encore des parties de la Mufique qui
fe fubdivifent, pour exprimer la plus éle v é e , la
plus aiguë : haute-contre , haute-taille. Voyez ces
mots, , . H H | HHaut , en termes de Blafon, fe dit de l’epee droite. aut , ( Mâtine.) mettre les mâts de hune hauts ;
c’eft les relever & mettre en place. Haut , (Commerce.) fe dit en termes de banque,
Tome F U I .
du change de l’argent, quand il eft plus fort qu’on
n’a coutume de le payer. Foye[ Change. (G} Haut eft encore en ufage dans le Commerce,
pour ftgnifier , foit la valeur extraordinaire des ef-
peces, foit la cherté excefîive des vivres. Jamais les
monnoies en France n’ont été fi hautes qu’en 1720.
Le blé a été fort haut en 1741. (G) Haut ; on dit en Fauconnerie, voler haut & gras.
chiHenasu t à haut , (Vénerief cri qui appelle les fait rev&oi rl edse f faoitn v ceenrifr pàe fnodi aonut fUonn d céafmauatr.ade j & lui Haut & Haute , ÇGéog.) ce mot en Géographie
s’emploie par oppofition à celui de bas , pour rendre
1 efuperior des Latins oppofé de même à inferior,
afin de divifer un pays plus commodément -, il fe
dit le plus ordinairement du cours des rivières,
dont haut eft. toûjours le plus près de fa fource. C ’eft
ainfi que la haute-Saxe fe diftingue de la baffe-Saxe,
félon le cours de l’Elbe ; fouvent aufli il s’entend du
voifinage des montagnes, comme la haute-Wongrie,
parce qu’elle eft entre le mont C rapack & le Danube
; le Aaztf-Languedoc, parce qu’il eft plus du côté
des Pyrénées ; la haute-Egypte a quantité de montagnes
, & la baffe-Egypte n’en a point. Ce mot de
haut ou haute fert donc à la divifion de plufieurs provinces,
dans leurs articles particuliers ; outre ce la, il
eft joint inféparablement à plufieufs autres noms, &
devient ainfi le nom propre de plufieurs lieux. (D J .)
HAUTAIN, adj. (Gramm.) eft le fuperlatif de
haut & d’altier ; ce mot ne fe dit que de l’efpece humaine.
On peut dire en vers :
Un courfier plein de feu levant fa tète altiere.
J'aime mieux ces forêts altieres
Que ces jardins plantés par Part.
mais on ne peut pas dire, forêt hautaine , tête hautaine
d’un courtier. On a blâmé dans Malherbe, & il
paroît que c’eft à tort, ces vers à jamais célébrés :
Et dans ces grands tombeaux où leurs âmes hautaines
Font encore les vaines ,
Ils font mangés des vers.
On a prétendu que l’auteur à fuppofé mal-à-propos
les âmes dans ces fépulcres : mais on pouvoit fe fou-
venir qu’il y avoit deux fortes d’ames chez les poètes
anciens ; l’une étoit l’entendement, & l’autre
l’ombre légère, le fimulacre du corps. Cette dernière
reftoit quelquefois dans lès tombeaux, ou erroit
autour d’eux. La théologie ancienne eft toûjours
celle des Poètes, parce que c’eft celle de l’imagination.
On a crû cette petite obfervation néceffaire.
Hautain eft toûjours pris en mauvaife part ; c’eft
l’orgueil qui s’annonce par un extérieur arrogant î
c ’eft le plus sûr moyen de fe faire haïr, & le defaut
dont on doit le plus foigneufement corriger les en-
fans. On peut être haut dans l’occafion avec bien-
féance. Un prince peut & doit rejetter avec une
hauteur héroïque des propofitions humiliantes, mais
non pas avec des airs hautains, un ton hautain , des
paroles hautaines. Les hommes pardonnent quelquefois
aux femmes d’être hautaines , parce qu’ils leur
paffenttout; mais les autres femmes ne leur par-
donnentpas. . n. r
L’ame haute eft l’ame grande ; la hautaine eft fu-
perbe. On peut avoir le coeur haut, avec beaucoup
de modeftie ; on n’a point l’humeur hautaine fans
un peu d’infoience. L’infolent eft .à 1 egard du hautain
ce qu’eft le hautain à l ’impérieux ; Ce font des
nuances qui fe fuivent ; & ces nuances font ce qui
détruit les fynonymes.
lesO mnê ma efasi rt aciefot nasr tqicul’eo nle p peluuts vcooiurr t qu’on a pû, par au mot Habile ; lé lefteur fent combien il feroit aifé & ennuyeux de déclamer fur ces matières.