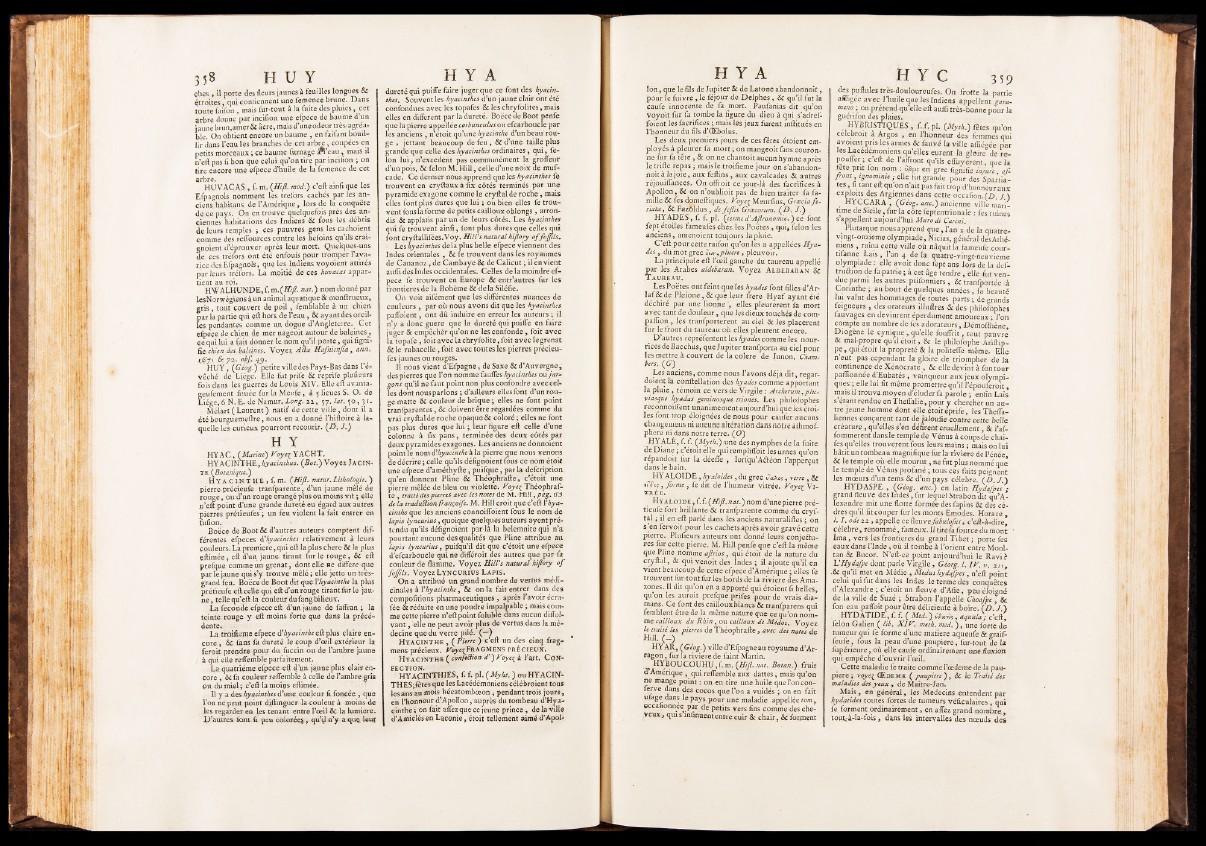
358 H U Y
1 n ■
If
ches , U porte des fleurs jaunes à feu dies langues &
étroites, qui contiennent une femence brune. Dans
toute faifon , mais fur-tout à la fuite des pluies, cet
arbre donne par incifion une efpece de baume d’un
jaune brun,amer & âcre, mais d’une odeur très-agréable.
Qn obtient encore un baume , en faifant bouillir
dans l’eau les branches de eet arbre, coupées en
petits morceaux ; ce baume fumage Èrl’eau, mais il
n’eft pas fl hon que celui qu’on tire par incifion ; on
tire encore une efpece d’huile de la femence de cet
arbre.
HUVAC AS , f. m. (Hiß. mod.) c’eft ainfi que les
EfpagnoJs nomment les trefors cachés par les an-,
çiens habitons, de l’Amérique, lors de la conquête
de ce pays. On en trouve quelquefois près des anciennes
habitations des Indiens & fous les débris
de leurs temples ; çes pauvres gens les cachoient
comme des reflources contre les befoins qu’ils erai-
gnoient d’éprouver après leur mort. Quelques-uns
de ces tréfors ont été enfouis pour tromper l’avariée
des. Efpagnols, que les. Indiens voyaient attirés
par leurs tréfors. La moitié; de ces huvacas appar-?
tient au roi. I
HWALHUNDEjf. m.(Hift. nat.) nom donne par
lesNorwégiens à un animal aquatique & monftrueux,
gris , tout couvert d.e p o il, femblable à un chien
par la partie qui eft hors de l’eau, & ayant des oreilles
pendantes comme un dogue d’Angleterre. Cet
çfpeçe. de chien, d.e mer nageoit autour de baleines^,
ce qui lui a fait donner le nom qu’il porte, qui figm-»
fie chi.cn des baleines. Voyez 4 Àa Hafnicnßa , ann.
L$7J. <>kC’4ß' . . . HU Y , ('Géog.) petite ville des Pays-Bas dans 1 e.-
vêché dé Liégé, Ehe fut prife & reprife plufieurs
fois dans. les. guerres de Louis XIV. Elle eft avanta-
geufement fituée. fu rlaM eu fe, à 5 lieues S. O. de
Liège, 6 N. E. de Namur. Lo/z#. x x , 57. Ut. 50 ,3 1 .
Mélart ( Laurent ) natif de cette v ille , dont il a
été bourguemeftre, nous en a. donné l’hiftoire. à la-.
quelle les. curieux pourront recourir. (JD. J.) H Y H Y A C , (Marine) Voy,c{ YACHT.
HYACINTHE, hyacinthus. (Bot.yVoyez Ja c in -
TE (Botanique.)
H y a c i n t h e , f.m. (Hiß. natur. Lithologie. )
pierre.précieufe tranfparente, d’un jaune mêlé de
rouge, ou d’un rouge orangé plus ou moins v if ; elle
n’eft point d’une grande dureté eu égard aux autres
pierres prétieufes ; tin feu violent la fait entrer en
fufion.
Boëce de Boot & d’autres auteurs comptent différentes
efpeces à’hyacinthes relativement à leurs
couleurs. La prämiere, qui eft la plus chere & la plus
çftimée, eft d’un jaune tirant uir le rouge, & eft
prefque comme un grenat, dont elle He différé que
par le. jaune qui s’y trouve mêlé; elle jette un très-
grand feu. Boëce de Boot dit que Vhyacinthe la plus
prétieufe eft celle qui eft d’un rouge tirant fur le jaun
e , telle qu’eft la couleur du fang bilieux.
La fécondé efpece eft d’un jaune de faffran ; la
te.inte. rouge y eft moins forte que dans la précédente.
La troifieme efpece d’hyacinthe eft plus claire encore
, & fans fa. dureté le coup d’oeil extérieur la
feroit prendre pour du fiiccin ou de l’ambre jaune
à qui elle reffemble parfaitement.
La quatrième efpece elf d’un jaune plus clair encore
, & fa couleur reffemble à celle de l’ambre gris
ou du miel; c’eû la moins eftimée.
Il y a des hyacinthes d’une couleur- fi fon cée, que
l’on ne peut point diftinguer la couleur à moins de
les regarder en les tenant entre l’oeil & la lumière.
D ’autres, font fi peu colorées > qn’d n’y aquç. leur
H Y A dureté qui puiffe faire juger que ce font des hyacinthes.
Souvent les hyacinthes d’un jaune clair ont été
confondues avec les topafes & les chryfolites, mais
elles en different par la dureté. Boëce de Boot penfe
que la pierre appellée carbunculus ou efcarboucle par
les anciens , n’étoit qu’une hyacinthe d’un beau rou*
ge , jettant beaucoup de feu , & d’une taille plus
grande que celle des hyacinthes ordinaires, qui, félon
lu i, n’excedent pas communément la groffeur
d’un pois, & félon M. H ill, celle d’une noix de muf-
cade. Ce dernier nous apprend que les hyacinthes fe
trouvent en cryftaux à fix côtés terminés par une
pyramide exagone comme le cryftal de roche, mais
elles font plus dures que lui ; ou bien elles fe trouvent
fous la forme de petits cailloux ohlongs , arrondis
& applatis par un de leurs côtés. Les hyacinthes
qui fe trouvent ainfi, font plus dures que celles qui
font cryftallifées.Voy. Hill's natural hifiory offoffils.
- Les hyacinthes de la plus belle efpece viennent des
Indes orientales , & fe trouvent dans les royaumes
de Cananoz, de Cambaye & de Calicut ; il envient
aufli des Indes occidentales. Celles de la moindre efpece
fe trouvent en Europe &c entr’autres fur les
frontières de la Bohème & delà Siléfie.
On voit aifément que les différentes nuances de
couleurs , par où nous avons dit que les hyacinthes
paffoient, ont dû induire en erreur les auteurs ; il
n’y a donc guere que la dureté qui puiffe en faire
juger & empêchér qu’on ne les. confonde, foit avec
la topafe , foit avec lachryfolite,foit avec le grenat
& le rubacelle, foit avec toutes les pierres précieu-
fes jaunes ou ropges.
Il nous vient d’Efpagne, de Saxe & d’Auvergne,'
des pierres que l’on nomme fauffes hyacinthes ou jargons
qu’il ne faut point non plus confondre avec celles
dont nous parlons ; d’ailleurs elles font d’un rouge
matte & couleur de brique ; elles ne font point
tranfparentes, & doivent être regardées comme du
vrai cryftal de roche opaque & coloré ; elles ne font
pas plus dures que lui ; leur figure eft celle d’une
colonne à fix pans, terminée des deux eôtés par
deux pyramides exagones. Les anciens ne donnoient
point le nom d’hyacinthe à la pierre que nous venons
de décrire ; celle qu’ils défignoient fous ce nom étoit
une efpece d’àméthyfte, puifque, par la defeription
qu’en donnent Pline & Théophrafte, c’étoit une
pierre mêlée de bleu ou violette. Voye^ Théophraste
, traité des pierres avec les notes de M. Hill, pag. 6S
de la traduction françoife. M. Hill croit que e’eft l’hyacinthe
que les anciens connoiffoient fous le nom de
lapis lyncurius, quoique quelques auteurs ayent prétendu
qu’ils défignoient par-là la belemnitè qui n’a
pourtant aucune des qualités que Pline attribue au
lapis lyncurius, puifqu’il dit que c’étoit une efpece
d’efcarboucle qui ne différoit des autres que par fa
couleur de flamme. Voyez HiWs natural hifiory o f
fojfils. Voyez Ly n c u r iu s La p is .
On a attribué un grand nombre de vertus médicinales
à Vhyacinthe, & on la fait entrer dans des
compofitions pharmaceutiques , après l’avoir éer-a-
fée & réduite en une poudre impalpable ; mais comme
cette pierre n’eft point foluble dans aucun diffol-
v an t , elle ne peut avoir plus de vertus, dans la médecine
que du verre pilé. H y a c in t h e , ( Pierre ) c’eft un des cinq frag-
mens précieux. J'qyrç Fragment p r é c ie u x .
H y a c i n t h e ( confection d')Voye^ à l ’a r t . C onf
e c t i o n . HYACINTHIES, f. f. pl. (Myht. ) ou HYACIN^
THES;fêtes que les Lacédémoniens célébroient tous
les ans au mois héeatomboeon, pendant trois jours , en l’honneur d’Apollon, auprès du tombeau d’Hyacinthe
; on fait affez que ce jeune prince, de la ville
d’Amielés en Laconie, étoit tellement aimé d’Apol-
H Y A
Ion, que le fils de Jupiter & de Latone abandonnât,
pour le fuivre , le féjour de Delphes , & qu’il fut la
caufe innocente de fa mort. Paufanias dit qu’on
voyoit fur fa tombe la figure du dieu à qui s’adref-
foient les facrifices ; mais les jeux furent inftitués en
l ’honneur du fils d’CEbolus.
Les deux premiers jours de ces fêtes étoient employés
à pleurer fa mort ; on mangeoit fans couronne
lur fa tête , & on ne chantoit aucun hymne après
le trifte repas ; mais le troifieme jour on s’abandon-
noità lajoie, auxfeftins, aux cavalcades & autres
réjouiffances. On offroit ce jour-là des facrifices à
Apollon, & on n’oublioit pas de bien traiter fa famille
& fes domeftiques. Voye{ Meurfius, Gracia fe -
riata, & Fazoldus , de feßis Groecorum. (D . J.)
HYADES, f. f. pl. (terme d'Afironomiè. ) ce font
fept étoiles fameufes chez les Poètes, qui, félon les
anciens, amenoient toujours la pluie.
C ’eft pour cette raifon qu’on les a appellées Hya-
des du mot grec Zuvypluere, pleuvoir.
La principale eft l’oe il gauche du taureau appelle
par les Arabes aldebaran. Voyez Aldebaran &
T aur ea u .
Les Poètes ont feint que les hyades font filles d’Ar-
la f& d e Pleione, & que leur frere Hyaf ayant été
déchiré par une lionne", elles pleurèrent fa mort
avec tant de douleur, que les dieux touchés de com-
paffion , les tranfporterent au ciel & les placèrent
lur le front du taureau où elles pleurent encore.
^ D ’autres repréfentent les hyades comme les nourrices
de Bacchus, que Jupiter tranfporta au ciel pour
les mettre à couvert de la colere de Junon. Chambers.
(G')
Les anciens, comme nous l’avons déjà dit, regar-
doient la conftellation des hyades comme apportant
la pluie , témoin ce vers de Virgile : Archerum, plu-
viasque hyadas geminosque triones. Les philofophes
reconnoiffent unanimement aujourd’hui que les étoiles
font trop éloignées de nous pour caufer aucuns
changemens ni aucune altération dans notre athmof- I
phere ni dans notre terre. (O)
HYALÉ, f. f. (Mythj) une des nymphes de la fuite
de Diane ; c’étoit elle qui rempliffoit les urnes qu’on
repandoit fur la deeffe , loriqu’Aâéon l’apperçut
dans le bain.
HYALO IDE, hyaloides, du grec vetXoç, verre , &
tîS'oç , forme, fe dit de l’humeur vitrée. Voyez Vit
r é e .
Hy a l o id e , f. f. (Hiß.nat.) nom d’une pierre prétieufe
fort brillante & tranfparente comme du cryf-
tal ; il en eft parlé dans les anciens naturaliftes ; on
s ’en fervoit pour les cachets après avoir gravé cette
pierre. Plufieurs auteurs ont donné leurs conjectures
fur cette pierre. M. Hill penfe que c’eft la même
que Pline nomme afirios, qui étoit de la nature du
cryftal, & qui venoit des Indes ; il ajoute qu’il en
vient beaucoup de cette efpece d’Amérique ; elles fe
trouvent fur-tout fur les bords de la ri viere des Amazones.
Il dit qu on en a apporté qui étoient fi belles,
qu’on les auroit prefque prifes pour de vrais dia-
mans. Ce font des cailloux blancs & tranfparens qui
femblent être, de la même nature que ce qu’on nomme
cailloux du Rhin, ou cailloux de Médoc. Voyez
le traité les pierres de Théophrafte , avec des notes de | H ! HYAR, ( Geog.) ville d’Efpagne au royaume d’Ar-
rag °n , fur la r ivieie de faint Martin.
} HYBOUCOÜHU, f. m. (Hiß. nat. Botan.) fruit
d Amérique, qui reffemble aux dattes, mais qu’on
ne mange point : on en tire une huile que l’on con-
r Ve j 3nS ^CS COcos *lue l,<5n a vuidés ; on en fait
ufage dans le pays pour une maladie appellée tom,
©ccafionnee. par de petits vers fins comme des cheveux
> qui s infinuententre cuir & chair, & forment
H Y C 359 d” pulîules très-douloureufes. On frotte la partie
affligée avec l’huile que les Indiens appellent gara-
meno ; on prétend qu’elle efl aufli très-bonne pour la
guérifon des plaies.
HYBRISTIQUES, U . pl. (Mytk.) fêtes qu’on
celebroit à Argos , en l’honneur des femmes qui
avoient pris les armes & fauve la ville afliégée par
les Lacédémoniens qu’elles eurent la gloire de re-
pouffer;,c’eft de l’âffront qu’ils effuyerent, que la
fete prit fon nom : Zfyiç en grec fignifie injure, affront
tgnomtme ; e\\e fut grande pour des Spartiates
, fi tant eft qu on n’ait pas fait trop d’honneur aux
exploits des Argiennes dans cette oceafion.(Z?. ƒ.)
HYCCARA , (Géog. anc.) ancienne ville maritime
de Sicile, fur la côte feptentrionale : fes ruines
s’appellent aujourd’hui Murodi Carini.
Plutarque nous apprend q u e , l’an x de la quatre-
vingt-onzieme olympiade, Nicias, général desAthé-
niens , ruina cette ville où nâquitla fameufe cour-
tifanne L a is , l’an 4 de la quatre-vingt-neuvieme
olympiade : elle avoit donc fept ans lors de la def-
trudion de fa patrie ; à cet âge tendre, elle fut vendue
parmi les autres prifonniers , & tranfportée à
Corinthe ; au bout de quelques années , fa beauté
lui valut des hommages de toutes parts ; de grands
feigneurs , des orateurs illuftres & des philofophes
fauvages en devinrent éperdument amoureux ; l’on
compte au nombre de fes adorateurs, Démofthène,
Diogène le cynique , quelle fouffrit, tout pauvre
& mal-propre qu’il étoit, & le philofop.he Ariftip-
p e , qui étoit la propreté & la politeffe même. Elle
n’eut pas cependant la gloire de triompher de la
continence de Xénocrate , & elle devint à fon tour
paffionnée d’Eubatés , vainqueur aux jeux olympiques
; elle lui fit même promettre qu’il l’épouieroit,
mais il trouva moyen d’éluder fa parole ; enfin Laïs
s’étant rendue en Theffalie, pour y chercher un autre
jeune homme dont elle étoit eprife, les Theffa-
liennes conçurent tant de jaloufie contre cette belle
créature , qu’elles s’en défirent cruellement, & i’af-
fommerent dans le temple de Vénus à coups de chai-
fes qu’elles trouvèrent fous leurs mains ; mais on lui
bâtit un tombeau magnifique fur la riviere de Pénée
& le temple où elle mourut, ne fut plus nommé que
le temple de Vénus profané ; tous ces faits peignent
les moeurs d’un tems & d’un pays célébré. (D . J.)
HYDASPE , (Géog. anc.) en latin Bydafpes ;
grand fleuve des Indes, fur lequel Strabon dit qu’A-
lexandre mit une flotte formée desfapins & des cèdres
qu’il fit couper fur les monts Emodés. Horace ,
l. ï . ode-xx 3 appelle ce ûeuvefabulofus> c’eft-à-dire,
célébré, renommé, fameux. Il tire fa fource du mont *
Ima, vers les frontières du grand Tibet ; porte fes
eaux dans l’Inde, où il tombe à l’orient entre Monl-
tan & Bucor. N’eft-ce point aujourd’hui le R a v i}
UHydafpe dont parle V irgile, Géorg. I. IV. v. z n
.& qu’il met en Médie , Medus kydafpcs, n’eft point
celui qui fut dans les Indes le terme des conquêtes
d’Alexandre ; c’étoit un fleuve d’A fie, peu éloigné
de la ville de Suzé ; Strabon l’appelle Choafpe , &
fon eau paffoit pour être délieieufe à boire. (D . J .)
HYDATIDE, f. f. ( Med. ) ùS'o.tU , aquula; c’eft,
félon Galien ( lib. X IV . meth. med. ) , une forte de
tumeur qui fe forme d’une matière aqueufe & grâif-
feufe, fous la peau d’une paupière, fur-tout de la
fupérieure, où elle caufe ordinairement uné fluxioïi
qui empêche d’ouvrir l’oeil.
Cette maladie fe traite comme I’oedeme de ja paupière
; voye£ OE dEM E ( poMpiere ) , & le Traité des
maladies des yeux , de Maître-Jan.
Mais, en général, les Médecins entendent par
hydatides toutes fortes de tumeurs véficulaires , qui
fe forment ordinairement , en affez grand nombre.
tout»-à-la-fois , dans les intervalles des noeuds des