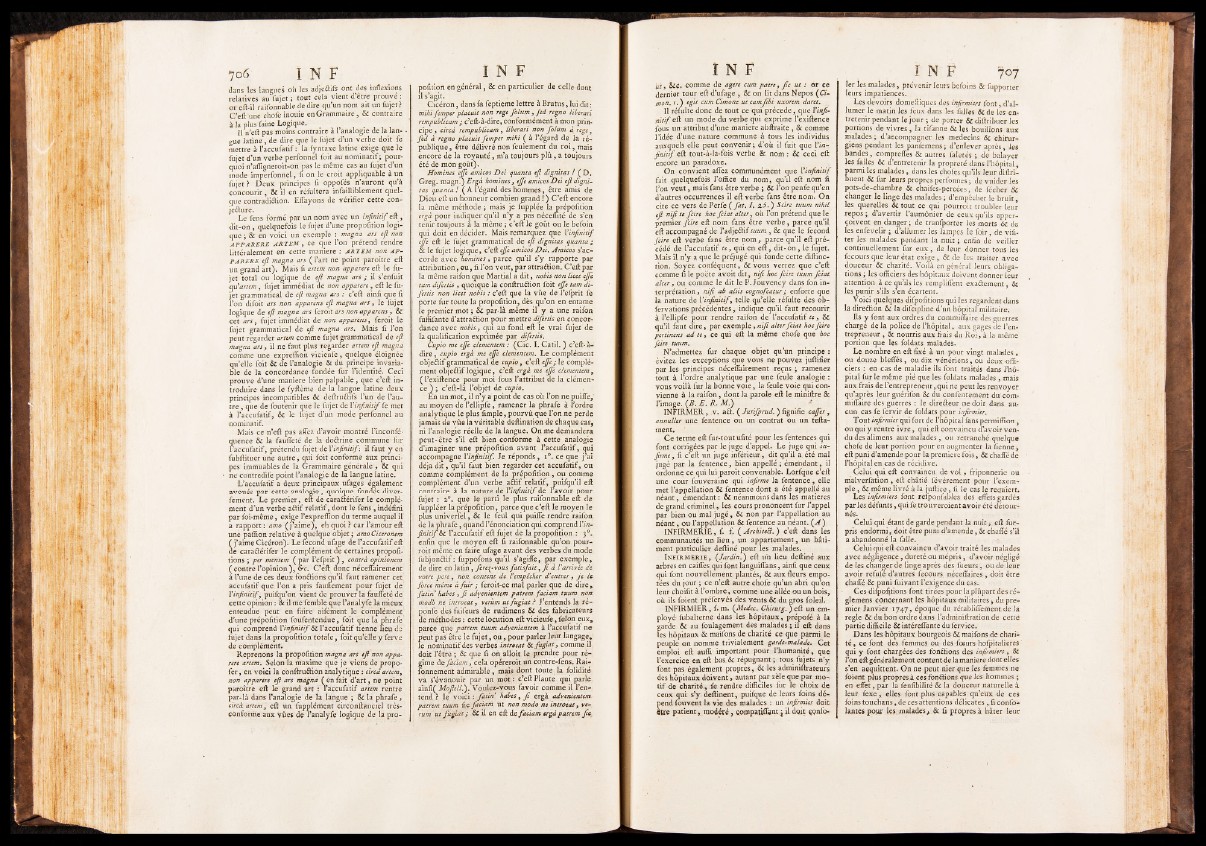
706 I N F
dans les langues où les adjeéhfs ont clés inflexions
relatives au fujet ; tout cela vient d etre prouve :
or eft-il raifonnable de dire qu’un nom ait un fujet?
C ’eft une choie inoùie en Grammaire, & contraire
à la plus laine Logique. ^ .
Il n’eft pas moins contraire à l’analogie de la lan- •
gue latine, de dire que le fujet d’un verbe doit le
mettre à l’accufatif : la fyntaxe latine exige que le
fujet d’un verbe perfonnel foit au nominatif ; pourquoi
n’affigneroit-on pas le même cas au fujet d’un
inode imperfonnel, fi on le croit appliquable à un
fujet ? Deux principes fi oppofés n’auront qu’à
concourir, 6c il en réfultera infailliblement quelque
contradiction. Effayons de vérifier cette conjecture.
Le fens formé par un nom avec un infinitif e f t ,
dit-on, quelquefois le fujet d’une propofition logique
; & en voici un exemple : magna ars eft non
a p P a r e re a r t em , ce que l’on prétend rendre
littéralement en cette maniéré : a r t e m non a p -
p a r e r e ejt magna ars ( l’art ne point paroître eft
un grand art). Mais fi artem non apparere eft le fujet
total ou logique de ejt magna ars ; il s’enfuit
qu’artem, fujet immédiat de non apparere, eft le fujet
grammatical de ejt magna ars : c’eft ainfi que fi
l’on difoit ars non apparens ejt magna ars , le fujet
logique de eft magna ars feroit ars non apparens, Sc
cet ars, fujet immédiat de non apparens, feroit le
fujet grammatical de eft magna ars. Mais fi l’on
peut regarder artem comme fujet grammatical de ejt
magna ars, il ne faut plus regarder artem ejt magna
comme une expreflion vicieufe , quelque éloignée
qu’elle foit 6c de l’analogie & du principe invariable
de la concordance fondée fur l’identité. Ceci
prouve d’une maniéré bien palpable, que c’eft introduire
dans le fyftème de la langue latine deux
principes incompatibles 6c deftruûifs l’un de l’autre
, que de foutenir que le fujet de l'infinitif te met
à l’accufatif, 6c le fujet d’un mode perfonnel au
nominatif.
Mais ce n’eft pas affez d’avoir montré l’inconfé-
quence 6c la faufleté de la doctrine commune' fur
l ’accufatif, prétendu fujet de l'infinitif : il faut y en
fubftituer une autre, qui foit conforme aux principes
immuables de la Grammaire générale , & qui
ne contredife point l’analogie de la langue latine.
L’accufatif a deux principaux ufages également
avoués par cette analogie, quoique fondés diver-
fement. Le premier, eft de caraftérifer le complément
d’un verbe aftif relatif, dont le fens, indéfini
par foi-même, exige l’expreflion du terme auquel il
a rapport : amo ( j ’aime), eh quoi ? car l’amour eft
une paffion relative à quelque objet ; amoCiceronem
( j’ aime Cicéron). Le fécond ufage de l’accufatif eft
de caraétérifer le complément de certaines propofi-
tions ; per mentem ( par l’efprit ) , contra opinioneni
( contre l’opinion ) , &c. C’eft donc néceflairement
à l’une de ces deux fondions qu’il faut ramener cet
accufatif que l’on a pris fauffement pour fujet de
l’infinitif, puifqu’on vient de prouver la faufleté de
cette opinion : & il nie femble que l’analyfe la mieux
entendue peut en faire aifément le complément
d’une prépofition foiiféntendue, foit que la phrafe
qui comprend Y infinitif 6c l’accufatif tienne lieu de
fujet dans la propofition totale, foit qu’elle y ferve
de complément.
Reprenons la propofition magna ars ejt non dppa-
rert artem. Selon la maxime que je viens de propo-
fer, en voici la conftrutiion analytique : circd artem,
non apparere ejt ars magna ( en fait d’a r t , ne point
paroître eft le grand art : l’accufatif artem rentre
par-là dans l’analogie de la langue ; 6c la phrafe,
circà artem , eft un fupplément circonftanciel très-
conforme aux vues de l’analyfe logique de la pro-
I NF pofitiort en général, & eh particulier de celle dont
il s’agit. # ,
Cicéron, dans fa feptieme lettre à Brutus, lui dit :
mihi femper plaçait non rege folum , fed regno liberari
rempublicam ; c’eft-à-dire, conformément à mon principe
, circà rempublicam, liberari non folum 4, rege.
fed à regno placuit femper mihi ( à l’égard de la république
, être délivré non feulement du ro i, mais
encore de la royauté, m’a toujours p lû , a toujours
été de mon goût).
Homines ejfe amicos D ei quanta eft dignitàs / ( D.
Greg. magn.) Ergà homines , effe amicos Dei ejt digni-
tas quanta ! ( A l’égard des hommes, être amis de
Dieu eft un honneur combien grand ! ) C ’eft encore
la même méthode ; mais je fupplée la prépofition
ergà pour indiquer qu’il n’y a pas néceffité de s’en
tenir toujours à la même ; c ’eft le goût ou le befoin
qui doit en décider. Mais remarquez que l'infinitif
effe eft le fujet grammatical de eft dignitàs quanta ;
& le fujet logique, c’eft effe amicos Dei. Amicos s’accorde
avec homines y parce qu’il s’y rapporte par
attribution, ou, fi l’on veut, par attraction. C ’eft par
la même raifon que Martial a dit, nobis non licet effe
tam difeiùs , quoique la conftruCtion foit ejfe tam di-
fertis non licet nobis : c’eft que la vue de l’efprit fe
porte fur toute la propofition, dès qu’on en entame
le premier mot ; Sc par-là même il y a une raifon
fuffifante d’attraCtion pour mettre dijtrtis en concordance
avec nobis, qui au fond eft le vrai fujet de
la qualification exprimée par difertis.
Cupio me effe clementem : (Çic. I. Catil. ) c’eft- à-
dire, cupio ergà me ejfe clementem. Le complément
objeCtif grammatical de cupio y c’eft ejfe ; le complément
objeCtif logique, c’eft ergà me ejfe clementem,
( l ’exiftence pour moi fous l’attribut de la clémence
) ; c’eft-là l’objet de cupio.
En un mot, il n’y a point de cas où l’on ne puifle,’
au moyen de l’ellipfe, ramener la phrafe à l’ordre
analytique le plus fimple, pourvû que l’on ne perde
jamais de vûe la véritable deftination de chaque cas,
ni l’analogie réelle de la langue. On me demandera
peut-être s’il eft bien conforme à cette analogie
d’imaginer une prépofition avant l’accufatif, qui
accompagne l'infinitif. Je réponds, i° . ce que j ’ai
déjà d it, qu’il faut bien regarder cet accufatif, ou
comme complément de la prépofition, ou comme
complément d’un verbe aCtif relatif, puifqu’il eft
contraire à la nature de l'infinitif de Ravoir pour
fujet : z°. que le parti le plus raifonnable eft de
fuppléer la prépofition, parce que c ’eft le moyen le
plus univerfel, & le feul qui puifle rendre raifon
de la phrafe, quand l’énonciation qui comprend l'infinitif
6c l’ accufatif eft fujet de la propofition : 30.
enfin que le moyen eft fi raifonnable qu’on pour-
roit même en faire ufage avant des verbes du mode
lubjoriCtif : fuppofons qu’il s’agifle, par exemple,
de dire en latin, fierez-vous fatisfait y f i à l'arrivée de
votre pere, non content de l'empêcher d'entrer, je le
force même à fuir ; feroit-ce mal parler que de dire,
fdtin habes , f i advenientem patrem faciam tuum non
modo ne introeat, verîtm ut fugiat? J’entends la ré-
pOnfe dès faifeurs de rudimens 6c des fabricateurs
de méthodes : cette locution eft vicieufe, félon eux,
parce que patrtm tuum advenientem à l’accufatif ne
peut pas être le fujet, o u , pour parler leur langage,
le nominatif des verbes introeat & j fugiat » comme il
doit l’êtrè. ; Sc que fi on alloit le prendre pour régime
de faciam, cela opéreroit un contre-fens. Rai-
lonnement admirable, mais dont toute la folidité
va s’évanouir par un mot : c’eft Plaute qui parle
ainfi( Mofiell.fi Voulez-vous favoir comme il l’entend
? le voici : fatin habes y f i ergà advenientem
patrem tuum fie faciam ut non modo ne introeat, ve-
rum ut fugiat ; ôt il en eft de faciam ergà patrem fie.
î N F Üt y &c. comme de agêre curh pâtre, fie ut : or ce
dernier tour eft d’ufage , & on lit dans Nepos (Ci-
mon. /.) cgit cum Cimone ut eamfibi - uxorem daret.
Il réfulte donc dé tout ce qui précédé, que l'infinitif
eft un mode du verbe qui exprime l’exiftence
fous un attribut d’une maniéré abftraite, & comme
l ’idée d’une nature commune à tous les individus
auxquels elle peut convenir ; d’où il fuit que Vinfinitif
eft tout-à-la-fois verbe & nom : 6c ceci eft
encore un paradoxe.
On convient affez communément que l'infinitif
fait quelquefois l’office du nom, qu’il eft nom fi
l’on v eu t, mais fans être verbe ; Sc l’on penfe qu’en
d’autres occurrences il eft verbe fans être nom. On
cite ce vers de Perfe ( fa t. I . 2.5. ) S cire tuum nikil
ejt nifi te feire hoc feiat alter, où l’on prétend que le
premier feire eft nom fans être verbe, parce qu’il
eft accompagné de l’adjeCtif tuum, 6c que le fécond
feire eft verbe fans être nom , parce qu’il eft précédé
de l’accufatif tey qui en e ft , d it-on , le fujet.
Mais il n’y a que le préjugé qui fonde cette diftinc-
tion. Soyez çonféquent, 6c vous verrez que c’eft
çomme fi le poète à voit dit, nifi hoc feire tuum feiat
alter , ou comme le dit le P. Jouvency dans fon interprétation,
nifi ab aliis cognofcatur; enforte que
la nature de l ’injmitify telle qu’elle réfulte des ob-
fervarions précédentes, indique qu’il faut recourir^
à l’ellipfe pour rendre raifon de l’accufatif te , 6c
qu’il faut dire, par exemple , nifi alter feiat hoc feire
pertinens ad te, ce qui eft la même chofe que hoc
feire tuum.
N’admettez fur chaque objet qu’un principe :
évitez les exceptions que vous ne pouvez juftifier
par les principes néceflairement reçus ; ramenez
tout à l’ordre analytique par une feule analogie :
vous voilà fur la bonne v o ie , la feule voie qui convienne
à la raifon, dont la parole eft le miniftre &
l’image. (B. E . R. Af.)
INFIRMER, ,v. aCt. ( Jurifprud. ) lignifie cajfer,
annuller une fentence ou un contrat ou un tefta-
ment.
Ce terme eft fur-tout ufité pour les fentences qui
font corrigées par le juge d’appel. Le juge qui infirme
y fi c’eft un juge inférieur , dit qu’il a, été mal
jugé par la fentence, bien appellé ; émendant, il
ordonne ce qui lui paroît convenable. Lorfque c’eft
une cour fouveraine qui infirme la fentence, elle
met l ’appellation & fentence dont a été appellé au
néant, émendant : & néanmoins dans les matières
de grand criminel, les cours prononcent fur Fappel
par bien ou mal jugé, & non par l’appellation au
néant, ou l’appellation & fentence au néant. (A )
INFIRMERIE, f. f. ( Architecl. ) c’eft dans les
communautés un lieu , un appartement, un bâtiment
particulier deftiné pour les malades. In firm er ie, (Jardin.) eft un beu deftiné aux
arbres en caifles qui font languiflans, ainfi que ceux
qui font nouvellement plantés, & aux fleurs empotées
du jour ; ce n’eft autre chofe qu’un abri qu’on
leur choifit à l’ombre, comme une allée ou un bois,
où ils foient préfervés des vents & du gros foleil.
INFIRMIER, f. m. (Medec. Çhirurg. ) eft un employé
fubalterne dans les hôpitaux, prépofé à la
garde & au foulagement des malades ; il eft dans
les hôpitaux & maifons de charité ce que parmi. le
peuple on nomme trivialement garde-malade. Çet
emploi eft aufli important pour l’humanité , que
l’exercice en eft bas & répugnant ; tous fujets n’y
font pas également propres, & les adminiftrateurs
des hôpitaux doivent, autant par zèle que par mon
t if de charité., fe rendre difficiles fur le choix de
ceux qui s’y deftinent, puifque de leurs foins dépend
fouvent la vie des malades : un infirmier doit
être patient, modéré, compatiflant j il doit ççnfo-
I N F 707
1er les malades, prévenir leurs befoins & fupporter
leurs impatiences.
Les devoirs domeftiques des infirmiers font, d’allumer
le matin les feux dans les faites & de les entretenir
pendant le jour ; de porter & diftribuer les
portions de v ivres, la tifanne & les bouillons aux
malades ; d’atcompagner les médecins & chirurgiens
pendant les panfemens ; d’enlever après, les
bandes, compreffes & autres faletés ; de balayer
les falles 6c d’entretenir la propreté dans l’hôpital,
parmi les malades, dans les choies qu’ils leur diftri-
buent & fur leurs propres perfonnes ; de vuider les
pots-de-chambre & chaifes-perçées, de fécher &
changer le linge des malades ; d’empêcher le bruit,
les querelles & tout ce qui pourroit troubler leur
repos ; d’avertir l’aumônier de ceux qu’ils apper-
çoivent en danger ; de tranfporter les morts 6c de
les enfevelir ; d’allumer les lampes le foir, de vifi-
ter les malades pendant la nuit ; enfin de veiller
continuellement fur eu x , de leur donner tous les
fecours que leur état exige , 6c de les traiter avec
douceur & charité. Voilà en général leurs obligations
; les officiers des hôpitaux doivent donner leur
attention, à ce qu’ils les rempliflent exactement, 6c
les punir s’ils s’en écartent.
Voici quelques difpofitions qui les regardent dans
la direction 6c la difeipline d’un hôpital militaire.
Ils y font aux ordres du commiflaire des guerres
chargé de la police de l’hôpital, aux gages de l’entrepreneur
, & nourris aux fiais du Ro i, à la même
portion que les foldats malades.
Le nombre en eft fixé à un pour vingt malades ,
ou douze blefles, ou dix vénériens, ou deux officiers
: en cas de maladie ils font traités dans l’hôpital
fur le même pié que les foldats malades , mais
aux frais de l’entrepreneur, qui ne peut les renvoyer
qu’après leur guérifon 6c du confentement du-commiflaire
des guerres : le directeur ne doit dans aucun
cas fe fervir de foldats pour infirmier.
Tout infirmier qui fort de l’hôpital fans permiffion ,
ou qui y rentre iv re , qui eft convaincu d’avoir vendu
des alimens aux malades, ou retranché quelque
chofe de leur portion pour en augmenter la fienne ;
eft puni d’amende pour la première fois, 6c chafle de
l’hôpital en cas de récidive.
Celui qui eft convaincu, de v o l , friponnerie ou
malverfation , eft châtié févérement pour l’exemple
, 6c même livré à la juftice, fi le cas le requiert.
Les infirmiers font refponfables des effets gardés
par les défunts, qui fe trouveroient avoir été détournés
.C
elui qui étant de garde pendant la nuit, eft fur-
pris endormi, doit être puni d’amende, Ôc chaffé s’il
a abandonné la falle.
Celui qui eft, convaincu d’avoir traité les malades
avec négligence, dureté ou mépris, d’avoir négligé
de les changer de linge après des fueurs, ou de leur
avoir refufé d’autres fecours. néceflaires, doit être
chafle & puni fuivant l’exigence du cas.
Ces difpofitions font tirées pour la plûpart des ré-
glemens concernant les hôpitaux militaires t du premier
Janvier 1747, époque du rétabliflement de la
réglé 6ç du bon ordre dans l’adminiftration de cette
partie difficile & intéreflante du fervice.
Dans les hôpitaux bourgeois ôç maifons de charité
, ce font des femmes ou des -foeurs hofpitalieres
qui y font chargées des fondions des infirmiers, St
l’on eft généralement content de la maniéré dont elles
s’en acquittent. On ne peut nier que les femmes ne
foient plus propres,à ces fondions, que les hommes ;
en effet, par la fenfibilité SC la douceur naturelle à
leur fexe * elles font plus Capables , qu’eux de ces
foins touchans, de ces attentions délicates ,.fi confo-
lantes pour les malades, 6c fi propres à hâter leur