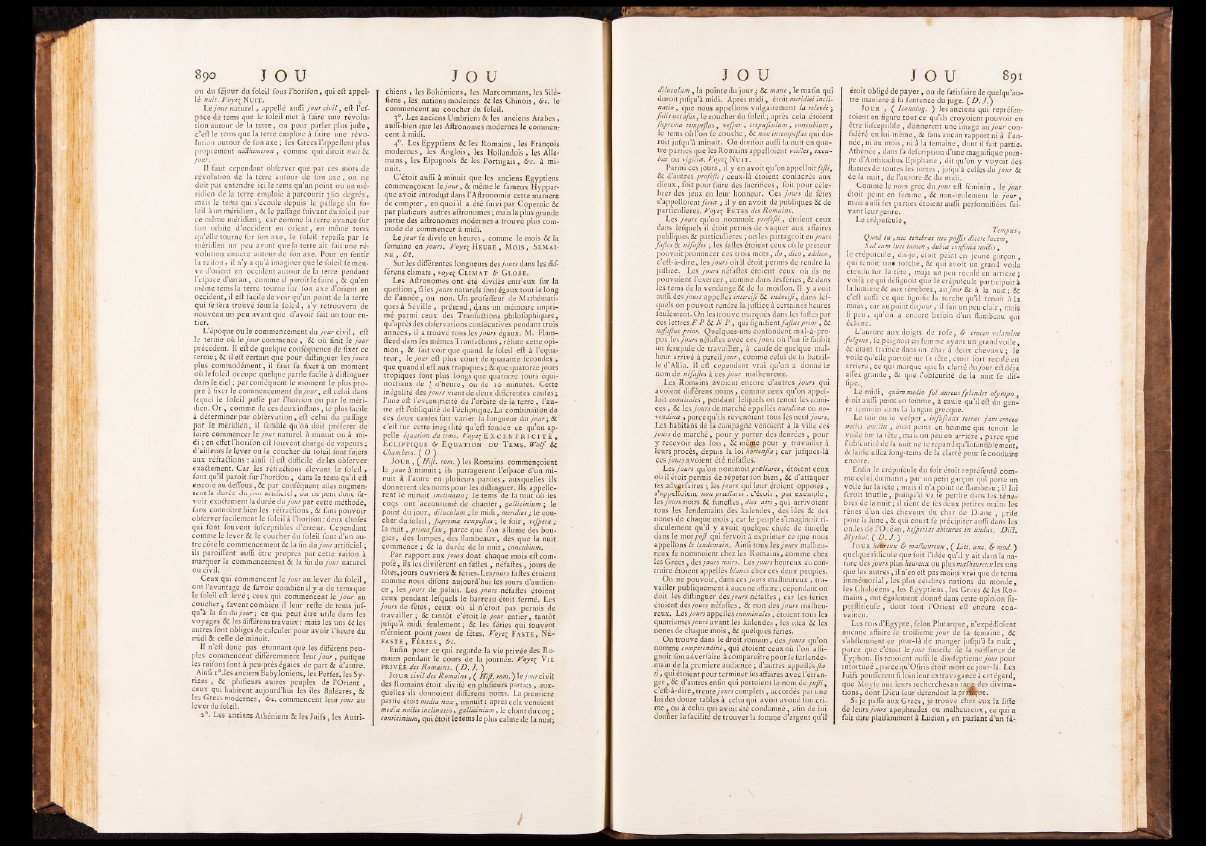
ou du féjour du foleil fous l’horifon, qui eft appel-
lé nuit. Voyt{ Nu it .
Le jour naturel, appellé aulîi jour civil, eft l’ef-
pace de tems que le loleil met à faire une révolution
autour de la terre, ou pour parler plus jufte,
c’eft le tems que la terre emploie à faire une révolution
autour de fon axe ; les Grecs l’appellent plus
proprement niUhemeron , comme qui diroit nuit &
j.oùr, ''
Il faut cependant obferver que par ces mots de
révolution de la terre autour de fon a x e , on ne
doit pas entendre ici le rems qu’un point ou un méridien
delà terre emploie à parcourir 360 degrés,
mais le tertis qui s’écoule depuis le paflage du foleil
à un méridien, & le paflage fuivant du foleil par
ce même méridien ; car comme la terre avance fur
fon orbite d’occident en orient, en même tems
qu’elle tourne fur fon axe, le foleil repafle par le
méridien un peu avant que la terre ait fait une révolution
entière autour de fon axe. Pour en fentir
la raifon, il n’y a qu’à imaginer que le foleil fe meuve
d’orient en occident autour de la terre pendant
l’efpace d’un an , comme il paroît le faire , & qu’en
même tems la terre tourne fur fon axe d’orient en
occident, il eft facile de voir qu’un point de la terre
qui fe fera trouvé fous le foleil, s’y retrouvera de
nouveau un peu avant que d’avoir fait un tour entier.
L’époque ou le commencement du jour c ivil, eft
le terme où le jour commence , & oit finit le jour
précédent. II eft de quelque conféquence de fixer ce
terme ; & il eft certain que pour diftinguér les jours
plus commodément, il faut fe fixer à un moment
oh le foleil occupe quelque partie facile à diftinguér
dans le ciel ; par confëquent le moment le plus propre
à fixer le commencement du jour, eft celui dans
lequel le foleil pafl'e par l’horifon ou par le méridien.
Or , comme de ces deuxinftans, le plus facile
à déterminer par obfervation, eft celui du paflage
par le méridien, il femble qu’on doit préférer de
faire commencer le jour naturel à minuit ou à midi
; en effet l’horifon eft fouvent chargé de vapeurs ;
d ’ailleurs le lever ou le coucher du foleil font fujets
aux réfraftions : ainfi il eft difficile de les obferver
exactement. Car les réfiaCtions élevant le foleil,
font qu’il paroît fur l’horifon , dans le tems qu’il eft
encore au deffous, & par conféquent elles augmentent
la durée du jour artificiel ; on ne peut donc fa-
voir exactement la durée du jour par cette méthode,
fans connoître bien les réfraCtions, & fans pouvoir
obferver facilement le foleil à l’horifon : deux chofes
qui font fouvent fufceptibles d’erreur. Cependant
comme le lever & le coucher du foleil font d’un autre
côté le commencement & la fin du jour artificiel ;
ils paroiffent aufli être propres par cette raifon à
marquer le commencement & la fin du jour naturel
ou civil.
Ceux qui commencent le jour au lever du foleil,
ont l’avantage de favoir combien il y a de tems que
le foleil eft levé ; ceux qui commencent le jour au
coucher, favent combien il leur refte de tems juf-
qu’à la fin du jour \ ce qui peut être utile dans les
voyages & les différens travaux : mais les uns & les
autres font obligés de calculer pour avoir l’heure du
midi & celle de minuit.
Il n’eft donc pas étonnant que les différens peuples
commencent différemment leur jour , puifque
les raifons font à peu-près égaies de part & d’autre.
Ainfi i°.Ies anciens Babyloniens, les Perfes, les Syriens
, & plufieurs autres peuples de l’Orient ,
ceux qui habitent aujourd’hui les îles Baléares, &
les Grecs modernes, &c. commencent leur jour au
lever du foleil.
aQ. Les anciens Athéniens & les Juifs, les Autrichiens
> les Bohémiens, les Marcommans, les Silé-
fiens , les. nations modernes & les Chinois, &c. le
commencent au coucher du foleil.
30. Les anciens Umbriens & les anciens Arabes ,
auflî-bien que les Aftronomes modernes le commem
cent à midi.
4°. Les Egyptiens & les Romains, les François
modernes, les Anglois, les Hollandois, les Alle-
mans, les Efpagnols & les Portugais, &c. à minuit.
C ’étoit aufli à minuit que les anciens 'Egyptiens
commençoient le jour , & même le fameux Hyppar-
que avoit introdqit dans l’Aftronomie cette maniéré
de compter, en quoi il a été fuivi par Copernic &C
par plufieurs autres aftronomes ; mais la plus grande
partie des aftronomes modernes a trouvé plus commode
de commencer à midi.
Le jour fe divife en heures, comme le mois. & la
femaine en jours. Voyt^ H eur e , M o is , S e m a i n
e .,, & t .
Sur les différentes longueurs des jours dans les différens
climats , voyt{ C l im a t & G l o b e .
Les Aftronomes ont été divifés entr’eux fur la
queftion , fi les jours naturels font égaux tout le long
de l’année, ou non. Un profeffeur de Mathématiques
à Séville , prétend, dans un mémoire imprimé
parmi ceux des Tranlattions philofophiques,
qu’aprèsdes obfervations confécutives pendant trois
années, il a trouvé tous les jours égaux. M. Flam-
fteed dans les mêmes Tranfaêtions, réfute cette opinion
, & fait voir que quand le foleil eft à l’équateur,
le jour eft plus court de quarante fécondés ,.
que quand il eft aux tropiques ; & que quatorze jours
tropiques font plus longs que quatorze jours équi-
nodtiaux de 4 d’heure, ou de 10 minutes. Cette
inégalité des jours vient de deux différentes caufes;
l’une eft l’excentricité de l’orbite de la terre , l’autre
eft l’obliquité de l ’écliptique. La combinaifon de
ces deux caufes fait varier la longueur du jour ; &
c’eft lur cette inégalité qu’eft fondée ce qu’on appelle
équation du unis. Voy&{ E X C E N T R I C I T É ,
E c l i p t iq u e 6* E q u a t io n d u T e m s . Wolf &
Chambers. ( O )
Jo u r , ( Hijb. rom.') les Romains commençoient
le jour à minuit ; ils partagèrent l’efpace d’un mi-,
nuit à l'autre en plufieurs parties, auxquelles ils
donnèrent des noms pour les diftinguér. Ils appelèrent
le minuit inclinatio ; le tems de la nuit oh les
coqs ont accoutumé de chanter, gallicinium ; le
point du jour, diluculum ; le midi, mendies ; le coucher
du foleil, Juprema tempeßas ; le foir, vefpera ;
la nuit, prima fa x , parce que l’on allume des bougies,
des lampes, des flambeaux, dès que la nuit
commence ; & la durée de la nuit, concubium.
Par rapport aux jours dont chaque mois eft com-
pofé, ils les diviferent en faites , néfaftes, jours d e ,
fêtes, jours ouvriers & fériés. Les jours faites étoient
comme nous difons aujourd’hui les jours d’audience
, les jours de palais. Les jours néfaftes étoient
ceux pendant lefquels le barreau étoit fermé. Les
jours de fêtes, ceux oh il n’étoit pas permis de
travailler ; & tantôt c’étoit le jour entier, tantôt
jufqu’à midi feulement; & les fériés qui fouvent
n’étoient point jours de fêtes. Voye^ Fa s t e , Né f
a s t e , F é r i é s , &c.
Enfin pour ce qui regarde la vie privée des Romains
pendant le cours de la journée. Woye[ V ie
PRIVÉE des Romains. (Z?. J. )
Jo u r civil des Romains , ( Hiß. rom. ) le jour civil
des Romains étoit divifé en plufieurs parties , auxquelles
ils donnoient différens noms. La première
partie étoit media nox, minuit : après cela venoient
media noctis inclinatio , gallicinium, le chant du coq;
conticinium, qui étoit le tems le plus calme de la nuit;
diluculum , la pointe du jour ; & marie , le matin qui
duroit jufqu’à midi. Après midi, étoit meridiei inclinatio
, que nous appelions vulgairement la relevée ;
folisoccafus, le coucher du foleil; apres cela étoient
fuprema tempefias, vefper , crepufculum, concubium ,
le tems oh l’on fe couche, & nox intempeftas qui duroit
jufqu’à minuit. On divifoit aufli la nuit en quatre
parties que les Romains appelloient veilles, excu-
bia ou vigilias. Voyc^ N u it .
Parmi ces jours, il y en avoit qu’on appelloitfijti,
& d’autres profejli ; ceux-là étoient conlàcrés aux
d ieu x , foit pour faire des facrifices, foit pour célébrer
des jeux en leur honneur. Ces jours de fêtes
s’appelloient ferice ; il y en avoit de publiques & de
particulières. Hoye^ FETES des Romains.
Les jours qu’on nommoit profejli, étoient ceux
dans lefquels il étoit permis de vaquer aux affaires
publiques & particulières ; on les partageoit en jours
fajles & néfaftes ; les faftes étoient ceux oh le préteur
pou voit prononcer ces trois mots, do, dico, addico,
c’eft-à-dire, les jours oh il étoit permis de rendre la
juftice. Les jours néfaftes étoient ceux oh ils ne
pouvoient l’exercer, comme dans lesféries, & dans
les tems de la vendange & de la moiffon. Il y avoit
aufli des jours appellés intercifi & e ndocifi, dans lefquels
on pouvoit rendre la juftice à certaines heures
feulement. On les trouve marqués dans les faftes par
ces lettres F P & N P , qui ûgnifientfajlus prior, &
nefajlus prior. Quelques-uns confondent mal-à-pro-
pos les jours néfaftes avec ces jours oh l’on fe faifoit
un fcrupule de travailler, à Caufede quelque malheur
arrivé à pareil/oar, comme celui de la bataille
d’Allia. Il eft cependant vrai qu’on a donné le
nom de. néfaftes à ces jour malheureux.
Les Romains, avoient encore d’autres jours qui
avoient différens noms , comme ceux qu’on appei-
Ioit comitiales, pendant lefquels on tenoit les comices
, & les. jours démarché appellés nundinoe ou no-
vendince , parce qu’ils revendent tous les neuf jours.
Les habitans de la campagne venoient à la ville ces
jours de marché, pour y.porter des denrées, pour
y recevoir des lois , & même pour y travailler à
leurs procès, depuis la loi wrttnjia ; car jufques-là
ces jours avoient été néfaftes.
Les jours qu’on nommoit pretlàares, étoient ceux
où il étoit permis de répéter fon bien, & d’attaquer
fes adv^rfaires ; les jours qui leur étoient oppolés ,
s’appelloient non proeliares : c’étoit , par exemple,
les jours noirs & funeftes, dies a t r i qui arrivoient
tous les lendemains des kalendes, des ides & des
nones de chaque mois ; car le peuple s’imaginoit ridiculement
qu’il y avoit quelque chofe de funefte
dans le motpofl qui fervoit à exprimer ce que nous
appelions le lendemain. Ainfi tous les jours malheureux
fe nommoient chez les Romains, comme chez
les G recs, des jours noirs. Les jours heureux au contraire
étoient appellés blancs chez ces deux peuples.
On ne pouvoit, dans ces jours malheureux, travailler
publiquement à aucune affaire ; cependant on
doit les diftinguér des jours néfaftes ; car les fériés
étoient des jours néfaftes, & non des jours malheureux.
Les jours appellés inominales ’ étoient tous les
quatrièmes jours avant les kalendes , les ides 6c les
nones de chaque mois, & quelques fériés.
On trouve dans le droit romain , des jour s qu’ on
nomme comperendini, qui étoient ceux oh l’on afii-
gnoit fon adverfaire àcomparoîtrepourlefurlende-
,main de la première audience ; d’autres appellés Jla-
4 1 qui étoient pour terminer fes affaires avec l’étranger
, & d’autres enfin qui portoient le nom d e ju j i i ,
c’eft-à-dire, trente jours complets, accordés par une
loi des douze tables à celui qui avoit avoué fon crime
»ou à celui qui avoit été condamné, afin de lui
donner la facilité de trouver la fomiue d’argent qu’il
étoit obligé de payer, ou de fatisfaire de quelqu’au-
tre maniéré à la lentence du juge, (/?.ƒ.')
Jour , ( Iconolog. ) les anciens qui repréfen-
toient en figure tout ce qu’ils Croyoient pouvoir en
etre fufceptible , donnèrent une image au jour confédéré
en lui-même, & fans aucun rapport ni à l’année,
ni au mois, ni à la femaine, dont il fait partie.
Athénée, dans fa defeription d’une magnifique pompe
d Anthiochus Epiphane , dit qu’on y voyoit des
ftatues de toutes les fortes , jufqu’à celles du jour &
de la nuit, de l’aurore & du midi.
Comme le nom grëc du jour eft féminin , le jour
étoit peint en femme , & non-<eulement le jo u r ,
mais aufli fes parties étoient aufli perfonnifiées fuivant
leur genre.
Le crépufcule,
Tempiis,
Qjiod tu , ntc tenebras nec pojjis dicere lucem,
Sed cum luce tamen , dubice confinia noctis,
le crepufcule, dis-je, croît peint en jeune garçon ,
qui tenoit un» torche, & qui avoit un grand voile
ctendu lur la tete , mais un peu reculé en arriéré ;
voilà ce qui défignoit que le crépufcule participoit à
la lumière & aux ténèbres, au jour & à la nuit ; &
c’eft aufli ce que fignifie la torche qu’il tenoit à la
main ; car au point dujour, il fait un peu-clair, mais
fi peu, qii’on a encore befoin d’un flambeau qui
éclaire.
L’aurore aux doigts de rofe, & croceo velamint
fulgens, fe peignoir en femme ayant un grandvoile
& étant traînée dans un char à deux chevaux ; le
voile qu’elle portoit fur fa tête, étoit fort reculé en
arriéré, ce qui marque que la clarté duyottr eft déjà
affez grande, & que l’obfcurité de la nuit fe dif-
fipe,.
Le midi, quùmmedià fo l àureusfplendet olympo
étoit aufli peint en femme, à caule qu’il eft du «en-
re féminin dans la langue grecque.
Le loir ou le vèfper , infufeans terras jam croceo
noclis amiclu , étoit peint en homme qui tenoit le
voile lur fa tête, mais un peu en arriéré , parce que
l’obfcurité de la nuit ne fe répand qu’infenfiblement,
& laifle affez long-tems de la clarté pour fe conduire
encore.
Enfin le crépufcule du foir étoit repréfenté comme
celui du matin, par un petit garçon qui porte un
voile fur la tête ; mais il n’a point de flambeau ; il lui
feroit inutile, puifqu’il va fe perdre dans les ténèbres
de la nuit ; il tient de fes deux petites mains les
rênes d’un des chevaux du char cle Diane , prife
pour la lune , & qui court fe précipiter aufli dans les
Ondes de l’Océan, kefperias abiturus in undas. D i cl.
Mythol. ( D . J . ) ■
Jour heweux & malheureux, ( Litt. ahc. & mod. )
quelque ridicule que foit l’idée qu’il y ait dans la nature
des jours plus heureux ou plus malheureux les uns
que les autres, il n’en eft pas moins vrai que de tems
immémorial, les plus célébrés nations du monde,
les Chaldéens , les Egyptiens, les Grecs & les Romains
, ont également donné dans cette opinion fu-
perftitieufe , dont tout l’Orient eft encore convaincu.
Les rois d’Egypte, félon Plutarque, ri’expédioient
aucune affaire lé troifieme jour de la femaine, &
s’abftenoient ce jour-là de manger jufqu’à la n u it,
parce que c’étoit 1 e jour funefte de la naiffance de
Typhon. Ilstenoient aufli le dix-feptieme jour pour
infortuné , parcequ’Ofiris étoit mort ce jour-là. Les
Juifs pouffèrent fi loin leur extravagance à cet égard,
que Moyfe mit leurs recherches au rang„des divinations
, dont Dieu leur défendoit la prÆKfue.
Si je pafl'e aux G recs, je trouve chez eux la lifté'
de leurs jours apophrades ou malheureux, ce qui a
fait dire plaifammeht à Lucien > en pariant d’un fâ-
I