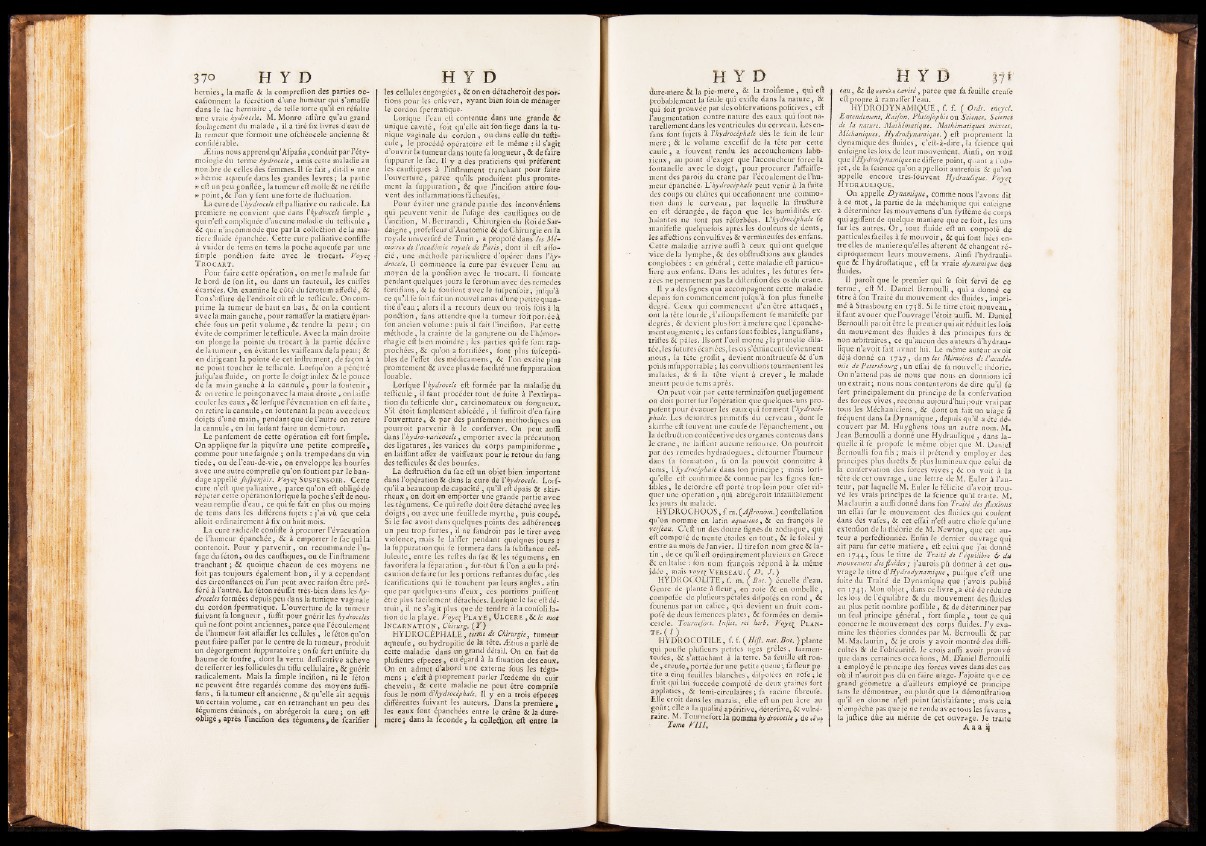
hernies, la mafle & la compreflïon des parties oc-
cafionnent la fécrétion d’une humeur qui s’amafle
dans le fac herniaire , de telle iorte qu’il en réfuhe
une vraie hydrocele. M. Monro allure qu’au grand
foulagement du malade , il a tiré ftx livres d’eau de
la tumeur que formoit une ofchéocele ancienne 8c
confidérable.
Ætius nous apprend qu’Afpafta, conduit par l’éty-
moiogie du terme hydrocdt, amis cette maladie au
nombre de celles des femmes. Il fe fa it , dit-il » une
» hernie aqueufe dans les grandes levres ; la partie
» eft un peu gonflée, la tumeur eft molle & ne rélifte
» point, 8c l’on y lent une forte de fluduation.
La cure de Y hydrocèle eft palliative ou radicale. La
première ne convient que dans Yhydrocele limple ,
qui n’eft compliquée d’aucune maladie du tefticule,
8c qui n’incommode que parla colleélion de la matière
fluide épanchée. Cette cure palliative conlifte
à vuider de temsen tems la poche aqueufe par une
fimple pon&ion faite avec le trocart. foyeç
T r o c a r t .
Pour faire cette opération, on met le malade fur
le bord de fon lit, ou dans un fauteuil, les cuifles
écartées. On examine le côté duferotum affeâé, 8c
l’on s’aflure de l ’endroit oit eft le tefticule. On comprime
la tumeur de haut en bas, 8c on la contient
avec là main gauche, pour ramafler la matière épanchée
fous un petit volume, 8c tendre la peau ; on
évite de comprimer le tefticule. Avec la main droite
on plonge la pointe du trocart à la partie déclive
de la tumeur , en évitant les vaiffeaux de la peau ; 8c
en dirigeant la pointe de cet inftrument, de façon à
ne point toucher le tefticule. Lorfqu’on a pénétré
jufqu’au fluide, on porte le doigt index 8c le pouce
de la main gauche à la cannule, pour la foutenir,
& on retire le poinçon avec la main droite, on laiffe
couler les eaux, 8c lorfque l’évacuation en eft faite,
on retire la cannule, en foutenant la peau avec deux
doigts d’une main, pendant que de l’autre on retire
la cannule , en lui faifant faire un demi-tour.
Le panfement de cette opération eft fort fimple.
On applique fur la piquûre une petite comprefle,
comme pour une faignée ; on la trempe dans du vin
tiede, ou de l’eau-de-vie, on enveloppe les bourfes
avec une autre compreiïe qu’on foutient par le bandage
appelle fufpenfoir. Voye^ SUSPENSOIR. Cette
cure n’eft que palliative, parce qu’on eft obligé de
répéter cette opération lorfque la poche s’eft de nouveau
remplie d’eau, ce qui le fait en plus ou moins
de tems dans les différens fujets : j’ai vû que cela
alloit ordinairement à lix ou huit mois.
Là cure radicale confifte à procurer l’évacuation
de l’humeur épanchée, 8c à emporter le fac qui la.
contenoit. Pour y parvenir , on recommande l’u-
fage du féton, ou des cauftiques, ou de l’inftrument
tranchant ; 8c quoique chacun de ces moyens ne
foit pas toujours également bon, il y a cependant
des circonftanccs oit l’un peut avec raifon être préféré
à l’autre. Le féton réuflit très-bien dans les hydrocèles
formées depuis peu dans la tunique vaginale
du cordon fpermatique. L’ouverture de la tumeur
fuivant fa longueur , fuffit pour guérir les hydrocèles
qui ne font point anciennes, parce que l’écoulement
de l’humeur fait affaiffer les cellules, le féton qu’on
peut faire paffer par le centre de la tumeur, produit
un dégorgement fuppuratoire ; onfe fert enfuite du
baume de foufre, dont la vertu deflicative achevé
derefferrer les follicules du tiffu cellulaire, & guérit
radicalement. Mais la fimple incifion, ni le féton
ne peuvent être regardés comme des moyens fuffi-
fans, fi la tumeur eft ancienne, & qu’elle ait acquis
un certain volume, car en retranchant un peu des
tégumens émincés, on abrégeroit la cure ; on eft
obligé > après l’inciûon des tégumens, de fearifier
les cellules engorgées, & on en détacheroit des portions
pour les enlever, ayant bien foin de ménager
le cordon fpermatique.
Lorfque l’eau eft contenue dans une grande ÔC
unique ca vité, foit qu’elle ait fon fiege dans la tunique
vaginale du cordon, ou dans celle du tefticule
, le procédé opératoire eft le même : il s’agit
d’ouvrir la tumeur dans toute fa longueur, & de faire
fuppurer le fac. Il y a des praticiens qui préfèrent
les cauftiques à l’inftrument tranchant pour faire
l’ouverture, parce qu’ils produifent plus promte-
ment la fuppuration, 8c que l’incifion attire fou-
vent des inflammations fâcheufes. '
Pour éviter une grande paitié des inconvéniens
qui peuvent venir de l’ufage des cauftiques ou de
l’incifion, M.Bertrandi, Chirurgien du Roi de Sardaigne
, profefleur d’Anatomie 8c de Chirurgie en là
royale univerfité de Turin , a propofé’dans les Mémoires
de l'académie royale de Paris, dont il eft affo-
c ié , une méthode particulière d’opérer dans l'hydrocèle.
Il commence la cure par évacuer l’eau au
moyen de la pon&ion avec le trocart. Il fomente
pendant quelques jours le ferotum avec des remedes
fortifia'ns, & le foutient avec le fufpenfoir, jufqu’à
ce qu’il fe foit fait un nouvel amas- d’une petite quantité
d’eau ; alors il a recours deux ou trois fois à la
ponction, fans attendre que la tumeur foit portée à
fon ancien volume : puis il fait l’incifton. Par cette
méthode, la crainte de la gangrené ou dé l’hcmor-
rhagie eft bien moindre ; les parties qui fè font rapprochées,
8c qu’on a fortifiées, font plus fufeepti-
bles de l’effet des médicamens, 8c l’on excite plus
promtement 8c avec plus de facilité une fuppuration
louable.
Lorfque Yhydrocèle eft formée par la maladie dit
tefticule , il faut procéder tout de fuite à l’extirpation
du tefticule dur, carcinomateux ou fongueux.
S’il étoit Amplement abfcédé , il fuffiroit d’en faire
l’ouverture, & par des panfemens méthodiques on
pourroit parvenir à le conferver. On peut auflî
dans Yhydro-varicocele, emporter avec la précaution
des ligatures, les varices du corps pampiniforme ,
en laiflant affez de vaiffeaux pour le retour du fang
des tefticules 8c des bourfes.
La deftruâion du fac eft un objet bien important
dans l’opération & dans la cure de l'hydrocèle. Lorf-
qu’il a beaucoup de capacité , qu’il eft épais & skir-
rheux, on doit en emporter une grande partie avec
les tégumens. Ce qui refte doit être détaché avec les
doigts, ou avec une feuille de myrthe, puis coupé.
Si le fac avoit dans quelques points des adhérences
un peu trop fortes, il ne faudroit pas le tirer avec
violence, mais le laifler pendant quelques jours :
la fuppuration qui fe formera dans la fubftance cel-
luleufè, entre les reftes du fac 8c les tégumens, en
favorifera la fépararion , fur-tôut fi l’on a eu la précaution
défaire fur les portions reliantes du fac,des
fcarifïcations qui fe touchent parleurs angles, afin
que par quelques-uns d’eu x, ces portions puiflent
être plus facilement détachées. Lorfque le fac eft détruit
, il ne s’agit plus que dé tendre à la confolida-
tion de la playe. foye^ Pla y e , U l c é r é , & le mot
In c a r n a t io n , Chirurg. ( T )
HYDROCÉPHALE, terme de Chirurgie, tumeur
aqueufe, ou hydropifie de la tête. Ætius a parlé de
cette maladie dans un grand détail. On en fait de
plufieurs efpeces, eu égard à la fituation des eaux.
On en admet d’abord une externe fous les tégumens
; c’eft à proprement parler l’oedème du cuir
chevelu, & cette maladie ne peut être comprife
fous le nom d'hydrocéphale. Il y en a trois efpeces
différentes fuivant les auteurs. Dans la première ,
les eaux font épanchées entre le crâne & la dure-
merej dans la fécondé* la collection eft entre la
dure-ntere 8c la pïe-mefe, & la troiôemè, qui eft
probablement la feule qui exifte dans la nature, &
qui foit prouvée par des obfervations pofttives, eft
l’augmentation contre nature des eaux qui font naturellement
dans les ventricules du cerveau. Les en-
fans font fujets à Y hydrocéphale dès le fein de leur
merè ; & le volume exceflif de la tête par cette
caufè, a fouvent rendu les accoucheraens laborieux,
au point d’exiger que l’accoücheür force la
fontanelle avec le doigt, pour procurer l’affaifle-
ment des parois du crâne par l’écoulement de l’humeur
épanchée. L 'hydrocéphale peut venir à la fuite
des coups ou chûtes qui occafionnent une commotion
dans le cerveau, par laquelle la ftruûure
en eft dérangée, de façon que les-humidités exhalantes
ne font pas réforbées. Vhydrocéphale fe
manifefte quelquefois après les douleurs de dents,
les affeftions convulftves & vermineufes des enfans.
Cette maladie arrive auflî à ceux qui ont quelque
v ice delà lymphe, 8c des obftruftions aux glandes
conglobées : en général ; Cette maladie eft particulière
aux enfans. Dans les adultes, les futures ferrées
ne permettent pas la diftenfion des os du crâne.
Il y a des Agnes qui accompagnent cette maladie
depuis fon commencement jufqu’à fôn plus funefte
degré. Ceux qui commencent d’en être attaqués ,
ont la tête lourde ,-l’afloupiflement fe manifefte par
degrés, & devient plus fort àmefure que l’épanchement
augmente ; les enfans font foibles, langùiflans,
triftes 8c pâles. Ils ont l’oeil morne ; la prunelle dilatée,
les futures écartées, les os s’émincent deviennent
mous, la tête groflit, devient monftrueufe 8c d’un
poids infupportable ; les convullions tourmentent les
malades, & A la tête vient à crever, le malade
meurt peu de tems après.
On peut voir par cette terminaifon quel jugement
on doit porter lur l’opération que quelques-uns pro-
pofènt pour évacuer les eaux qui forment Yhydrocé-
phale. Les delordres primitifs du cerveau , dont le
skirrhe eft fouvent une caufe de l’épanchement, ou
la deftru&ion confécMtive des organes contenus dans
le crâne, ne laiffent aucune reflource. On pourroit
par des remedes hydradogues, détourner l’humeur
dans fa formation, A on la pouvoit connoitre à
tems, Y hydrocéphale dans fon principe; mais lorf-
qu’elle eft confirmée 8c connue par les Agnes fen-
libles, le defordre eft porté trop loin pour ofer rif-
quer une opération , qui abrégeroit infailliblement
les jours du malade.
HYDROCHO OS, f. m. ( Aflronom.) conftellation
qu’on nomme en latin aquarius, & en françois le
yerfeau. C ’eft un des douze Agnes du zodiaque, qui
eft compolé de trente étoiles en tout, 8c le foleil y
entre au mois de Janvier. Il tire fon nom grec & latin
, de ce qu’il eft ordinairement pluvieux en Grece
& en Italie : fon nom françois répond à la même
id é e , mais voye^ V er se a u . ( D . J.')
HYDROCOLITE, f. m. ( Bot. ) écuelle d’eau.
Genre de plante à fleur, en rofe 8c en ombelle,
compofée de plufieurs pétales difpofés en rond , 8c
foutenus par un calice, qui devient un fruit com-
pofé de deux femences plates, 8c formées en demi-
cercle. Tournefort. lnftit. rei herb. Voye{ P LAN T
E . ( / ) •
HYDROCOTILE, f. f . ( Hifl. nat. Bot. ) plante
qui pouffe plufteurs petites tiges grêles, farmen-
teufes, 8c s’attachant à la terre. Sa feuille eft rond
e , creufe, portée fur une petite queue; fa fleur petite
a cinq feuilles blanches, difpotées en rofe ; le
fruit qui lui fuccede compofé de deux graines fort
applaties, & femi-circulaires ; fa racine fibreufe-.
Elle croît dans les marais, elle eft un peu âcre au
goût; elle a la qualité apéritive, déterflve, 8c vulnéraire.
M. Tournefort la pomma hydrocoale * de élue
Tome H H .
eau, 8c de xotoXh cavité, parce que fa feuille creufe
eft propre à ramafler l’eau.
HYDRODYNAMIQUE, f. f. ( Ordr. encycl.
Entendement. Raifon. Philofophie ou Science. Scienci
de la nature. Mathématique. Mathématiques mixtes;
Méchaniques. Hydrodynamique. ) eft proprement là
dynamique des fluides, c’eft-à-dire, la fcience qui
enfeigne les loix de leur mouvement. Ainfl, on voir
que Y Hydrodynamique ne différé point, quant à l'objet
, de la fcience qu’on appelloit autrefois 8c qu’on
appelle encore très-fduvent Hydraulique, foyer
H y d r a u l iq u e .
On appelle Dynamique, comme nous l’avons dit
à ce mot, la partie de la méchanique qui enfeigne
à déterminer les mouvemens d’un fyftème de corpâ
qui agiffentde quelque maniéré que ce foit, les uns
furies autres. O r , tout fluide eft un compofé de
particules faciles à fe mouvoir, 8c qui font liées entre
elles de maniéré quelles altèrent 8c changent réciproquement
leurs mouvemens. Ainfi l’hydraulique
8c l’hydroftatique, eft la vraie dynamique de»
fluides.
Il paroît que le premier qui fe foit fervi de ce
terme, eft M. Daniel Bernoulli, qui a donné ce
titre à fon Traité du mouvement des. fluides, imprimé
à Strasbourg en 1738. Si le titre étoit nouveau,
il faut avouer que I’ouVrage l’étoit. •auflî. M. Daniel
Bernoulli pâroîtêtre le premier qui ait réduit les lois
du mouvement des fluides à des principes furs &
non arbitraires, ce qu’aucun des auteurs d’hydraulique
n’a voit fait avant lui. Le même autèur avoit
déjà donné en 172 7 , dans les Mémoires dé P académie
de Petersbourg, un effai de fa nouvelle théorie*
On n’attend pas de nous que nous en donnions ici
un extrait ; nous nous contenterons de dire qu’il fe
fert principalement du principe de la confervation
des forces viv es, reconnu aujourd’hui pour vrai par
tous les Méchaniciens , 8c dont on fait un ufage fi
fréquent dans la Dynamique, depuis qu’il a été découvert
par M. Huyghens fous un autre nom. M.
Jean Bernoulli a donné une Hydraulique , dans laquelle
il fe p.ropofe le même objet que M. Daniel
Bernoulli fon fils ; mais il prétend y employer des
principes plus dire&s & plus lumineux que celui de
la confervation des forces vives ; 8c on voit à la
tête de cet ouvrage, une lettre de M. Euler à l’auteur,
par laquelle M. Euler le félicite d’avoir trouv
é les vrais principes de la fcience qu’il traite. M.
Mâclaurin a aufli donné dans fon Traité des fluxions
un eflai fur le mouvement des fluides qui coulent
dans des vafes, & cet eflai n’eft autre chofe qu’une
extenfion de la théorie de M. Newton, que cet auteur
a perfectionnée. Enfin le dernier Ouvrage qui
ait paru fur cette matière, eft celui que j’ai donné
en 1744, fous le titre de Traité de l'équilibre & du
mouvement des fluides ; j’aurois pu donner à cet ouvrage
le titre d’Hydrodynamique, puifque c’eft une
fuite du Traité de Dynamique que j’aVois publié
en 1743. Mon objet, dans ce liv re , a été de réduire
les lois de l’équilibre & du mouvement des fluides
au plus petit nombre poflïble , & de déterminer par
un feul principe général, fort Ample, tout ce qui
concerne le mouvement des corps fluides. J’y examine
les théories données par M. Bernoulli 8c par
M. Maclaurin, 8c je crois y avoir montré des difficultés
& de l’obfcurité. Je crois aufli avoir prouvé
que dans certaines occafions, M. Daniel Bernoulli
a employé le principe des forces vives dans .des cas
où il n’auroit pas dû en faire ufage. J’ajoute que ce
grand géomètre a d’ailleurs eipployé ce principe
lans le démontrer, où.plutôt que la démonftration
qu’il en donne n’eft point fatisfaifante ; mais cela
n’empêche pas que je ne rende avec tous les fa vans ,
la juftice due au mérite de cet ouvrage. Je traite
A a a ij