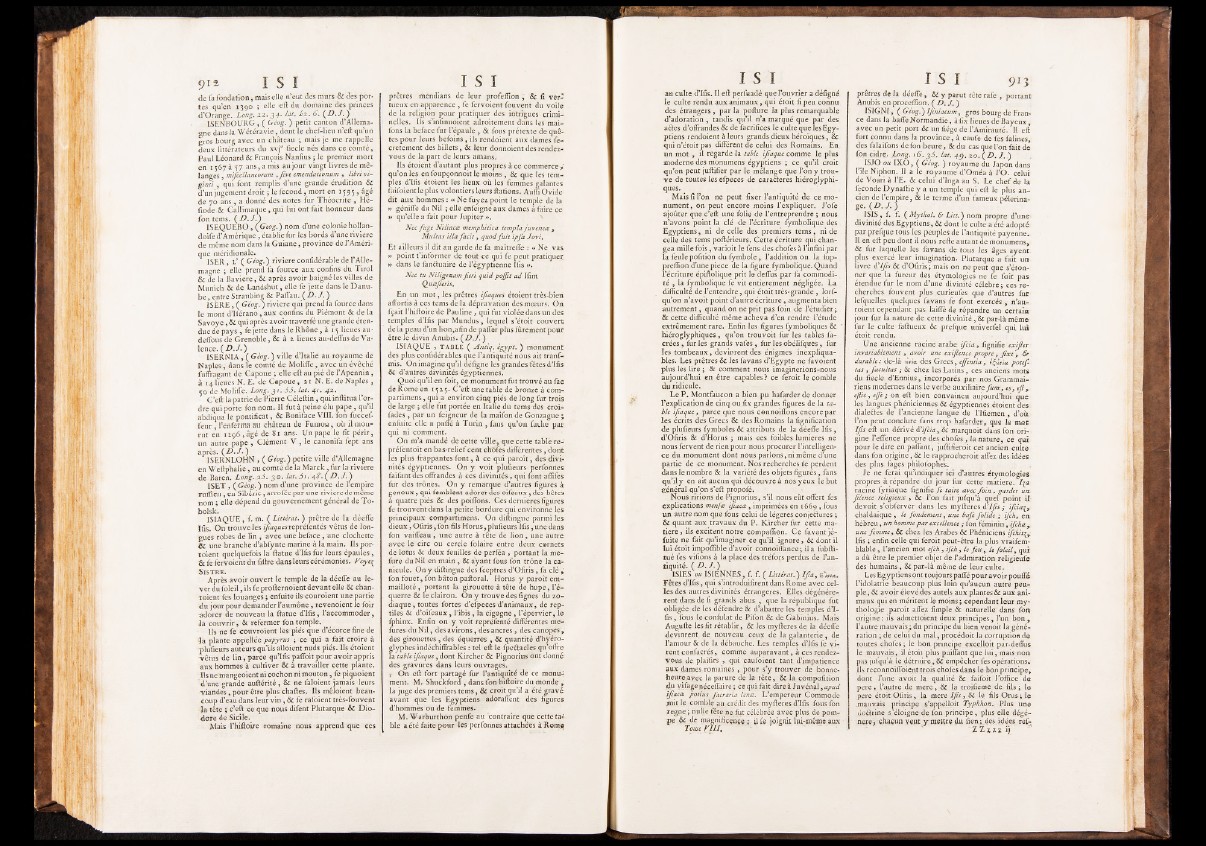
I S I
de fa fondation ; mais elle n’eut des murs & des portes
qu’en 1390 ; elle eft du domaine des princes
d’Orange. .Long. 22. 34. lat. 5 z . 6 . (D .J . )
ISENBOURG , ( Géog. ) petit canton d’Allemagne
dans la Wctéravie, dont le chef-lieu n’eft qu’un
gros bourg avec un château ; mais je me rappelle
deux littérateurs du xvje fiecle nés dans ce comté,
Paul Léonard & François Nanfius ; le premier mort
en 1567 à 57 ans, a mis au jour vingt livres de mélanges
, mifcellaneorum ,five emendationum , libri yi-
ginti , qui font remplis d’une grande érudition 8c
d’un jugement droit ; le fécond, mort en 1595 , âgé
de 70 ans , a donné des notes fur Théocrite , Hé-
fiod e& Callimaque, qui lui ont fait honneur dans
fon tems. (D . J . )
ISEQUEBO, ( Geog.) nom d’une colonie hollan-
doife d’Amérique , établie fur les bords d’une riviere
de même nom dans la Guiane, province de l’Amérique
méridionale. -
ISER, l’ ( Géog.') riviere confidérable de l’Allemagne
; elle prend fa fource aux confins du Tirol
& de la Bavière, & après avoir baigné les villes de
Munich & de Landshut, elle fe jette dans le D anube
, entre Straubing 8c Paffau. ( D. J. )
ISÈRE, ( Géog!) riviere qui prend fa fource dans
le mont d’Ilérano, aux confins du Piémont & de la
Savoy e , 8c qui après avoir traverfé une grande étendue
de pays , fe jette dans le Rhône, à 15 lieues au-
deffous de Grenoble, & à 2 lieues au-deffus de V alence.
( D .J . )
ISERNIA, ( Géog. ) ville d’Italie au royaume de
Naples , dans le comté de Moliffe, avec un évêché
fuffragant de Capoué ; elle eft au pié de l’Apennin ,
à 14 lieues N. E. de Capoue, 11 N. E. de Naples ,
50 de Moliffe. Long. 3 /. 55. lat. 41. 42.
C ’eft la patrie de Pierre Céleftin, qui inftitua l’ordre
oui porte fon nom. Il fut à peine élu pape, qu’il
abdiqua le pontificat, 8c Boniface VIII/fon fuccef-
feur , l’enferma au château de Fumoa, où il mourut
en 1 19 6, âgé de 81 ans. Un pape le fit périr,
un autre pape , Clément V , le canonifa fept ans
après. (D . J . )
ISERNLOHN , ( Géog.) petite ville d’Allemagne
en "Weftphalie, au comté de la Marck, fur la riviere
de Baren. Long.,25. 3 0. Int. 5 i. 4 8 . (D .J . )
ISE T , (Geog.) nom d’une province de l’empire
ruffien , en Sibérie, arrofée par une riviere de même
nom ; elle dépend du gouvernement général de To-
bolsk.
ISIAQUE, f. m. ( Littérat. ) prêtre de la déeffe
Ifis. On trouve les ifiaques reprétentés vêtus de longues
robes de lin , avec une beface, une clochette
& une branche d’abfynte marine à la main. Ils por-
toient quelquefois la ftatue d’Ifis fur leurs épaules,
'& fe fervoient du fiftre dans leurs cérémonies. Voye^
Sistr e.
Après avoir ouvert le temple de la déeffe au lever
du foleil, ils fe profternoïent devant elle 8c chan-
toient fes louanges ; enfuite ils couroient une partie
du jour pour demander l’aumône, revenoient le foir
adorer de nouveau la ftatue d’Ifis, l’accommoder,
la couvrir , & refermer fon temple.
Ils ne fe couvroient les piés que d’écorce fine de
3a plante appellée papyrus ; ce qui a fait croire à
plufieUrs auteurs qu’ils alloient nuds piés. Ils étoient
vêtus de lin , parce qu’Ifis paffoit pour avoir appris
aux hommes à cultiver & à travailler cette plante.
Ils ne mangeoient ni cochon ni mouton, fe piquoient
d ’une grande auftérité, 8c ne faloient jamais leurs
viandes , pour être plus chaftes. Ils mêloient beaucoup
d’eau dans leur v in , 8c fe ral'oient très-fouvent
la tête ; c’eft ce que nous difent Plutarque 8c Dio-
dore de Sicile. Mais l’hiftoire romaine nous apprend que ces
I S I
prêtres mendians de leur profeflîon , & fi vertueux
en apparence , fe fervoient fouvent du voile
de la religion pour pratiquer des intrigues criminelles.
Ils s’infinuoient adroitement dans les mai-
fons la beface fur l’épaule , & fous prétexte de quêtes
pour leurs befoins , ils rendoient aux dames fe-
cretement des b illets, & leur donnoient des rendez-
vous de la part de leurs amans.
Ils étoient d’autant plus propres à ce commerce
qu’on les en foupçonnoit le moins , 8c que les temples
d’Ifis étoient les lieux où les femmes galantes
faifoient le plus volontiers leurs ftations. Auffi Ovide
dit aux hommes : « N e fuyez point le temple de la
» géniffe du Nil ; elle enfeigne aux dames à faire ce
» qu’elle a fait pour Jupiter ».
Nec fuge Niliacæ mtmphitica templa juvenca ,
Multas ilia facit, quod fuit ipfa Jovi.
Et ailleurs il dit au garde de fa maîtreffe : « Ne vas
» point t’informer de tout ce qui fe peut pratique!;
» dans le fan&uaire de l’égyptienne Ifis ».
Nec tu Niligenam fieri quid pojjit ad Ifim
Quçefitris.
En un mot, les prêtres ifiaques étoient très-bien
affortis à ces tems de la dépravation des moeurs. On
fçait l’hiftoire de Pauline , qui fut violée dans un des
temples d’Ifis par Mundus, lequel s ’étoit couvert
de la peau d’un lion,afin de paffer plus fûrement pour
être le divin Anubis. ( D .J. )
ISIAQUE , t a b l e ( Antiq. égypt. ) monument
des plus confidérables que l’antiquité nous ait tranf-
mis. On imagine qu’il défigne les grandes fêtes d’Ifis
8c d’autres divinités égyptiennes.
Quoi qu’il en foit, ce monument fut trouvé au fac
de Rome en 1525. C ’eft une table de bronze à com-
partimens, qui a environ cinq piés de long fur trois
de large ; elle fut portée en Italie du tems des croi-
fades, par un feigneur de la maifon de Gonzague ;
enfuite elle a paffé à Turin , fans qu’on fâche par
qui ni comment.
On m’a mandé de cette ville , que cette tablé re-
préfentoit en bas-relief cent chôfes différentes, dont
les plus frappantes fon t, à ce qui paroît, des divinités
égyptiennes. On y voit plufieurs perfonnes
faifant des offrandes à ces divinités, qui font allifes
fur des trônes. On y remarque d’autres figures à
genoux, qui femblent adorer des oifeaux, des bêtes
à quatre piés 8c des poiffohs. Ces dernieres figures
fe trouvent dans la petite bordure qui environne les
principaux compartimens. On diftingue parmi les
dieux, Ofiris, fon fils Horus, plufieurs Ifis, une dans
fon vaiffeau, une autre à tête de lion, une autre
avec le cire ou cercle folaire entre deux c®rnets
de lotus & deux feuilles de perféa , portant la me-
fure du Nil en main , & ayant fous fon trône la canicule.
On y diftingue des feeptres d’Ofiris , fa clé
fon fouet, fon bâton paftoral. Horus y paroît emmailloté
, portant la girouette à tête de hupe, l’équerre
8c le clairon. On y trouve des lignes du zodiaque
, toutes fortes d’efpeces d’animaux, de reptiles
& d’oifeaux, l ’ibis, la cigogne , l’épervier, le
fphinx. Enfin on y voit repréfenté différentes me-
fures du N il, des avirons, des ancres, des canopes
des girouettes, des équerres , 8c quantité d’hÿéro-
glyphes indéchiffrables : tel eft le fpeûacles qu’offre
la table ijîaque, dont Kircher 8c Pignorius ont donné
des gravures dans leurs ouvrages.
ï On eft fort partagé fur l’antiquité de ce monu-;
ment. M. Shuckford , dans fon hiftoire du monde
la juge des premiers tems, 8c croit qu’il a été gravé
avant que les Egyptiens adoraffent des figures
d’hommes ou de femmes. M.ble a éWtéa frabiuter tphoounr pleensf pee arfuo ncnoenst raattiarec hqéuees càe tte taRome
I S I
au culte d’Ifis. Il eft perfuadé que l’ouvrier a défigiié
le culte rendu aux animaux , qui étoit fi peu connu
des étrangers , par la pofture la plus remarquable
d’adoration, tandis qu’il n’a marqué que par des
aftes d’offrandes & de facrifices le culte que les Egyptiens
rendoient à leurs grands dieux héroïques, 8c
qui n’étoit pas différent de celui des Romains. En,
un mot , il regarde la table ijîaque comme le plus
moderne des monumens égyptiens ; ce qu’il croit
qu’on peut juftifier par le mélange que l’on y trouv
e de toutes les efpeces de cara&eres hiéroglyphiques.
Mais lî l’on ne peut fixer l’antiquité de ce monument,
on peut encore moins l’expliquer. J’ofe
ajoûter que c’eft une folie de l’entreprendre ; nous
n’avons point la clé de l’écriture fymbolique des
Egyptiens, ni de celle des premiers tems, ni de
celle des tems poftérieurs. Cette écriture qui changea
mille fois, varioit le fens des chofes à l’infini par
la feule pofition du fymbole, l’addition ou la fup-
preffion d’une piece de la figure fymbolique. Quand
l’écriture épiftolique prit le deffus par fa commodi- ,
té , la fymbolique fe vit entièrement négligée. La
difficulté de l’entendre, qui étoit très-grande , lorf-
qu’on n’avoit point d’autre écriture, augmenta bien
autrement, quand on ne prit pas foin de l’étudier ;
& cette difficulté même acheva d’en rendre l’étude
extrêmement rare. Enfin les figures fymboliques & '
hiéroglyphiques, qu’on trouvoit fur les tables fa-
crées , fur les grands vafes, fur les obélifques, fur
les tombeaux, devinrent des énigmes inexpliqua-
bles. Les prêtres 8c les favans d’Egypte ne favoient
plus les lire ; & comment nous imaginerions-nous
aujourd’hui en être capables ? ce feroit le comble
du ridicule.
Le P. Montfaùcon a bien pu hafarder de donner
l’explication de cinq ou fix grandes figures de la table
ijîaque, parce que nous cennoiffons encore par
les écrits des Grecs 8c des Romains la lignification
de plufieurs fymboles & attributs de la déeffe Ifis,
d’Ofiris & d’Horus ; mais ces foibles lumières ne
nous fervent de rien pour nous procurer l ’intelligence
du monument dont nous parlons, ni même d’une
partie de ce monument. Nos recherches fe perdent
dans le nombre & la variété des objets figurés, fans
qu’il y en ait aucun qui découvre à nos yeux le but
général qu’on s’eft propofé.
Nous ririons de Pignorius, s’il nous eût offert fes
explications menfee ifiaccz, imprimées en 1669 , fous
un autre nom qpe fous celui de légères conjectures ;
& quant aux travaux du P. Kircher fur cette matière
, ils excitent notre compaffion. Ce favant jé-
fuite ne fait qu’imaginer ce qu’il ignore, 8c dont il
lui étoit impoffible d’avoir connoiffance ; il a fubfti-
tué fes vifions à la place des tréfors perdus de l’antiquité.
( D . J. )
IS1ES ou ISIENNES, f. f. ( Littérat.) IJîa, e')<na..
Fêtes d’Ifis, qui s’introduifirent dans Rome avec celles
des autres divinités étrangères. Elles dégénérèrent
dans de fi grands abus , que la république fut
obligée de les défendre & d’abattre les temples d’Ifis
, fous le confulat de Pifon 8c de Gabinius. Mais
Augufte les fit rétablir, 8c les myfteres de la déeffe
devinrent de nouveau ceux de la galanterie, de
l’amour & de la débauche. Les temples d’Ifis fe v irent
confacrés, comme auparavant, a ces rendez-
vous de plaifirs , qui caufoient tant d’impatience
aux dames romaines , pour s’y trouver de bonne-
heure .avec la parure de la tête, 8c la compofition
du yifage néceffaire ; ce qui fait dire à Juvénal, apud
ijîaca potins facraria lentz. L’empereur Commode
mit. le comble au crédit des myfteres d’Ifis fous fon
régné ; nulle fête ne fut célébrée avec plus de pompe
8c de magnificence ; il fe joignit lui-même aux
Tout F in . ' ■ -
I S I 913
prêtres de la déeffe, & y parut tête rafe , portant
Anubis en proceffion. ( D . J . )
ISIGNI, ( Géog. ) IJiniacum, gros bourg de France
dans la baffe Normandie, à fix lieues deBayeux,
avec un petit port & un fiége de l’Amirauté. Il eft
fort connu dans la province, à caufe de fes falines,
des falaifons de fon beure, & du cas que Bon fait de
fon cidre. Long. 16 .3 5 . lat. 4c). 20. (D . J. )
^ ISJO ou IX O , ( Géog. ) royaume du Japon dans
l’île Niphon. Il a le royaume d’Oméa à l’O. celui
de Vo^ri à l’E. & celui d’Inga au S. Le chef de la
fécondé Dynaftie y a un temple qui eft le plus an-
cien de l’empire, & le terme d’un fameux pèlerinage.
( D . J . )
(SIS, f. f. ( Mythol. & Litt. ) nom propre d’une-
divinité des Egyptiens-, 8c dont le culte a été adopté)
. par prefque tous les peuples de l’antiquité payenne.
Il en eft peu dont il nous refte autant de monumens,
8c fur laquelle les favans de tous les âges ayent.
plus exercé leur imagination. Plutarque a fait un
livre d’ Ifis,8c d’Ofiris; mais on .ne peut que s’étonner
que la fureur des étymologies ne fe foit pas
étendue fur le nom d’une divinité célébré ; ces recherches
fouvent plus curieufes que d’autres fur
lefquelles quelques favans fe font exercés , n’au-
roient cependant pas laiffé de répandre un certain
jour fur la nature de cette divinité , 8c par-là même
fur le culte faftueux 8c prefque univerfel qui lu»
étoit rendu.
Une ancienne racine arabe i f cia, fignifie exijler
invariablement , avoir une exijlence propre, fixe t &
durable: de-là «V/* des Grecs, efientia, l&eU potefi
tas , facultas ; & chez les Latins, ces anciens mots
du fiecle d’Ennius, incorporés par nos Grammairiens
modernes dans le verbe auxiliaire fum.t es, ejl,
eflis, ejfe; on eft bien convaincu aujourd’hui que
les langues phéniciennes 8c égyptiennes étoient des
dialeûes de l’ancienne langue de l’Ifiemen, d’où
l’on peut conclure fans trop hafarder , que le mot
Ifis eft un dérivé d’i f cia, &: marquoit dans fon origine
l’effence propre des chofes , la nature, ce qui
pour le dire en paffant, juftifieroit cet ancien culte
dans fon origine, 8c le rapprocheroit allez des idées
j des plus fages philofophes.
Je ne ferai qu’indiquer ici d’autres étymologies
propres à répandre du jour fur cette matière. I{a
racine fyriaque fignifie fe taire avec fo in , garder un
Jîlence religieux , 8c l’on fait jufqu’à quel point il
devoit s’obferver dans les myfteres d’ Ifis ; ifeia
chaldaïque , le fondement, une bafe folide ; ifch, en
hébreu, un homme par excellence ; l'on féminin, ifcka ,
une femme, 8c chez les Arabes & Phéniciens ifehit^
Ifis ; enfin celle qui feroit peut-être la plus vraifem-
blable, l’ancien mot efch, ifch, le feu , le foleil, qui
a dû être le premier objet de l’admiration religieufe
des humains, 8c par-là même de leur culte.
Les Egyptiens ont toujours paffé pour avoir pouffé
l’idolâtrie beaucoup plus loin qu’aucun autre peuple;
8c avoir élevé des autels aux plantes & aux animaux
qui en méritent le moins ; cependant leur mythologie
paroît affez limple & naturelle dans fon
origine : ils admettoient deux principes, l’un bon ,
l’autre mauvais •, du principe du bien venoit la génération
; de celui du mal, procédoit la corruption de
toutes chofes ; le bon principe excelloit par-deffus
le mauvais, il étoit plus puiffant que lui, mais'non
pas jufqu’à le détruire, & empêcher fes opérations.
Ils reconnoiffoient trois chofes dans le bon principe,
dont l’une avoit la qualité 8c faifoit l ’office de
p e r e l ’autre de mer e , & la trojfieme de fils ; le
pere étoit Offris, la mere Ifis, 8c le fils C ru s ; le
.mauvais principe s’appelloit Typhhon. Plus une
doftrine s’éloigne de fon principe, plus elle dégénéré,
chacun veut y mettre du fien; des idées ref-
1 ' Z Z z z z i )