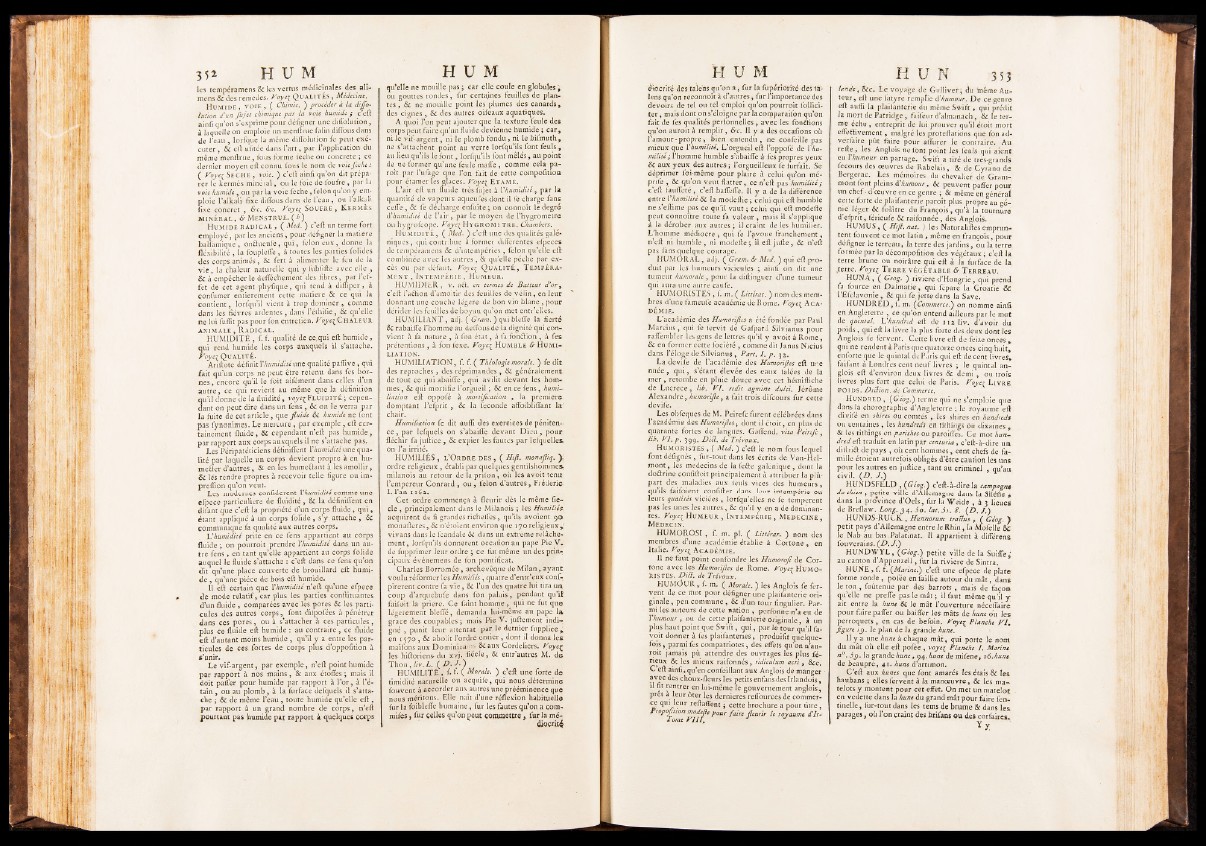
les tempéramens 8c les vertus médicinales des ali-
mens 8c des remedes. Voye[ Qualités , Medecine. Humide , voie , ( Chimie. ) procéder a la dijfo-
lution d'un fujet chimique par la voie humide ; c’eft
ainfi qu’on s’exprime pour défigner une diflolution,
à laquelle on emploie un menftrue falin diflous dans
de l’eau , lorfque la même diflolution fe peut exécuter,
8c eft ufitée dans l’a r t , par l’application du
même menftrue, lous forme leche ou concrète ; ce
dernier moyen eft connu fous le nom de voiefeche:
( Voye{ Seche , voie. ) c’eft ainfi qu’on dit préparer
le kermès minéral, ou le foie de^oufre , par la
voie humide, ou par la voie feche, félon qu’on y emploie
l ’alkali fixe diflous dans de l’eau , ou l’alkali,
fixe concret , &c. &c. Vvye{ Soufre , K.ermés MINÉRAL, H & MENSTRUE, (h) umide radical , ( Med. ) c’eft un terme fort
employé, parles anciens, ppur défigner la matière
balfamique , onâueufc, qui, félon eu x , donne la
flexibilité , la fouplefle , à toutes les parties folides
des corps animés, 8c fert à alimenter le feu de la
v i e , la chaleur naturelle qui y fubfifte avec elle ,
& à empêcher le deflechement des fibres, par l’effet
de cet agent phyfique, qui tend à diffiper, à
çonfumer entièrement cette matière & ce qui la
contient, lorfqu’il vient à trop dominer , comme
dans les fièvres ardentes, dans l’éthifie, Sc qu’elle
ne lui fuftit pas pour fon entretien. Voye^ Chaleur
animale , Radical.
HUMIDITÉ , f. f. qualité de ce,qui eft humide,
qui rend humide les corps auxquels il s’attache.
Voyi\ Qualité. Ariftote définit Y humidité une qualité paflive , qui
fait qu’un corps ne peut être retenu dans fes bornes
, encore qu’il le foit aifément dans celles d’un
autre, ce qui revient au même que la définition
qu’il donne de la fluidité , voye^ Fluidité ; cependant
on peut dire dans un fens , & on le verra par
la fuite de cet a rticle, que fluide 8c humide ne font
pas fynonimes. Le mercure, par exemple, eft certainement
fluide, 8c cependant n’eft pas humide,
par rapport aux corps auxquels il ne s attache pas.
Les Péripatéticiens définiflent Y humidité une qualité
par laquelle un corps devient propre à en hu-
me&er d’autres, & en les humeûant à les amollir,
& lés rendre propres à recevoir telle figure ou im-
preflion qu’on veut.
Les modernes confiderent Yhumidité comme une
cfpcce particulière de fluidité , 8c la définiflent en
difant que c’eft la propriété d’un corps fluide, q u i,
étant appliqué à un corps folide, s’y attache , 8c
communique fa qualité aux autres corps.
L'humidité prife en ce fens appartient au corps
fluide ; on pourroit prendre Yhumidité dans un autre
fens, en tant qu’elle appartient au corps folide
auquel le fluide s ’ attache : c’eft dans ce fens qu’on
dit qu’une place couverte de brouillard eft humide
, qu’une pièce de bois eft humide.
Il eft certain que Yhumidité n’eft qu’une efpece
de mode relatif, car plus les parties conftituantes
d’un fluide , comparées avec les pores 8c les particules
des autres corps, font dilpofées à pénétrer
dans ces pores, ou à s’attacher à ces particules,
plus ce fluide eft humide : au contraire , ce fluide
eft d’autant moins humide , qu’il y a entre les particules
de ces fortes de corps plus d’oppofition à
s’unir.
Le vif-argent, par exemple, n’eft point humide
par rapport à nos mains, & aux étoffes ; mais il
doit pafler pour humide par rapport à l ’o r , à l’étain
, ou au plomb, à la furface defquels il s’attache
; 8c de même l’eau , toute humide qu’elle eft ,
par rapport à un grand nombre de corps, n’eft
pourtant pas humide pat rapport à quelques corps
qu’elle ne mouille pas ; car elle coule en globules ,
toeus ,g o8uc ttnees rmoonudiellse, pfourin ct elretsa ipnleusm feesu idlleess cdaen aprladns,
desA cqigunoei sl ’,o n8 cp deuest aajuoturetesr oqiufeea luax teaqxutuarteiq fueeusl.e des
cnoi rlpe sv pief-uatr fgaeirnet q, un’iu nle f lpuliodme bd efvoinednun,e nhiu lme ibdief m; cuathr,,
anue lsi’eaut tqacuh’ielsn lte pfooinntt, alour fvqeur’riels lfoornftq mu’êillsé fso, natu f peuolisn t,
rdoeî tn ep afor rlm’uefar gqeu ’quunee fl’eounle fmaiatf ld'ee , cectotem mcoem cpeolafi tpioaa-
pour étamer les glaces. Voye^ Et AME.
L’ air eft un fluide très fujet à Yhumidité, par la
quantité de vapeurs aqueufes dont il fe charge fans
ce fle, 8c fe décharge enfuite ; or? connoît le degré
d'humidité de l’a ir , par le moyen de l’hygrometre
ou Humidité,hygrofeope. Voye^( Hygromltre. Chambers. tueems p, éqruami ceonnst r8icb Med. ) c’eft une des qualités galédnieq
ude’i nàt efmorpméerire sd i,f fféérleonnt eqsu ’eeflplee ces ccèosm obuin épea ra vdeécf aluets. autres, & qu’elle pèche par exVoye^
eft: Qualité, Tempéram
ent, Intempérie, Humeur.
HUMIDIER, v. a£h en termes de Batteur d'ory c’eft l’aftion d’amoitir des feuilles de vélin, en leur
ddéornindaenr tl eusn fee uciolulecsh dee lbéogyèraeu dqeu ’boonn m veint ebnlatrn’cel î,e pso. ur
HUMILIANT, adj, ( Gram. ) qui blefle la fierté
8c rabaifle l’homme au de flous de la dignité qui convient
à fa nature , à fon état, à fa fonftion , à fes
prétentions, à fon fexe. Voye^ Humble & Humiliation.
HUMILIATION, f. f. ( Théologie morale. ) fe dit
des reproches , des réprimandes , 8c généralement
de tout ce qui abaifle , qui avilit devant les hommes
, 8c qui mortifie l’orgueil ; 8c en ce fens, humiliation
eft oppofé à mortification , la premier©
domptant l ’efprit , 8c la fécondé affoibliflant la:
chair.
Humiliation fe dit aufli des exercices de pénitence
, par lefqùels on s’abaifle devant D ie u , pour
fléchir fa juftice, 8c expier les fautes par lefquelle*
on l’a irrité.
HUMILIÉS , l’Ordre des , ( Hift. monafliq. njj
ordre religieux , établi par quelques gentilshommes-,
milanois au retour de la prifon, oii les avoit tenu
l’empereur Conrard, o u , félon d’autres, Frédéric
I. l’an 1 162.
Cet ordre commença à fleurir dès le même fie-
cle , principalement dans le Milanois ; les Humiliés.
acquirent de fi grandes richefl'es, qu’ils avoient 90
monafteres, 8c n’étoient environ que 170 religieux,!
vivans dans le fcandale 8c dans un extrême relâchement,
lorfqu’ils donnèrent occafion au pape Pie V .
de fupprimer leur ordre ; ce fut même un des principaux
événemens de fon pontificat.
Charles Borromée, archevêque de Milan, ayant
voulu réformer les Humiliés, quatre d’entr’eux confi»,
pirerent contre fa v ie , 8c l’un des quatre lui tira un
coup d’arquebufe dans fon palais, pendant qu’i î
faifoit la priere. Ce faint homme, qui ne fut que
légèrement blefle, demanda lui-même au pape la
grâce des coupables; mais Pie "V. juftement indigné
, punit leur attentat par le dernier fupplice*
en 1 5 7 0 ,8c abolit l’ordre entier , dont il donna les
maifons aux Dominical^ 8c aux Cordeliers, Voyeç
les hiftoriens* du xvj. fiécle, 8c entr’autres M. de
Thou , liv. L. ( D . J . )
HUMILITÉ , f. f- ( Morale. ) c’ eft une forte de
timidité naturelle ou acquife, qui nous détermine
fouvent à accorder aux autres une prééminence que
nous méritons. Elle naît d’une réflexion habituelle
fur la foibleffe humaine, fur les fautes qu’on a com-
mifes, fur celles qu’on peut commettre, fur la médiocrité
'otôcrifé des tàlehs qu’on a t fur la fupéribrité des ta-
lens qu’on reconnoît à d’autres, fur l’importance des
devoirs de tel ou tel emploi qu’on pourroit follici-
te r , mais dont on s’éloigne par lacoipparaifon qu’on
fait de fes qualités perfonnelles , avec les fondions
qu’on auroit à remplir, &c. Il y a des occafions où
l’amour - propre > bien , entendu , ne confeille pas
mieux que Yhumilité. L’orgueil eft l’oppofé de Y humilité
; l’homme humble s’abaiffe à fes propres yeux
8c aux yeux des autres ; l’orgueilleux fe furfait. Se
déprimer foi-même pour plaire à celui qu’on mé-
prife , 8c qu’on veut flatter, , ce n’eft pas humilité;
c’eft fauffeté, c’efl baflefle. Il y a de la différence
entre YhumiUté 8c la modeftie ; celui qui eft humble
ne s’eftime pas ce qu’il vaut ; celui qui eft modefte
peut connoître toute fa valeur , mais il s’applique
à la dérober aux autres ; il craint de les humilier.
L ’homme médiocre ; qui fe l’avoue franchement,
n’eft ni humble, ni modefte; il eft ju fte, 8c n’eft
pas fans quelque courage.
HUMORAL, adj. ( Gram•. & Med. ) qui eft produit
par les' humeurs viçieufes ; ainli on dit une
tumeur humorale , pour la diftinguer d’une tumeur
qui aura une autre caùfe.
HUMORISTES , f. m. ( Lïttérat. ) nom des membres
d’une fameufe académie de Rome. Voye^ Ac a d
é m ie .
L’académie des Humorïfles a été fondée par Paul
Marcius, 'qui fe fervit de Gafpard Silvianus pour
raffembler les gens de lettres qu’il y avoit à Rome,
8c en former cette fociété , comme dit Janus Nicius
dans l’éloge de Silvianus , Part. I. p. 32.
La devife de l’académie des Humoriftes eft une
nu ée, qui, s’étant élevée des eaux lalées de la
mer, retombe en pluie douce avec cet hémiftiche
de Lucrèce, lib. VI. redit agmine dulci. Jérôme
Alexandre , humorifle, a fait trois difeours fur cette
devife.
Les obfeques de M. Peirefc furent célébrées dans
l’académie des Humoriflesy dont il étoit, en plus de
quarante fortes de langues. Gaffend. vita Peirefc,
lib. VI. p. 399. Dicl. de Trévoux.
H um o r ist e s , ( Med. ) c’eft le nom fous lequel
font défignés , fur-tout dans les écrits de Van-Hel-
mont, les médecins de la feôe galénique, dont la
doftrine confiftoit principalement à attribuer la plupart
des maladies aux feuls vices des humeurs,
qu’ils faifoient confifter dans leur intempérie ou
leurs qualités viciées ,lor fq u ’elles ne fe temperent
pas les unes les autres, 8c qu’il y en a de dominantes.
Voyeç H um eu r , In t em p é r ie , Me d e c in e ,
Mé d e c in .
HUMOROSI , f. m. pl. ( Llttérar. ) nom des
membres d’une académie établie à Cortone, en
Italie. Voye^ ACADÉMIE.
Il ne faut point confondre les Humoroji de Cortone
avec les Humoriflts de Rome. Voye£ Humo- hlSTES. Dicl. de Trévoux.
HUMÔUR, f. m. ( Morale, ) les Anglais fe fervent
de ce rfiot pour defignerune plaifanterie originale
, peu commune, 8c d’un tour fingulier. Parmi
les auteurs de cette nation , perfonne n’a eu de
Yhumour , ou de cette plaifanterie Originale à un
plus haut point que Swift, qui, par le tour qu’il fa-
voit donner à fes plaifantenes, produifit quelquefois
) parmi fes compatriotes y des effets qu’on n’au-
roit jamais pu attendre des ouvrages les plus fé-
rieux 8ç les mieux raifonnés, ridiculum acri, 8cc.
C ’eft ainfi* qu’en confeillant aux Anglois de manger ■
avec des choux-fleurs les petitsenfans des Irlandois,
il. fit rentrer^en lui-même le gouvernement anglois,
prêt a leur oter les dernieres reffources de commer-
ce qui leur reftaffent ; cette brochure a pour titre ,
Proposition modefte pour faire fleurir le royaume d'ir-
lome VIH,
lande y 8cc. Le voyage de Gulliver; dli hiême Auteur
, eft une fatyre remplie d'humour. De ce genre
eft aufli la plailantefiè du même Svkift , qui prédit
la mort de Patridge, faifeur d’almanach, 8c le terme
échu , entreprit dé lui prouver qu’il étoit more
effeftivement, malgré les proteftatiöns qiie fon ad-
veffaire put faire pour aflurer le contraire. Au
refte * les Anglois ne l'ont point les feuls qui aient
eu 1 humour en partage. Swift a tiré de très-grands
fecours des oeuvres de Rabelais, & de Cyrano de
Bergerac. Les mémoires du chevalier de Gram-
mont font pleins d humour, 8c peuvent paffer pour
un chef - d’oeuvre en ce genre ; 8t même en général
cette forte de plaifanterie paroît plus propre au génie
léger 8c folâtre du François, qu’à la tournure
d’efprit, férieufe 8c raifonnée, des Anglois.
HUMUS, ( Hifl. nat. ) les Naturaliftes empruntent
fouvent ce mot latin, même en françois, pour
défigner le terreau, la terre des jardins, ou la terre
formée par la décompofition des végétaux ; c’eft la
terre brune ou noirâtre qui eft à la furface de la
,terre. Voye[ T erre végétable & T erreau.
HUNA, ( Geog. ) riviere d’Hongrie, qui prend
fa fource en Dalmatie, qui fépare la Croatie 8c
l ’EfcIavonie, 8c qui fe. jette dans la Save.
HU N DRED,!. m. {Commerce.') on nomme ainfi
en Angleterre , ce qu’on entend ailleurs par le mot
de quintal. L hundred eft de 112 liv. d’avoir du
poids , qui eft la livre la plus forte des deux dont les
Anglois fe fervent. Cette livre eft de feize onces ,
qui ne rendent à Paris que quatorze onces cinq huit,
eniorte que le quintal de Paris qui eft de cent livres*
faifant à Londres cent neuf livres ; le quintal anglois
eft d’environ deux livres 8c demi , ou trois
lPivOrIeDsS .p lus fort que celui de Paris. Voyt{ Livre Diction, de Commerce. Hundred , (Géog.) terme qui ne s’emploie que
flans la chorographie d’Angleterre ; le royaume eft
divifé en shires ou comtés , les shires en hundreds
ou centaines , les hundreds en tiihings ou dixaines ,
& les tithings en parishes ou paroiffes. Ce mot hundred
eft traduit en latin par centuria, c’eft-à-dire un
diftriû de pays , où cent hommes, cent chefs de famille
étoient autrefois obligés d’être caution les uns
pour les autres en juftice, tant au criminel , qu’au
civil., (2?. / .) ^
HUNDSFELD , (Géog.) c’eft-à-dire la campagne
du chien , petite ville d’Allemagne dans la Siléfie *
dans la province d’Oels, fur la "Weide , à 3 lieues
de Breflaw. Long. 3 4. 5o. lat. 5t. 8. {D . J.)
HUNDS-RUCK , Hunnorum traclus * ( Géog. J
petit pays d’Allemagne entre le Rhin, la Mofelle 8c
le Nab au bas.Palatinat. Il appartient à différens
fouverains. (D . J.)
HUNDWYL, (Géog.) petite ville de la Suifle,'
au canton d’Appenzell, fur.la riviere de Sintra.
HUNE , f. f. (Marine.) c’eft une efpece de plate
forme ronde , pofée en faillie autour du mât, dans
le ton , foûteniie par des barrots , mais de façon
qu’elle ne preffe pas le mât ; ii faut même qu’il y
ait entre la hune 6c le mât l’ouverture néceffaire
pour faire pafler ou baiffer les mâts de hune ou les
perroquets, en cas de befôin. Voyc{ Planche V I .
figure jg. le plan de la grande hune.
Il y a une hune à chaque mât, qui porte le nom
du mât où elle eft pofée , voye[ Planche I. Marine
n° • la grande hune, 94. hune de mifene, 16.hune
de beaupré, 41. hune d’artimon.
C ’eft aux hunes que font amarés les étais 8c les
haubans ; elles fervent à la manoeuvre, 8c les matelots
y montent pour cet effet. On met lin matelot
en vedette dans la hune du grand mât pour faire fen-
tinelle, fur-tout dans les tems de brume 8t dans les
parages, où l’on craint des brifans ou des corfaircs*
Y y