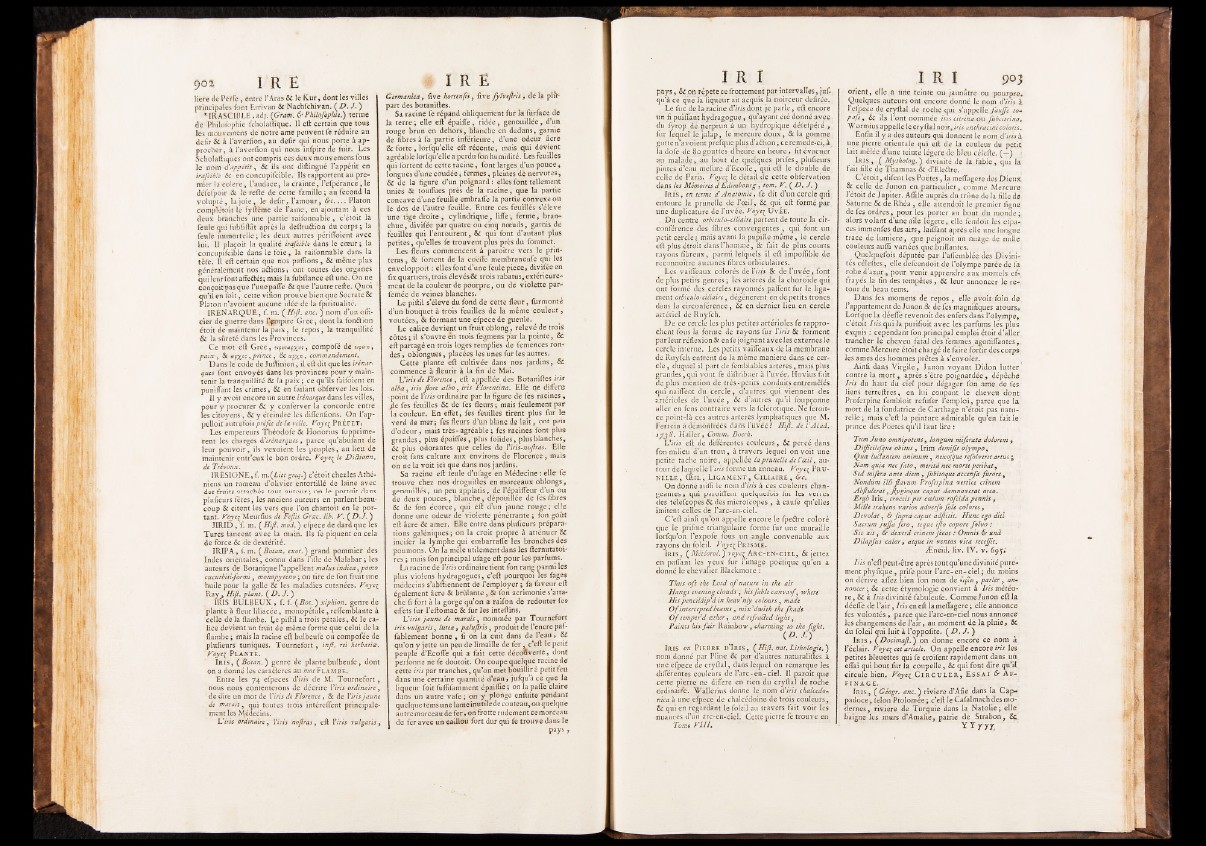
liefe de P erfe, entre l’Aras Sc le K u f , dont les villes
principales font Errivan & Nachfchivan. (D . /. )
* IRASCIBLE, adj. {Gram. & Philojophie.) terme
de Philofophie fcholaftique. Il eft certain que tous
les mouvemens de notre ame peuvent fe réduire au
defir Sc à l’averfion, au defir qui nous porte à approcher
, à l’averfion qui nous infpire de fuir. Les
Scholaftiques ont compris ces deux mouvemens fous
le nom d'appétit, & ils ont diftingué l’appétit en
irafciblé Sc en concupifcible. Ils rapportent au premier
la èolere, l’audace, la crainte, l’efpérance, le
défefpoir & le refte de cette famille ; au fécond la
volupté, la joie, le defir, l’amour, & c .. . . Platon
complétoit le fyftème de l’ame, en ajoutant à ces
deux branches une partie raifonnable , c ’étoit la
feule qui fubfiftât après la deftruâion du corps ; la
feule immortelle ; les deux autres périffoient avec
lui. Il plaçoit la qualité irajcible dans le coeur ; la
concupifcible dans le foie, la raifonnable dans la
têfe. Il eft certain que nos pallions, Sc même plus
généralement nos aérions* ont toutes des organes
qui leur font afFeâés; mais la fubftance eft une. On ne
conçoit pas que l’une paffe & qu e l’autre refte. Quoi 3
qu’il en l'oit, cette vifion prouve bien que Socrate &
Platon n’a voient aucune idée de la fpiritualitc.
IRÉNÀRQUE, f. m. ( Hiß. anc. ) nom d’un officier
de guerre dans Upmpire Grec, dont la fonérion
étoit de maintenir la paix, le repos, la tranquillité
& la sûreté dans les Provinces.
Ce mot eft G re c, , compofé de tipevn,
paix f & «p%oç, prince , Sc up%>i, commandement.
Dans le code de Juftinien, il eft dit que les irènar- 1
ques font envoyés dans les provinces pour y maintenir
la tranquillité & la paix ; ce qu’ils faifoient en
puniffant les crimes, Sc en faifant obferver les lois.
Il y avoir encore un autre irénarque dans les villes,
pour y procurer Sc y1 conferver la concorde entre
les citoyens, & y éteindre les diffenfions. On l’ap-
pelloit autrefois préfet de la ville. Voyeç PRE FE T .
Les empereurs Théodofe & Honorais fupprime-
rent les charges d’irenarqu.es, parce qu’abulant de
leur pouvoir, ils vexoient les peuples, au lieu de
maintenir entr’eux le bon ordre. Voye^ le Diclionn.
de Trévoux.
IRÉSIONE, f. m .{Litt greq.) c’étoit chez les Athéniens
un rameau d’olivier entortillé de laine avec
des fruits attachés tout autour ; on le portoit dans
plufieurs fêtes ; les anciens auteurs en parlent beaucoup
& citent les vers que l’on chantoit en le portant.
yoyt^ Meurfius de Feßis Grccc. lib. V. {D .J . )
JIRID, f. m. ( Hiß. mod. ) efpece de dard que les
Turcs lancent avec la main. Ils fe piquent en cela
de force Sc de dextérité.
IRIPA, fi m. {Botan. exot.) grand pommier des
Indes orientales, connu dans l’ifle de Malabar ; les
auteurs de Botanique l’appellent malus indica, porno
cucurbiti-formi, monopyreno ; on tire de fon fruit une
huile pour la galle Sc les maladies cutanées. Voye[
Ray^ Hiß. plant. { D . J. )
IRIS BULBEUX, f. f. {Bot.') xiphion. genre de
plante à fleur liliacée, monopétale, reffemblante à
celle de la flambe. Le piftü a trois pétales, Sc le calice
devient un fruit de même forme que celui de la
flambe ; mais la racine eft bulbeufe ou compofée de
plufieurs tuniques. Tournefort , inß. rei herbarioe.
yoyc{ Plan t e .
Iris , ( Botan. ) genre de plante bulbeufe, dont
on a donné les caraâeres au mot Flambe.
Entre les 74 efpeces d’riri de M. Tournefort,
nous nous contenterons de décrire l'iris ordinaire,
de dire un mot de Y iris de Florence, & de l’iris jaune
de marais , qui toutes trois intéreffent principalement
les Médecins.
L’iris ordinaire , l'iris noßras, eft l’iris vulgaris,
Germanicd, Eve hortenfîs, five Jylvefiris, dé la plupart
des botàniftes.
Sa racine fe répand obliquement fur là furface dé
la terre ; elle eft épaiffe, ridée, genouillée , d’uri
rouge brun en dehors, blanche en dedans, garnie
de fibres à fa partie inférieure, d’une odeur âcre
& forte , lorfqu’elle éft récente, mais qui devient
agréable lorfqü’elle a perdu fon humidité. Les feuilles
qui fortent de cette racine, font larges d’un pouce $
longues d’urte coudée * fermes, pleines dè nervures-, Sc de la figure d’un poignard ; elles font tellement
unies & touffues près de la racine, que la partie
concave d’une feuille embraffe la partie convexe oü
le dos de l’autre feuille. Entre ces feuillés s’élève
une tige droite , cylindrique, liffe ', ferhié, bran*
chue, divifée par quatre ou cinq noeuds, garnis dé
feuilles qui l’entourent, Sc qui font d’autant plus
petites, qu’elles fe trouvent plus près du fdmmet.
Les fleurs commencent à paroître vers le pfiri^
teins, & fortent de lâ coëffe membraneufe qui les
enveloppoit : elles font d’une feule pieee, divifée en
fix quartiers,trois élevés& trois rabatus,extérieure-*
ment de la couleur de pourpre, ou de violette par*
femée de veines blanches.
Le piftil s’élève du fond de cette fleur, furmonté
' d’un bouquet à trois feuilles de la même couleur,
voûtées, & formant une efpece de gueule*
Le calice devient un fruit oblong, relevé de trois
côtes ; il s’ouvre en trois fegmens par la pointe, Sc
eft partagé en trois loges remplies de femences ron--
des, oblongues, placées les unes fur les autres.
Cette plante eft cultivée dans nos jardins, Si
commence à fleurir à la fin de Mai.
L’irri de Florence , eft appellée des Botàniftes iris
alba t iris flore albo, iris Florentina. Elle qe différé
point de l’irri ordinaire par la figure de fes racines ,
jle fes feuilles Sc de fes fleurs ; mais feulement par
la couleur. En effet, fes feuilles tirent plus fur le
verd de mer ; fes fleurs d’un blanc de lait, ont peu
d’odeur, mais très - agréable ; fes racines font plus
grandes, plus épaiffes, plus folides, plus blanches,
Sc plus odorantes que celles de Ÿiris-nojirds. Elle
croît fans culture aux environs de Florence, mais
on ne la voit ici que dans nos jardins*
Sa racine eft ièule d’ulage en Médecine : elle' fe
trouve chez nos droguiftes en morceaux oblongs,
genouillés, un peu applatis, de l’épaiffeur d’un ou
de deux pouces, blanche, dépouillée de fes fibres
& de fon écorce, qui eft d’un jaune rouge; elle'
donne une odeur de violette pénétrante ; fon goût
eft âcre Sc amer. Elle entre dans plufieurs préparations
galéniques ; on la croit propre à atténuer Si
incifer la lymphe qui embarraffe les bronches des
poumons. On la mêle utilement dans les fternutatoi-
res ; mais fon principal ufage eft pour les parfums.
La racine de Y iris ordinaire tient fon rang parmi les
plus violens hydragogues, c’eft pourquoi les fages
médecins s’abftiennent de l’employer ; fa faveur eft
également âcre & brûlante, & fon acrimonie s’attache
fi fort à la gorge qu’on a raifon de redouter fe9
effets fur l’eftomac & fur les inteftins.
L'iris jaune de marais y nommée par Tournefort
iris vulgaris, lutea, palujlris, produit de l’encre paf-
fablement bonne , fi on la cuit dans de l’eau, Si
qu’on y jette un peu de limaille de fer, c’eft le peut'
peuple d’Ecoffe qui a fait cette découverte, dont
perfonne ne fe doutoit. On coupe quelque racine de
cette iris par tranches, qu’on met bouillir à petit feu
dans une certaine quantité d’eau, jufqu’à ce que la
liqueur foit fuffifamment épaiffie ; on la paffe claire
dans un autre vafe ; on y plonge enfuite pendant
quelque tems une lame inutile de couteau, ou quelque
autre morceau de fer, on frotte rudement cemordeau
de fer avec un caillou fort dur qui fe trouve dans le
p a y s ,
pa ys, & on répété ce frottement par intervalles, juf-,
qu’à ce que la liqueur ait acquis la noirceur defirée.
Le fuc de la.racine d’iris dont je parle, eft encore
un fi puiffant Hydragogue, qu’ayant été donné avec
du fyrop de nerprun à un hydropique délèfpére ,
fur lequel le jalap, le mercure doux, & la gomme
gutte n’a voient prefque plus a’aûipn ; ce remede-ci, à
la dofe de 80 gouttes d'heure en heure, fit évacuer
au malade, au bout dq, quelques prifes, plufieurs
pintes d’eau,mefure d’Ecoffe, qui eft le double de
celle de Paris. Hoye^ le détail de cette obfervation
dans les Mémoires d'Edimbourg, tom. y . {D . J.')
Ir is , en terme d! Anatomie, le dit d’un cercle qui
entoure la prunelle de l’oeil, Sç qui eft formé par
une duplicature de l’uvée.Hoye^ UvÉE.
Du centre orbiculo-ciliaîre paftent de touteJa circonférence
des fibres convergentes , qui, font un
petit cercle ; mais avant la pupille même, le cercle
eft plus étroit dans l’homme, & fait de plus courts
rayons fibreux, parmi lefquels il eft impoffible de
reconnoître aucunes fibres oxbicülaires.
Les vaiffeaux colorés de l’riri & de l’uvée, font
de plus petits genres ; les artères de la choroïde qui
ont formé des. cercles rayonnés’paffent fur le ligament
orbiculo-ciliaire, dégénèrent, en de petits troncs -
dans la circonférence, Sc en dernier lieu en cercle
artériel de Ruyfch.
D e ce cercle les plus petites artérioles fe rapprochent
fous la forme de rayons fur l’irri & forment
parleur réflexion & en fe joignant avec les externes le
cercle interne. Les petits vaiffeaux de la membrane
cîe Ruyfch entrent de la même maniéré dans ce cercle
, duquel il part de femblables artères, mais plus
grandes, qui vont fe diftribuer à l’uvée. Hovius fait
déplus mention de très-petits conduits entremêlés
qui naiffent du Cercle, d’autres' qiii viennent des
artérioles de l’u vé e , Sc d’autres qu’il foupçorine
aller en fens contraire vers la felérotique. Ne feroit-,
ce point-là ces autres arteres lymphatiques que M.
Ëerrein a démontrées dans l’uvée? Hiß. de T Acad.
lygS. Haller, Comm. Boerh.
L'iris eft de différentes couleurs, Si percé dans
fon milieu d’un trou, à travers lequel on voit une
petite tache noire, appellée la prunelle de Coeil, autour
de laquelle l’riri forme un anneau. Hoye^ Prun
e l l e , OEi l , Lig am e n t , C il ia ir e , &c.
On donne auffi le nom d’riri à ces couleurs changeantes,
qui paroiffent quelquefois fur les verres
des télefeopes Sc des microfcopes , à caufe qu’elles
imitent celles de l’arc-en-ciel.
C ’eft ainfi qu’on appelle encore le fpeftre coloré
que le prifme triangulaire forme fur une muraille
lorfqu’on l’expofe fous un angle convenable aux
rayons du foleil. Voye{ Prisme.
Ir is , ( Météorol.) voÿe^ Ar c -en- c ie l , & jettez
en paffant les yeux fur l’image poétique ,qu’en a
donné le chevalier Blackmore :
Thus oft the Lord o f nature in the air
Hangs evening elouds , his fable canvasf, where
Hispencildip'd in heav'nly colours, made
O f interceptedbeams , mix'dwith the fhade
O f temper'd (Ether , and refracled light,
Points his fair Rainbow, charming to the fight,
{ D . J . )
Iris ou Pierre d’ Ir i s , {Hiß. nat. Lithologie.')
nom donné par Pline Sc par d’autres naturaliftes à
Une efpece de cryftal, dans leqiièl on remarque les
différentes couleurs de l’arc-en-ciel. Il paroit que
cette pierre ne différé en rien dû cryftal de roche
Ordinaire. "Wallerius donne le nom d’riri chalcedo-
nica à une efpece de chalcédoine de trois couleurs,.
& qui en regardant le foleil au travers fait voir lès
nuances d’un arc-en-ciel. Cette pierre fe trouve en
Tome y i l l .
orient, elle,a tirie teinte ou jaunâtre ;du pourpre*
Quelques auteurs ont encore donné le nom d’riri à
de cryftal de roche qui s’appelle fauffe to-
paje, Sc ils l’ont nommée iris citrina ou fubeurina,
Wormius appelle lé cryftal noir, iris anthracini coloris.
Enfin il y a des auteurs qui donnent le nom d’riri à
une pierre orientale qui eft de la couleur du petit
lait mêlée d’une teinte légère de bleu célefte. (—) f
Ir i$ >. { Mytholog. ) divinité de la fable, qui la
fait fille de Thamnas Sc d’Eleâre.
C ’étoit y difent les Poètes, la meffagete des Dieux
& celle de Junon en particulier, comme Mercure
l’étoit de Jupiter. Aflife auprès du trône de la fille de
Saturne Sc de Rhéa , elle attendoit le premier ligne
de fes ordres , pour les porter au bout du monde ;
alors volant d’une aile legere, elle fendoit les efpa-!
ces imnienfes des airs, Iailfant après elle une longue
trace de lumière, que peignoit un nuage de mille
couleurs auffi variées que brillantes.
Quelquefois députée par l’affemblée des Divinités
céleftes, elle defeendoit de l’olympe parée de fa
robe d’azur, pour venir apprendre aux mortels effrayés
la fin des tempêtes , Sc leur annoncer le re*
tour du beau tems.
Dans fes momeiis de repos , elle pvoit foin de
l’appartement de Junon & de fes magnifiques atours*
Lorlque la déeffè revenoit des enfers dans l’olympe,
c’étoit Iris qui la purifioit avec les parfums les plus
exquis r cependant fon principal emploi étoit d’aller
trancher le cheveu fatal des femmes .agoniffantes ,
comme Mercure étoit chargé de faire fortir des corp9
les âmes des hommes prêtes à s’envoler.
Ainfi dans Virgile, Junon voyant Didon lutter
contre la mort, après s’être poignardée , dépêche
Iris du haut du ciel pour dégager fon ame de fes
liens terreftres, en lui coupant le cheveu dont
Proferpine femblpit refufer l’emploi, parce que la
mort de la fondatrice de Carthage n’étoit pas naturelle
; mais c’eft la peinture admirable qu’en fait le
prince des Poètes qu’il faut lire :
Tum Juno omriipotens, tonguni rriiferata dotorem ,
Difjîcilefquc obitus , Irim demijît olympo,
Qucb luclantem animum , nexofque refolveret artus ;
Nam quia nec fato, mérita nec morte peribat y
Sed mifera ante diem, fubitoque accehfa furort,
Nondiim- illi jlavum Proferpind vertice crinem
Abflulerat y fiygioque taput damnaverat orco,
Ergb Iris, croceis per ccelum rofeida pennis ,
Mille trahéns varios adverfo foie colores,
Devolat, & fuprd cap ut adjlitit. Hune ego dut
Sacrum juffa fero, teque ijlo copore folvo .*
Sic ait y & dextrâ crinem J'ecat i Omnis ,& unà
Dilapfus calor> atque in ventos vita recefjit.
Æneïd. liv. IV. v . 695*'
Iris n’eft peut-être après tout qu’une divinité pure*
mentphyfique, prifepour l’arc -en-ciel; du moins
on dérive affez bien fon nom de ùpuv, parler y annoncer
; Sc cette étymologie convient à Iris météore,
& à Iris divinité fabuleufe. Comme Junon eft la
déeffe de l’air , Iris en eft la meffagere ; elle annonce
fes volontés, parce que l’arc-en-ciel nous annonce
les changemens de l’air, au moment de la pluie, Sc
du foleil qui luit à l’oppofite. ( D . J. )
Ir i s , (Docimafl.') on donne encore ce nom à
l’éclair. Voye^ cet article. On appelle encore iris les
petites bleuettes qui fe croifent rapidement dans un
effai qui bout fur la coupelle, Sc qui font dire qu’il
circule bien. Hoyei C i r c u l e r , E s s a i & A ff
in a g e .
Ir is , ( Géogr. anc.') riviere d’Afie dans la Cap-
padoce, lèlon Ptolomée ; c’eft le Cafalmachdes modernes,
riviere de Turquie dans la Natolie; elle
baigne les murs d’Amafie, patrie de Strabon, Sc.
Y T y y y / '