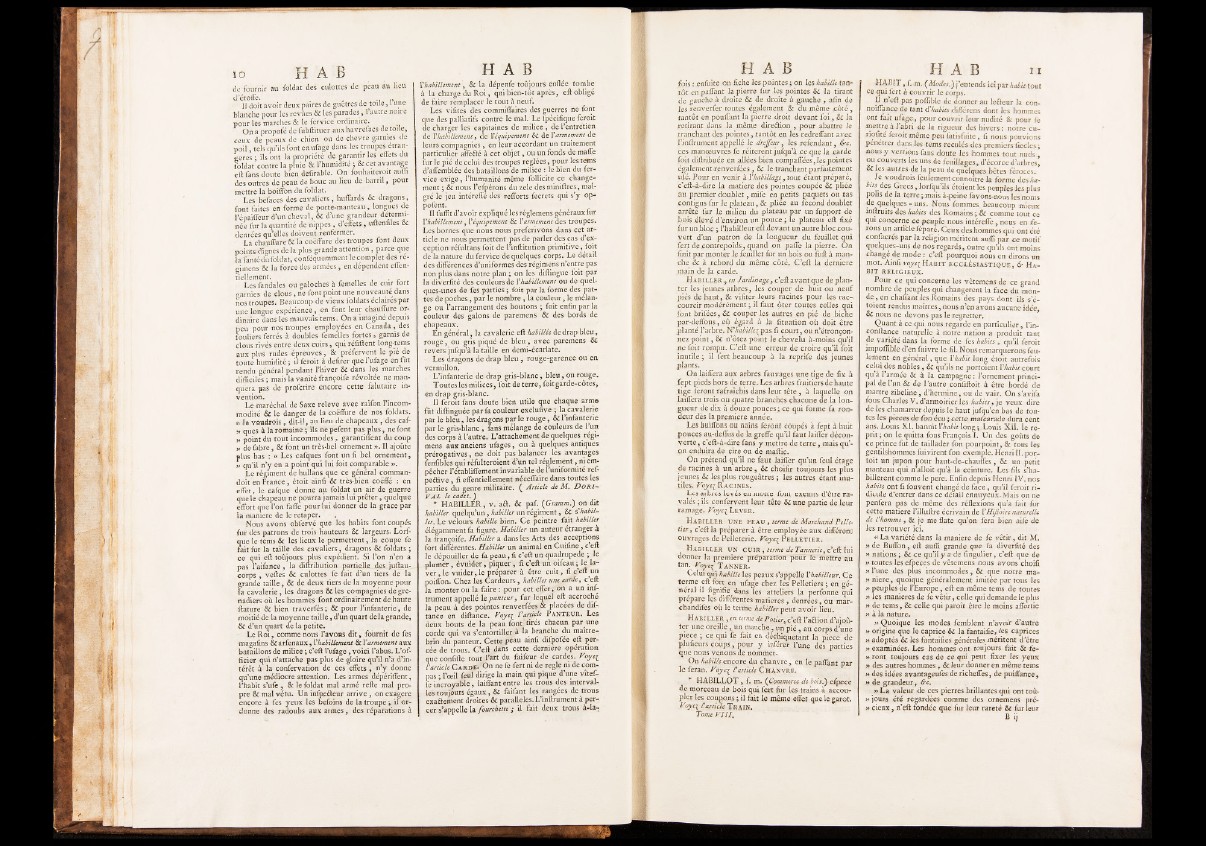
de fournir au foldat des culottes de peau au lieii
d ’étoffe. t a i -i i»
Il doit avoir deux paires de giietres de toile, 1 une
blanche pour les revues & les parades, l’autre noire
pour les marches & le fervice ordinaire.
On a propofé de fubftituer aux havrefacs de toile,
ceux de peaux de chien ou de chevre garnies de
p o il, tels qu’ils font enufage dans les troupes étrangères
; ils ont la propriété de garantir les effets du
foldat contre la pluie & l’humidite ; & cet avantage
eft fans doute bien défirable. On fouhaiteroit auili
des outres de peau de bouc au lieu de barril, pour
mettre la boiffon du foldat.
Les befaces des cavaliers, huffards oc dragons,
font faites en forme de porte-manteau, longues de
l ’épaiffeur d’un cheval, & d’une grandeur déterminée
fur la quantité de nippes , d’effets, uftenfiles oc
denrées qu’elles doivent renfermer.
La chauffure ôc la coëffure des troupes font deux
points dignes de la plus grande attention, parce que
la fanté du foldat, conféquemment le complet des re-
gimens & la force des armées, en dépendent effen-
tiellement. .
Les fandales ou galoches à femelles de cuir tort
garnies de clous, ne font point une nouveauté dans
nos troupes. Beaucoup de vieux foldats éclairés par
une longue expérience, en font leur chauffure ordinaire
dans les mauvais tems. On a imaginé depuis
peu pour nos troupes employées en Canada , des
fouliers ferrés à doubles femelles fortes, garnis de
clous rivés entre deux cuirs, qui réfiftent long-tems
aux plus rudes épreuves , & préfervent le pié de
toute humidité ; il feroit à defirer que l’ufage en fût
rendu général pendant l’hiver & dans les marches
difficiles ; mais la vanité françoife révoltée ne manquera
pas de profcrire encore cette falutaire invention.
Le maréchal de Saxe releve avec raifon l’incommodité
& le danger de la coëffure de nos foldats.
« Je voudrois, dit-il, au lieu de chapeaux , des caf-
» ques à la romaine ; ils ne pefent pas plus, ne font
» point du tout incommodes, garantirent du coup
» de fabre, & font un très-bel ornement ». Il ajoûte
plus bas : « Les cafques font un fi bel ornement,
» qu’il n’y en a point qui lui foit comparable ».
Le régiment de hullans que ce général comman-
doït en France, étoit ainfi & très-bien coëffé : en
effet, le cafque donne au foldat un air de guerre
que le chapeau ne pourra jamais lui prêter, quelque
effort que l’on faffe pour lui donner de la grâce par
la maniéré de le retaper.
Nous avons obfervé que les habits font coupés
fur des patrons de trois hauteurs &c largeurs. Lorf-
que le tems & les lieux le permettent, la coupe fe
fait fur la taille des cavaliers, dragons & foldats ;
ce qui eft toujours plus expédient. Si l’on n’en a
pas l’aifance, la diftribution partielle des juftau-
eorps , veftes & culottes fe fait d’un tiers de la
grande taille, & de deux tiers de la moyenne pour
la cavalerie, les dragons & les compagnies de grenadiers
oh les hommes font ordinairement de haute
ftature & bien traverfés ; & pour l’infanterie, de
moitié de la moyenne taille, d’im quart delà grande,
&c d’un quart de la petite.
Le R o i, comme nous l’avons dit, fournit de fes
magafins &arfenaux, l'habillement & Y armement aux
bataillons de milice ; c’eft l’ufage, voici l’abus. L’officier
qui n’attache pas plus de gloire qu’il n’a d’intérêt
à la confervation de ces effets , n’y donne
qu’une médiocre attention. Les armes dépériffent,
l’habit s’ufe , & le foldat mai armé refte mal propre
& mal vêtu. Un infpe&eur arrive, on exagere
encore à fes yeux les befoins de la troupe il ordonne
des radoubs aux armes, des réparations à
l’habillement, & la dépenfe toujours enflée tombe
à la charge du R o i, qui bien-tôt après, eft obligé
de faire remplacer le tout à neuf.
Les vifites des commiffaires des guerres ne font
que des palliatifs contre le mal. Le fpécifique feroit
de charger les capitaines de milice, de l’entretien
de Y habillement, de Y équipement & de Y armement de
leurs compagnies, en leur accordant un traitement
particulier affe&é à cet objet, ou un fonds de maffe
furie pié de celui des troupes réglées, pour les tems
d’affemblée des bataillons de milice : le bien du fer-
vice exige, l’humanité même follicite ce changement
; & nous l’efpérons du zele des miniftres, malgré
le jeu intéreffé des refforts fecrets qui s’y op-
pofent.
Il fuffit d’avoir expliqué lesréglemens générauxfur
Y habillement, Y équipement & Y armement des troupes.
Les bornes que nous nous prefcrivons dans cet article
ne nous permettent pas de parler des cas d’exception
réfultans foit de l’inftitution primitive, foit
de la nature du fervice de quelques corps. Le détail
des différences d’uniformes des régimens n’entre pas
non plus dans notre plan ; on les diftingue foit par
la diverfité des couleurs de Y habillement ou de quelques
unes de fes parties ; foit par la forme des pattes
de poches, par le nombre, la couleur, le mélange
ou l’arrangement des boutons ; foit enfin par la
couleur des galons de paremens & des bords de
chapeaux.
En général, la cavalerie eft habillée de drap bleu,
rouge, ou gris piqué de bleu, avec paremens ôc
revers jufqu’à la taille en demi-écarlate.
Les dragons de drap b leu , rouge-garence ou en
! vermillon.
. L’infanterie de drap gris-blanc, bleu, ou rouge.
Toutes les milices, foit de terre, foit garde-côtes,
en drap gris-blanc.
Il feroit fans doute bien utile que chaque arme
fût diftinguée par fa couleur exclufive ; la cavalerie
par le b leu, les dragons par le rouge, & l’infanterie
par le gris-blanc, fans mélange de couleurs de l’un
des corps à l’autre. L’attachement de quelques régimens
aux anciens ufages, ou à quelques antiques
prérogatives, ne doit pas balancer les avantages
fenfibles qui réfulteroient d’un tel réglement, ni empêcher
l’etabliffement invariable de l’uniformité ref-
peftive, fi eflentiellement neceffaire dans toutes les
parties du genre militaire. ( Article de M. D o r i- VAL le cadet. )
* HABILLER, v . a St. & paf. (Gramm.) on dit
habiller quelqu’un, habiller un régiment, & Rhabiller.
Le velours habille bien. Ce peintre fait habiller
élégamment fa figure. Habiller un auteur étranger a
la françoife. Habiller a dans les Arts des acceptions
fort différentes. Habiller un animal en Cuifine, c’eft
le dépouiller de fa peau, fi c’eft un quadrupède ; le
plumër, évuider, piquer , fi c’eft un oifeau ; le lav
e r , le vuider,le préparer à être cuit , fi c’eft un
poiffon. Chez les Cardeurs, habiller une carde, c’eft
la monter ou la faire : pour cet effet , on a un inf-
trument appellé le panteur, fur lequel eft accroché
la peau à des pointes renverfées & placées de dif-
tance en diftance. Voye^ l'article Panteur. Les
deux bouts de la peau font'tirés chacun par une
corde qui va s’entortiller à la branche du maitre-
brin du panteur. Cette peau ainfi difpofee eft per-
app pi g tron« C’eft dans cette dermere operation
queconfifte tout l'art du faifeur de cardes. Voyc^
l'article Carde. On ne fe fert ni de réglé ni de compas
; l’oeil feul dirige la main qui pique d’une vîtef-
fe incroyable, laiffant entre les trous des intervalles
toujours égaux, & faifant les rangées de trous
exaftefaient droites & parallèles. L’inftrument à percer
s’appelle la fourchette ; il fait deux trous à-la-
?oew
fois : enfuite on fiche les pointes ; on les habille tantôt
en paffant la pierre fur les pointes & la tirant
de gauche à droite & de droite à gauche , afin de
les renverfer toutes également & du même .côté ,
tantôt en pouffant la pierre .droit devant fo i , &c la
retirant dans la même dire&ion , pour .abattre le
.tranchant des pointes., tantôt .en les redreflant avec
l’inftrument appelle le drejfeur, les refendant, &c.
c.es manoeuvres fe réitèrent jufqu’à ce que la .carde
foit diftribuée -en .ailées bien compaffées, les pointes
également-r,enyerfe.es, & le tranchant parfaitement
ufé. Poyr en venir à Y habillage, tout étant préparé,
c’eft-à-dire !,a matière des pointes coupée & pliée
au premier doublet, mife en petits paquets ou tas
contigus fur le plateau, & pliée au fécond doublet
arrêté fur Je milieu du plateau par un fupport de
bois élevé ,d’enyiron un pouce ; le plateau eft fixé
fur un bloc ; l’habilleur eft devant un autre bloc couvert
d’un patron .de la longueur du feuillet qui
fert de contrepoids, quand .on paffe la pierre. On
finit par monter le feuillet fur un bois ou fuû à manche
&c à rebord du même côté. C ’eft la derniere
m.aiu de la carde. Habiller , en Jardinage, c’eft avant que de planter
les jeunes arbres, les couper de huit ou neuf
pies de haut, & vifiter leurs racines pour les raccourcir
modérément ; il faut ôter toutes celles qui
font brifées, & couper les autres en pié de biche
par-deffous, eu égard à la fituation où doit être
planté l’arbre. YYhabille^pas fi court, ou n’étronçon-
nez point, & n’ôtez point le chevelu à-moins qu’il
ne foit rompu. .C’eft une erreur de croire qu’il foit
inutile ; il fert beaucoup à la reprife des jeunes
plants.
On laiffera aux arbres fauvages une tige de fix à
fept pieds hors de terre. Les arbres fruitiers de haute
tige feropt rafraîchis dans leur tê te , à laquelle on
laiffera trois ou quatre branches chacune de la longueur
de dix à douze pouces ; ce qui forme fa rondeur
dès la première année.
Les buiffons ou nains feront coupés à fept à huit
pouces au-deffus de la greffe qu’il faut laiffer découverte
, c’eft-à-rdire fans y mettre de terre, mais qu’on
enduira de cire ou de maftic.
On prétend qu’il ne faut laiffer qu’un feul étage
déracinés à un arbre, & choifir toujours les plus
jeunes &c les plus rougeâtres ; les autres étant inutiles.
Foyei Racines.
Les ambres levés valés ; ils confervenetn l meuort tteê tefo &nt uenxee mpatsrt ide’ êdtere l eruar
ramage. Voye^ Lever.
HABILLER UNE PEAU , terme de Marchand Pelletier
, c’eft la préparer à être employée aux différens
ouvrages de Pelleterie. Voye^ Pelletier.
donHnaebr illal perre muinèr ec puriérp a, rtaertmioen d ep oTiaïnf nleer ime, ect’terfet lauui tan. Voye^ T anner.
Celui qui habille les peaux s’appelle Yhabilleur. C e
terme eft fort en ufage chez les Pelletiers ; en general
il fignifie dans les atteliers la perfonne qui
préparé les différentes matières , denrees , ou marchandées
ou le terme habiller peut avoir lieu.
terH uanbe iolrleeirll e, ,e. nu nte rmmea ndce hPeo,t iue.rn^ pç’ieéf,t al’uaé clioornp sd d’a’juonue
ppliuecfiee u; rsc ec oquupi sf,e pfoauitr eyn diéncféhrieqru el’tuannet lad eps ièpcaer tidees que nous venons de nomme*.
le fOenra hna. bille encore du chanvre, en le paffant par Voye^ l'article Chanvre.
. * HABILLOT, f. m. (Cpipm&rct de boi»l)e(pece
de morceau de bois qui fert for les trains à aiceou-
pler les coupons ; il fait le même effet que le. garot.
JJgfP l'article Train.
Tome V i i i .
HA BIT, f. m. (Modes.) j’entends ici par habit tout
ce qui fert à couvrir le corps.
Il n eft pas poffible de donner au leéteur la con-
noiffance de tant d'habits différens dont les hommes
ont fait ufage , pour couvrir leur nudité & pour fe
mettre a 1 abri de la rigueur des hivers : notre cu-
rioftté feroit même peu fatisfiaite, fi nous pouvions
pénétrer dans les tems reculés des premiers fiecles ;
nous y verrions fans doute les hommes tout nuds ,
ou .couverts les uns de feuillages, d’écorce d’arbres,
- ” s autres-de la peau de quelques bêtes féroces.
Je voudrois feulement connoitre la forme des ha-
bus des Grecs, lorfqu’ils étoient les peuples les plus
polis de la terre; mais à-peine favons-nous les noms
de quelques - uns. Nous fournies beaucoup mieux
inftruits des habits des Romains ; & comme tout ce
qui concerne c e peuple nous intéreffe, nous en ferons
un article féparé. C eux des hommes qui ont été
confacrcs par la religion méritent auffi par ce motif
quelques-uns de nos regards, outre qu’ils ont moins
changé de mode : c’eft pourquoi nous en dirons un
mot. Ainfi voye^ Habit ecclesiastique, & Habit
RELIGIEUX.
Pour ce qui concerne les vêtemens de ce grand
nombre de peuples qui changèrent la face du mond
e , en chaffant les Romains des pays dont ils s'é-
toient rendus maîtres, nous n’en avons aucune idée,
& nous ne devons pas le regretter.
Quant à ce qui nous regarde en particulier, l’in-
c.onflance^ naturelle à notre nation a produit tant
de variété dans la forme de fes habits , qu’il feroit
impoffible d’en fuivre le fil. Nous remarquerons feulement
en général, que Y habit long étoit autrefois
celui des nobles, & qu’ils ne portoient l'habit court
qu’à l’armée & à la campagne : l’ornement principal
de l’un & de l ’autre confiftoit à être bordé de
martre zibeline, d’hermine, ou de vair. On s ’avifa
fous Charles V . d’armoirier les habits, je veux dire
de les chamarrer depuis le haut jufqu’en bas de toutes
les pièces de fon écu ; cette mafearade dura cent
ans. Louis XI. bannit Y habit long ; Louis XL1. le reprit;
on le quitta fous François I. Un des goûts de
ce prince fut de taillader fon pourpoint, & tous les
gentilshommes fuivirent fon exemple. Henri II. por-
toit un jupon pour haut-de-chauffes, & un petit
manteau qui n’alloit qu’à la ceinture. Les fils s’habillèrent
comme le pere. Enfin depuis Henri IV. nos
habits ont fi fouvent changé de face , qu’il feroit ridicule
d’entrer dans ce détail ennuyeux. Mais on ne
penfera pas de même des réflexions qu’a fait fur
cette matière l’illuftre écrivain de YHiJioire naturelle
de l'homme, & je me flate qu’on fera bien aife de
les retrouver ici.
« La variété dans la manière de fe vêtir, dit M.
» de Buffon, eft auffi grande que la diverfité des
» nations ; & ce qu’il y a de fingulier, c’eft que de
» toutes les éfpeces de vêtemens nous avons choifi
» l’une des plus incommodes, & que notre ma-
» niere, quoique généralement imitée par tous les
» peuples de l’Europe, eft en même tems de toutes
» les maniérés de fe vêtir, celle qui demande le plus
» de tems, & celle qui paroît être le moins affortie
» à la nature.
» Quoique les modes femblent n’a voir d’autre
» origine que le caprice & la fantaifie, les caprices
», adoptés & les fantaifies générales méritent d’être
» examinées. Les hommes ont toujours fait & fe-
» ront toujours cas de ce qui peut fixer les yeux
» des autres hommes , & leur donner en même tems
» des idées avantageufes de richeffes, de puiffance,
» de grandeur, ôc.
» La valeur de ces pierres brillantes qui ont toû-
» jours été regardées comme des ornemens pré-
» cieux, n’eft fondée que fur leur rareté & fur leur
B i j