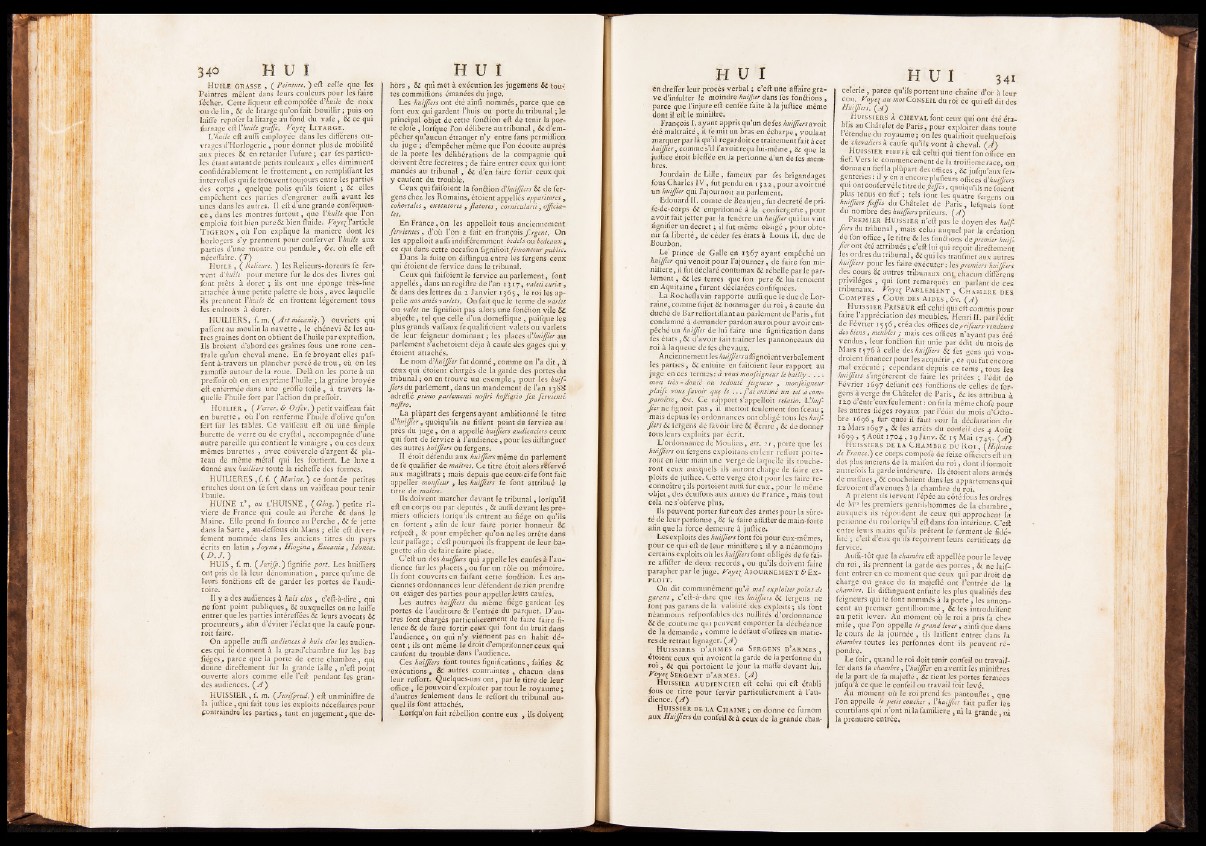
HurlE grasse , ( Peinture. ) eft celle que lés
Peintres mêlent dans leurs couleurs pour les faire
fécher. Cette liqueur eftcompofée A'huile de noix
ou de lin , & de litarge qu’on fait bouillir ; puis on
laifle repofer la litarge au fond du vafe , & ce qui
fumage eft Y huile graffe. Voye^ LlTARGE.
Uhuile eft auffi employée dans les différens ou-
vragesd’Horlogerie , pour donner plus de mobilité
aux pièces & en retarder l’ufu-re ; car fes particules
étant autant de petits rouleaux * elles diminuent
conlidérablement le frottement, en rempliffant les
intervalles qui fe trouvent toujours entre les parties
des corps , quelque polis qu’ils foient ; & elles
empêchent ces parties d’engrener auffi avant les
unes dans les autres. II eft d’une grande conféquen-
c e , dans les montres furtout, que Yhuile que l’on
emploie foit bien pure & bien fluide. Voye^ l’article
T ig e r o n , oit l’on explique la maniéré dont les
horlogers s’y prennent pour conferver Y huile aux
parties d’une montre ou pendule, &c. où elle eft
néceffaire. (T)
Hu il e , ( Relieurs. ) les Relieurs-doreurs fe fervent
d’huile pour mettre fur le dos des livres qui
font prêts à dorer ; ils ont une éponge très-fine
attachée à une petite palette de bois, avec laquelle
ils prennent Yhuile & en frottent légèrement tous
les endroits à dorer.
HUILIERS, f. m. ( Are mécahiq.') ouvriers qui
paffent au moulin la navette, le chénevi & les autres
graines dont on obtient de l’huile par expfeffion.
Ils broient d’abord ces graines fous une roue centrale
qu’un cheval mene. En fe broyant elles paffent
à-travers un plancher percé de troü, où On les
ramaflë autour de la roue. Delà on les porte à un
prefloiroù on en exprime l’huile ; la graine broyée
eft enfermée dans une grôffe toile , à travers laquelle
l’huile fort par l’aétion du prefloir.
H u il ie r , ( Verrer. & Orfev. ) petit vaifleau fait
en burette, où l’on renferme l’huile d’olive qu’on
fert fur les tables. Ce vaifleau eft ou une fimple
burette de verre ou de cryftal, accompagnée d’une
autre pareille qui contient le vinaigre , ou ces deux
mêmes burettes , avec couvercle d’argent & plateau
de même métal qui les foutient. Le luxe a
donné aux huilliers toute la richefle des formes.
HUILIERES , f. f. ( Marine. ) ce font de petites
cruches dont on fe fert dans un vaifleau pour tenir
l ’huile.
HUINE l% ou l’HUISNE, ( Géog. ) petite rivière
de France qui coule au Perche & dans le
Maine. Elle prend fa fource au Perche , & fe jette
dans la Sarte , au-deflous du Mans ; elle eft diver-
fement nommée dans les anciens titres du pays
écrits en latin , Joyna , Hiogina, Eucania. Idonca.
(£ > .ƒ .) .
HUIS, f. m. ( Jurifp.) fignifie port. Les huiffiers
ont pris de là leur dénomination , parce qu’une de
leurs fondions eft de garder les portes de l’auditoire.
Il y a des audiences à huis clos , e’eft-à-dire , qui
ne font point publiques, & auxquelles on ne laifle
entrer que les parties intéreffées & leurs avocats &
procureurs, afin d’éviter l’éclat que la caufe pour-
roit faire.
On appelle auffi audiences à huis clos les audiences
qui fe donnent à la grand’chambre fur les bas
fiéges, parce que la porte de cette chambre, qui
donne diredement fur la grande falle , n’eft point
ouverte alors comme elle l’eft pendant les grandes
audiences. ( A )
HUISSIER, f. m. ( Jurifprud. ) eft unminiftre de
la juftice , qui fait tous les exploits néceffaires pour
(Contraindre les parties, tant en jugement, que dehors
, & qui met à exécution les jugemens & tour
tes commiffions émanées du juge.
Les huiffiers ont été ainfi nommés, parce que ce
font eux qui gardent l’huis ou porte du tribunal ; le
principal objet de cette fondion eft de tenir la porte
c lo fe, lorfque l’on délibéré au tribunal, & d’empêcher
qu’aucun étranger n’y entre fans permiffion
du juge ; d’empêcher même que l’on écoute auprès
de la porte les délibérations de la compagnie qui
doivent être fecrettfes ; de faire entrer ceux qui font
mandés au tribunal , & d’en faire fortir ceux qui
y caufent du trouble^
Ceux qui faifoient la fondioh d"’huiffiers & de fer-
gens chez les Romains, étoient appellés apparitores 9
cohortales, executores , fiatores, corntcularii, officiales.
En France, on les appelloit tous anciennement
fervientes, d’où l’on a fait en françois frgent. On
les appelloit auffi indifféremment bedels ou bedeaux;
ce qui dans cette occafion fignifioit fémonceur publici
Dans la fuite on diftingua entre les fergens ceux
qui étoient de fervice dans le tribunal.
Ceux qui faifoient le fervice au parlement, font
appellés, dans un regiftre de l’an 13 17 , valeti curia ,
& dans des lettres du 2 Janvier 1365, le roi les appelle
nos amis varias. On fait que le terme de variée
ou valet ne fignifioit pas alors une fonéfion vile &
abjefte, tel que celle d’un domeftique, puifque les
plus grands vaffaux fe qualifioient valets ou varlets
de leur feigneur dominant ; les places d’huiffier au
parlement s’achetoient déjà à caufe des gages qui y
étoient attachés.
Le nom d’huiffier fut donné, comme on l’a d i t , à
ceux qui étoient chargés de la garde des portes du
tribunal ; on en trouve un exemple, pour les huif-
Jiers du parlement, dans un mandement de l’an 1388
adreffé primo parlementi nojlri hofiiqrio feu fervienti
nojlro.
La plûpart des fergens" ayant ambitionné le titre
d’kuiffier, quoiqu’ils ne fiffent point de fervice auprès
du juge, On a appellé huiffiers audienciers ceux
qui font de fervice à l’audience, pour les diftinguef
des autres huiffiers ou fergens.
Il étoit défendu aux huiffiers même du parlement
de fe qualifier de maîtres. Ce titre étoit alors r&fervé
aux magiftrats ; mais depuis que ceux-ci fe font fait
appeller monfieùr , les huiffiers fe font attribué le
titre de maître-,
Ils doivent marcher devant le tribunal, Iorfqu’il
eft en corps oii par députés , & auffi devant les pre*
miers officiers lorfqu’ils entrent au fiége oit qu’ils
en fortent , afin de leur faire porter honneur &
refpeft, & pour empêcher qu’on ne les arrête dans
leurpaffage ; c’eft pourquoi ils frappent de leur baguette
afin de faire faire place.
C ’eft un des huiffiers qui appelle les eaufes à l’audience
fur les placets, ou fur un rôle ou mémoire.
Ils font couverts en faifant cette fonâion. Les anciennes
ordonnances leur défendent de rien prendre
ou exiger des parties pour appeller leurs eaufes.
Les autres huiffiers du même fiége gardent les
portes de l’auditoire & l’entrée du parquet. D ’autres
font chargés particulièrement de faire faire fi-
lence & de faire fortir ceux qui font du bruit dans
l’audience j ou qui n’y viennent pas en habit décent
; ils ont même le droit d’emprifonner ceux qui
caufent du trouble dans l’audience.
Ces huiffiers font toutes fignifications, failles &
'exécutions 9 & autres contraintes , chacun dans
leur reffort. Quelques-uns ont, par le titre de leur
office , le pouvoir d’exploiter par tout le royaume;
d’autres feulement dans le reffort du tribunal auquel
ils font attachés.
Lorlqu’on fait rébellion contre eux , Us doivent
en drefler leur procès verbal ; c’eft une affaire grav
e d’infulter le mo'mdrekuiffier dans fes fondions,
parce que l’injure eft cenfée faite à la juftice même
dont il eft le miniftre.
François I. ayant appris qu’un de fes huiffiers avoit
été maltraité, il fe mit un bras en écharpe, voulant
marquer par là qu’il regardoit ce traitement fait à cet
huiffier, comme s’il l’avoitreçu lui-même, & que la
juftice étoit bleffée en la perlonne d’un de fes membres.
Jourdain de Lille , fameux par fes brigandages
fous Charles IV , fut pendu en 13 22, pour avoir tué
un huiffier qui l’ajournoir au parlement.
Edouard II. comte de Beaujeu, fut décrété de pri-
fe:de-corps & emprifonné à la confiergerie, pour
avoir fait jetter par la fenêtre un huiffier qui lui vint
lignifier un decret ; il fut même obligé , pour obtenir
fa liberté, dé céder fes états à Louis IL duc de
Bourbon.
Le prince de Galle en 1367 ayant empêché un
huiffier qui venoit pour l’ajourner, de faire fon mi-
niltere, il fut déclaré contumax & rébelle par le parlement
, & les terres que fon pere & lui tenoient
en Aquitaine, furent déclarées confifquées.
La Rocheflavin rapporte auffi que le duc de Lorraine,
comme fujet & hommager du ro i, àcaule du
, duché de Bar rellbrtiflant au parlement de Paris, fut
condamné à demander pardon au roi pour avoir empêché
un huiffier de lui faire une lignification dans
fes états ,& d’avoir fait traîner les pannonceaux du
roi à laqneue dé fes chevaux.
Anciennement les huiffiers affignoient verbalement
les parties, & enfuite en failoient leur rapport au
juge en ces termes : a vous monfeigneür le bailly. . . 1
mon très - douté ou redouté Jeigneur , monfeigneür
plaife vous f avoir que le ; . . fa i entimé un tel à comparaître
, &c. Ce rapport s’appelloit relatio. Vbuff
e t ne fignoit pas , il mettoit lèulement fon fceau ;
mais depuis les ordonnances ont obligé tous lès huif-
fe rs & lergens de favoir lire & Écrire, ôc de donner
tous leurs exploits par écrit.
L ’ordonnance de Moulins, art. 21 , porte bue le$
huiffiers ou fergens ëxploirans eh leur reflbrt porte-
ront'en lehr main une verge de laquelle ils toucheront
ceux auxquels ils auront chafge de faire exploits
de juftice. Cette verge étoit pour les faire re-
connoître ; ils portoient auffi fur eu x, pour le même
objet, des écuffons aux armes de France, mais tout
cela ne s’obfetve plus.
Ils peuvent porter fur euX des ârmes pour la sûreté
de leur perfonne, & fe faire affifter de main-forte
afin que la force demeure à juftice.
Les exploits des huiffiers font foi pour eux-mêmes,
pour ce qui eft de leur miniftere ; il y a néanmoins
certains exploits où les huiffiers font obligés de fe fai- j
re affifter de deux records , ou qu’ils doivent faire
parapher par le juge. Voye^ Ajo u r n em e n t & Ex p
l o it .
On dit communément qu’à mal exploiter point de
garant, c’eft-à-dire que les huiffiers & fergens ne
font pas garans de la validité des exploits ; ils font
néanmoins refponfables des nullités d ’ordonnance
& cle, coutume qui peuvent emporter la déchéance
de la demande , comme le défaut d’offres en matières
de retrait lignager. (A )
H u issie r s d’armes ou Sergens d’arme s ,
étoient ceux qui avoient la garde de la perfonne du
r o i, & qui portoient le jour la mafle devant lui.
Foyt^ Se r g e n t d’a rm e s. (A)
H uissier a u d ie n c ie r eft celui qui eft établi
fous ce titre pour fervir particulièrement à l’audience.
(A )
H u issie r d e la C h a în e ; on dcmne ce fnmom
flux HuiJJiirs&v confeil& à ceux de la grande chanceïerle,
pâtée qu’ils portent une chaîne d’or à leur
cou. Voyeiau mot C onseil du roi ce qui eft dit des
Huiffiers. (A )
H u issier s a c h ev a l font ceux qui ont été établis
au Châtelet de Paris, pour exploiter dans toute
l ’étendue du royaume ; on les qualifioit quelquefois
de chevaliers à caufe qu’ils vont à cheval. (A )
H u issier f ie f f é eft celui qui tient fon office en
fief. Vers le commencement de la troifiemerace, on
donna en fief la plûpart des offices , & jufqu’aux fer- '
gentenes : il y en a encore plufieurs offices d’huiffiers
qui ont confervéle titre de fieffés, quoiqu’ ils ne foient
plus tenus en fief ; tels font les quatre fergens ou
huiffiers fieffés du Châtelet de Paris , lefquels font
du nombre des huiffiers prifeurs^ (^ )
Pr em ie r Hu issie r n’eft pas le doyen des huiffiers
du tribuhal, mais celui auquel par la création
de fon office, le titre & les fondions de premier huifi
f i cr ont été attribués ; c’eft lui qui reçoit direâement
les ordres du tribunal, & qui les tranfmet aux autres
huiffiers pour les faire exécuter: les premiers huiffiers
des cours & autres tribunaux onç, chacun différens
privilèges , qui font remarqués en parlant de ces
tribunaux. Voye^ Pa r l em e n t , C h am b re des
C o m p t e s , C o u r des Aid es , &c. (/ƒ)
H u is s ie r Pr Iseü r eft celui qui eft commis pour
faire ^’appréciation des meubles. Henri II. par l’édit
de Février 1556, créa des offices deprifeurs-vendeurs
des biens t meubles ; mais ces offices n’ayant pas été
vendus, leurfonàion fut unie par édit du mois de
Mars 1576 à celle "des huiffiers & fes gens qui vou-
droient financer pour les acquérir , ce qui fut encore
mal exécuté ; cependant depuis ce tems , tous les
Huiffiers s’ingérèrent de faire les prilées ; l’édit de
Février 1697 defunit ces fondions de celles de fer*
gens a verge du Châtelet de Paris, & les attribua à
1 io d’entr eux feulement : on fit la même chofe pour
les autres fiéges royaux par l’édit du mois d’Ocfo-
bre 1696, fur quoi il faut voir la déclaration du
12 Mars 1697 , & les arrêts du confeil des 4 Août
1699 ; 5 Août 1 70 4 ,19 Janv. & 15 Mai 1745. (A }
Hu issier s de la C h am b r e du R o i , (.Hiftoirt
de France.) ce corps compofé de feize officiers eft uiï
des plus anciens de la maifori du roi > dont ilformoit
autrefois la garde intérieure. Ils étoient alors armés
de maffues, & couchoient dans les appartenons qui
fervoient d’avenues à la chambre du roik
A préfent ils fervent l’épée au côté fous les ordres
de Mrs les premiers gentilshommes de la chambre,
auxquels ils repondent de ceux qui approchent la
perlonne du roilorlqu’il eft dans fon intérieur. C ’eft
entre leurs mains qu’ils prêtent le ferment de fidélité
; c’eft d’eux qu’ils reçoivent leurs certificats de
fervice.
Auffi-tôt que la chambre eft appéllée pour le lever
du ro i, ils prennent la garde des portes, & ne laif»
feht entrer en ce moment que ceux qui par droit de
charge ou grâce de fa majefté ont l’entrée de la
chambre. Ils diftinguent enfuite les plus qualifiés des
feigneurs qui 1e font nommés à la porte, les annoncent
au premier gentilhomme , & les introduifenÊ
au petit lever. Au moment où le roi a pris fa che-
mife, que l’on appelle le grand lever , ainfi que dans
le cours de la journée , ils laiffent entrer dans la.
chambre toutes les perfonnes dont ils peuvent répondre.
Le foir, quand le roi doit tenir confeil ou travailler
dans fa chambre, Y huiffier en avertit les miniftres
de la part de fa majefté, & tient les portes fermées
jufqu’à ce que le confeil ou travail foit levé.
Au moment où le roi prend fes pantoufles , que
l’on appelle le petit coucher, Yhuiffier fait palier les
courtifans qui n’ont ni la familier© , ni la grande ift
la première entrée,