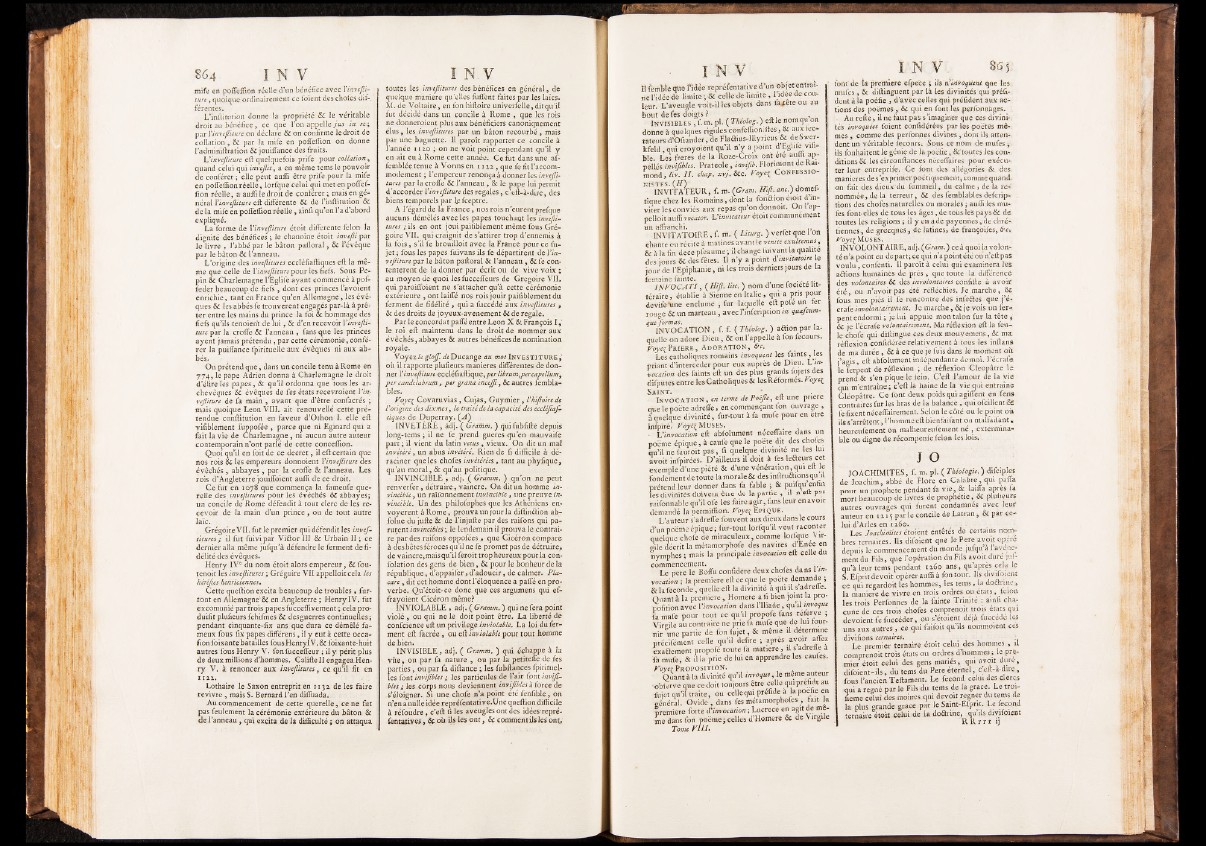
mife en poffefîion réelle d’un bénéfice avec 1 invefli-
turc, quoique ordinairement ce {oient des choies dif-,
férentes,
L’inftitution donne la propriété &c le véritable
droit au bénéfice, ce que l’on appelle ju s in re\
par Yinvefliture on déclare & on confirme le droit de
collation, & par la mife en poffeffion on donne
l’adminiftration & jouiffance des fruits.
L 'invejliture eft quelquefois prife pour collation,
quand celui qui invefit, a en même tems le pouvoir
de conférer ; elle peut aufli être prife pour la mife
en poffeffion réelle, lorfque celui qui met en poffef-
fion réelle, a aufli le droit de conférer ; mais en gér
néral Yinvejliture eft différente 6c de l’inftitution &c
de la mife en poffeflion réelle, ainfi qu’on l’a d’abord
expliqué.
La forme de Yinvejiiturc étoit differente félon la
dignité des bénéfices ; le chanoine étoit invejli par
le livre , l’abbé par le bâton paftoral, & l’évêque
par le bâton &c l ’anneau.
L ’origine des inveflitutes eccléfiaftiques eft la même
que celle de Yinvejliture pour les fiefs. Sous Pépin
& Charlemagne l’Eglife ayant commencé à pof-
l'eder beaucoup de fiefs , dont ces princes l’avoient
enrichie, tant en France qu’en Allemagne, les évêques
& les abbés fe trouvèrent engagés par-là à prêter
entre les mains du prince la foi & hommage des
fiefs qu’ils tenoieht de lu i , & d’en recevoir Yinvejliture
par la croffe & l’anneau , fans que les princes
ayent jamais prétendu, par cette cérémonie, conférer
la puiffance fpirituelle aux évêques ni aux abbés,
.O
n prétend que, dans un concile tenu à Rome en
7 74 , le pape Adrien donna à Charlemagne le droit
d’élire les papes, & qu’il ordonna que tous les archevêques
& évêques de fes états recevroient Yinvejliture
de fa main , avant que d’être confacrés ;
mais quoique Leon VIII. ait renouvellé cette prétendue
conftitution en faveur d’Othon I. elle eft
vifiblement fuppofée , parce que ni Eginard qui a
fait la vie de Charlemagne, ni aucun autre auteur
contemporain n’ont parlé de cette conceflion.
Quoi qu’il en foit de ce decret, il eft certain que
nos rois & les empereurs donnoient Yinvejliture des
évêchés , abbayes , par la croffe & l’anneau. Les
rois d’Angleterre jouiffoient aufli de ce droit.
Ce fut en 1078 que commença la fameufe querelle
des invejlitures pour les éyêchés & abbayes;
un concile de Rome défendit à tout clerc de les recevoir
de la main d’un prince, ou de tout autre
laïc.
Grégoire VII. fut le premier qui défendit les investitures
; il fut fuivipar V iâ o r III & Urbain II ; ce
dernier alla même jufqu’à défendre le ferment de fidélité
des évêques.
Henry IVe au nom étoit alors empereur, & fou-
tenoit les invejlitures ; Grégoire VII appelloit cela les
héréfies henriciennes.
Cette queftion excita beaucoup de troubles, fur-
tout en Allemagne'& en Angleterre ; Henry IV. fut
excomunié par trois papes fucceflivement ; cela pro-
duifit plufieurs fchifmes & des guerres continuelles;
pendant cinquante-fix ans que dura ce démêlé fameux
fous fix papes différens, il y eut à cette occasion
foixante batailles fousHenryIV.& foixante-huit
autres fous Henry V . fon fucceffeur ; il y périt plus
de deux millions d’hommes. Califte II engagea Henry
V . à renoncer aux invejlitures, ce qu’il fit en
1122.
Lothaire le Saxon entreprit en 1132 de les faire
revivre , mais S. Bernard l ’en diffuada.
Au commencement de cette querelle, ce ne fut
pas feulement la cérémonie extérieure du bâton &
de l ’anneau, qui excita de la difficulté ; on attaqua
toutes les invejlitures des bénéfices en général, de
quelque maniéré qu’elles fuffent faites par les laïcs.
M. de Voltaire, en fon hiftoire univerlelle, dit qu’il
fut décidé dans un concile à Rome , que les rois
ne donneroient plus aux bénéficiers canoniquement
élus, les invejlitures par un bâton recourbé, mais
par une baguette. Il paroît rapporter ce concile à
l’année 1120 ;- on ne voit point cependant qu’il y
en ait eu à Rome cette année. Ce fut dans une af-
femblée tenue à Vorms en 1 12 2 , que fe fit l’accommodement
; l ’empereur renonça à donner les invejlitures
par la croffe & l’anneau, & le pape lui permit
d ’accorder Yinvejliture des regales, c ’eft-à-dire, des
biens temporels par l»e fceptre.
A l ’égard de la France, nos rois n’eurent prefque
aucuns démêlés avec les papes touchant les invejlitures
; ils en ont joui pailiblement même fous Grégoire
V II. qui craignit de s’attirer trop d’ennemis à
la fois , s ’il 1e brouilloit avec la France pour ce fu-
jet ; fous les papes fuivans iis fe départirent de Yinvejliture
par le bâton paftoral & l ’anneau, & fe contentèrent
de la donner par écrit ou de vive voix ;
au moyen de quoi les fucceffeurs de Grégoire VII.
qui paroiffoient ne s ’attacher qu’à cette cérémonie
extérieure , ont laiffé nos rois jouir pailiblement du
ferment de fidélité , qui a fuccédé aux invejlitures ,
& des droits de joyeux-avenement & de regale.
Par le concordat paffé entre Leon X & François I
le roi eft maintenu dans le droit de nommer aux
évêchés, abbayes & autres bénéfices de nomination
royale.
Voyez le glojf. deDucange au mot INVESTITURE,"
où il rapporte plufieurs maniérés différentes de donner
Yinvejliture ecc\éüaû.iq\ie,perlibrum)percapellumt
per candelabrum , per grana incejji, & autres fembla-
bles.
Voyt^ Covaruvias , Cujas, Guymier, l'hijloirede
l'origine des dix mes, le traite de la capacité des eccléjiafr
tiques de Duperray. (A )
INVÉTÉRÉ , adj. ( Gramm. ) quifubfifte depuis
long-tems ; il ne f e . prend gueres qu’en mauvaifç
part ; il vient du latin vêtus, vieux. On dit un mal
invétéré, un abus invétéré. Rien de fi difficile à déraciner
que les chofes invétérées , tant au phyfique,
qu’au moral, & qu’au politique.
INVINCIBLE , adj. ( Gramm. ) qu’on ne peut
renverfer, détruire, vaincre. On dit un homme invincible
, un râifonnement invincible , une preuve invincible.
Un des philofophes que les Athéniens envoyèrent
à Rome, prouva un jour la diftjnérion ab-
folue du jufte & de l’injufte par des raifons qui parurent
invincibles ; le lendemain il prouva le contraire
par des raifons oppofées , que Cicéron compare
à des bêtes féroces qu’il ne fe promet pas de détruire,
de vaincre,mais qu’il feroit trop heureux pour la con-
folation des gens de bien, & pour le bonheur de la
république, d’appaifer , d’adoucir, de calmer. P la-
care , dit cet homme dont l’éloquence a paffé en proverbe.
Qu’étoit-ce donc que ces argumens qui ef-
frayoient Cicéron même?
INVIOLABLE, adj. ( Gramm. ) qui ne fera point
violé , ou qui ne le doit point être. La liberté de
confcience eft un privilège inviolable. La foi du ferment
eft facrée , ou eft inviolable pour tout homme
de bien.
INVISIBLE, adj. ( Gramm. ) qui échappe à la
vu e , ou par fa nature , ou par la petiteffe de fes
parties, ou par fa diftance ; les fubftances fpirituel-
les font invijibles ; les. particules de l’air font inviji-
bles ; les corps nous deviennent invijibles à force de
.s’éloigner. Si une ehofe n’a point ete fenfible, on
n’en a nulle idée repréfentative.Une queftion difficile
à réfoudre, c’eft fi les aveugles ont des idées-repré-
fentajives, &C. où ils les ont, & comment ils les ont,
fi fembïe dite Pidèe représentât iv e d ’un objet entraîne
l’idée dé limite ; & Celle'de limite , l ’idée de coa-
l'èur. L ’aveugle voit-il les objets dans fatfete ou au
bout dé fes doigts ? N . 2 In v i s i b l e s , f. ni. pl. ( Theolog. ) eft le nom qu on
donne à quelques rigides confeflioniftes, & aux (éclateurs
d’Ofiander, de Fladius-Illyricus & deSwer-
k fe ld , qui croyoiêftt qu’il n’y a point d Egide viü-
ble. Les freres de la Rpze-Croix ont ete aufli appelles
invijibles. Prateole, invijib. Florimont de Raimond
, liv. IL ckap. xvj. &CC. Foye{ CO N F E S S IO -
NÎSTESvfÆT)* « , r 1N VITATEUR, f. m. (Gram. Uijl. anc.) domestique
chez les Romains, dont la fonaion éioit d inviter
les conviés aux repas qu’on donnoit. On appelloit
aufCivocator. Vinvitateur étoit communément
un affranchi. .
INVITATOIRE, f. m. { Liturg. ) verfet que 1 on
Chante Ou récite à mâtinés avant le venite exultemus,
& à la fin dece pfeaume ; il change fuivant la qualité
des jours & des fêtes. Il n’y a point d'invitatoire e
jour de l’Epiphanie, ni les trois derniers jours de la
lèmaine fainte.
INFO C A T I , ( Hijl. litt. ) nom d une fociete lit- I
téraire, établie à Sienne en Italie, qui a pris pour I
devife *une enclume , fur laquelle eft pofé un fer
rouge & un marteau, avec l’infeription in quafeum-
qut formas. .
INVOCATION , f. f. ( Théolog. ) aftion par laquelle
on adore D ie u , & on l’appelle à fon fecours.
Foyèi P R IE R E , A D O R A T IO N , &C.
Les catholiques romains invoquent les famts, les
priant d’interceder pour eux auprès de Dieu. Vin-
vocation des faints eft un des plus grands fujets des
dirputes entre les Catholiques & les Réformés. Voye^
S a i n t . ‘ .
Invocation, en terme de Po'èjie, eft une priere
que le poète adreffe, en commençant foti ouvrage ,
à quelque divinité, fur-tout à fa mufe pour en être
infpiré. Foye{ MU SE S . , „ .
. L ’invocation eft abfolument neceffaire dans un
poème épique, à caufe que le poète dit des chofes
qu’il ne fauroit pa s, fi quelque divinité ne les lui
avoit infpirées. D ’ailleurs il doit à fes leôeurs cet
exemple d ’une piété & d’une vénération, qui eft le
fondement de toute la morale & des inftruâions qu il
prétend leur donner dans fa fable ; & puifqu’ enfin
les divinités doivent être de la partie , il n’eft pas
raifonnable qu’il ofe les faire,agir * fans leur en avoir
demandé la permiflîon. Foyt^ E p i q u e .
L ’auteur s’adreffe fouvent aux dieux dans le cours
d’un poème épique ; fur-tout lorfqu’il veut raconter
quelque chofe de miraculeux, comme lorfque V îr-
pile décrit la métamorphofe des navires d’Enée en
nymphes; mais la principal e invocation eû celle du
commencement. ,
Le pere le Boffu confidere deux choies dans 1 invocation
; la première eft ce que le poète demande ;
& la fécondé, quelle eft la divinité^ à qui il s adreffe.
Quant à la première, Homere a fi bien joint la pro-
pofitionavec Y invocation dans l’Iliade, qu’i l invoque
la mufe pour tout ce qu’il prOpofe fans réferve ;
Virgile au contraire ne prie fa mufe que de lui fournir
une partie de fon fujet, & même il détermine
précifément celle qu’il defire ; après avoir affez
exaftement propofé toute la matière, il s adreüe à
fa mufe, & il la prie de lui en apprendre les caules.
Foyer PROPOSITION.
Quant à la divinité qu’il invoque, e meme auteur
•WM oblerve que ce doit toujours être celle qui prelide au qu'il traite, ou celle qui prelide à lapoefie en
général. Ovide , dans fesmétamorphofes , .tait te
première forte A'iavocàtion ; Lucrèce en agit de tne-
■ me dans fon poëtnejcelles d’Homere.fie devtrgtle
Tome V llL
font de la première efpeCe ; ils n*invoquent que le s .
mufes , & diftinguent par là les divinités qui préfi-
dent à la poéfie , d’avèc celles qui préfident aux actions
des poèmes , & qui en font les perfonoàges. .
Au refte, il ne faut pas s’imaginer que ces divini-,
tés invoquées foient confidérées par les poètes mêmes
, comme des perfonpes divines, dont ils attendent
un véritable lècoursi Sous ce nom de mufes *.
ils fouhaitent le génie de là poëfie, & toutes des con-.
dirions & les circonftances néceflaires pour exécù-,
ter leur entreprife. Ce font des allégories & des.
maniérés de s’exprimer poétiquement* comme quand,
on fait des dieux du lbmmeil, du calme, de la re-,f
nommée, de la terreur, & des femblables deferip-. .
rions des chofes naturelles pu morales ; aufli les mufes
font-elles de tous les âges, de tous les p a y s& dé
toutes les religions ; il y en a dé payenhes ,;de chré*.
tiennes, de grecques, de latines, de françbifes, «S’cv
V o y e { Muses.
INV OLONT AIRE, adj. (Gram.') ce à quoi la volonté
n’a point eu de part; ce qui n’a point été ou n.’eft pas
voulu, confenti. Il paroît à celui qui examinera les
aérions humainès de près , que toute la. différencé
des volontaires & des involontaires conflit e à avoir!
é té, ou n’avoir pas été réfléchies. Je.marche,
fous mes pies il fe rencontre des infeûes que j’é-
crafe involontairement. Je marche, & je vois un fer-;
pent endormi ; je lui appuie mon talon fur la tête 4
6c. je l’écrafe volontairement. Ma réflexion eft la feule
chofe qui diftingue ces deux mouvemens, & ma.
réflexion confidérée relativement à tous les inftans
de ma durée, &c à ce que je fuis dans le moment oit
j’agis, eft abfolument indépendante demoi. J’écrafè
le ferpent de réflexion ; de réflexion Cleopâtre lé
prend & s’en pique le iein. C ’eft l ’amour de la vie
qui m’entraîne ; c’eft la haine de la vie qui entraîne
Cléopâtre. Ce font deux poids qui agiffent en fens
contraires fur les bras de la balance , qui ofcillentSs
fe fixent néceffairement. Selon le côté ou le point où
ils s’arrêtent, l’homme eft bienfaifant ou malfaifant,
heureufement ou malheureufement né , extermina*
ble ou digne de récompenfe félon les lois*
J O JOÀCHIMITES, f. m. pl. ( Théologie.) difciples
de Joachim, abbé de Flore en Calabre, qui paffa
pour un prophète pendant fa v ie , & laiffa après fa
mort beaucoup de livres de prophétie , & plufieurs
autres ouvrages qui furent condamnes avec leur
auteur en 1215 par le concile de Latran, & pat. celui
d’Arles en ,1.260... ... .... • - - 1 .
Les Joachimites étoiênt entêtés de certains nom--
bres ternaires. Ils difoient que le Pefe avoft opéré
depuis le commencement du monde, jufqu a 1 avene-
ment du Fils, que l’opération du Fils avoit duré juf-
qu’à leur tems pendant 1260 ans, qu’après cela lé
S. Efpritdevoit opérer aufli à fon tour. Ils divifoient
ce qui regardoit les hommes, les tems, la dourine*
la maniéré de vivre en trois ordres ou états, leloa
les trois Perfonnes de la fainte Trinité : ainfi chacune
de ces trois chofes comprenoit trois états qui
dévoient fe fuccéder, ou s’étoient déjà fuccede les
uns aux autres , ce qui faifoit qu’ils uommoient ces
divifions ternaires. . -, î
Le premier ternaire étoit celui des hommes , u
comprenoit trois états ou ordres d’hommes ; le premier
étoit celui des gens mariés, qui a voit dure,
difoient-ils, du tems du Pere éternel, ceft-à-diré,,
fous l’ancien Teftament* Le fécond celui des clercs
qui a régné par le Fils du tems de la grâce. Le trot-
fieme celui des moines qui devoit régner du tems de
la plus grande grâce par le Saint-Efprit. Le fécond
ternaire étoit celui de la doûrine, .qu’fis divifoient
R R r r r ij