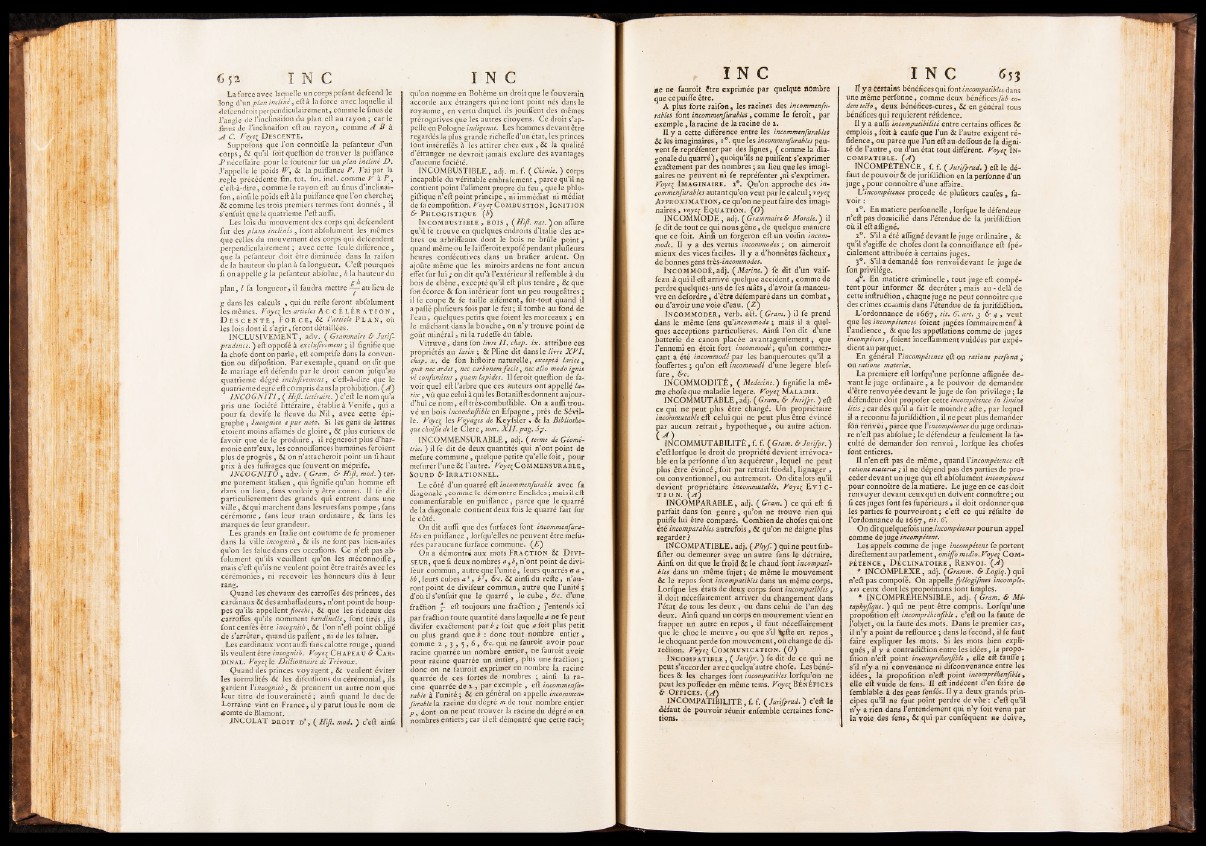
La force avec laquelle un corps pefant defcend le
long d’un .plan incliné, eft à la force avec laquelle il
«defcendroit perpendiculairement, comme le linus de
l’angle de l’inclinàifon du plan eft au rayon ; car -le
iinusde l’inclinaifon eft au rayon, comme 4 B à
C. Voye^ D esc ente.
Suppofons que l’on connoiffe la pefanteur d’un
corps, & qu’il foit queftion de trouver la puiflance
T néceffaire .pour le foutenir fur un plan incliné D .
J ’appelle le poids W, & la puiflance P. J’ai par la
.regle précédente fin. tot. fin. incl. comme V à P ,
c ’eft-à-dire, comme le rayon eft au finus d’inclinai-
fon , ainlile poids eft à la puiflance que l’on cherche;
&(. comme les trois premiers termes font donnés , il
s ’enfuit que le quatrième l’eft aufli.
Les lois du mouvement des corps qui defcendent
fiir des plans inclinés, font abfolument les mêmes
que celles du mouvement des corps qui defcendent
perpendiculairement ; avec cette feule différence ,
que la pefanteur doit être diminuée dans la raifon
de la hauteur du plan à fa longueur. C ’eft pourquoi
lio n appelle g la pefanteur abfolue, h la hauteur du
g h
plan, / fa longueur, il faudra mettre -^-au heu
g dans les calculs , qui du refte feront abfolument
les mêmes. Voycç les articles A C C É L ÉR A T IO N ,
D e s c e n t e , F o r c e , & l'article P l a n , où
les lois dont il s’agit, feront détaillées.
INCLUSIVEMENT, adv. ( Grammaire & Jurif-
prudence. ) eft oppofé à exclufivement ; il fignifïe que
la chofe dont on parle, eft comprife dans la convention
ou difpofition. Par exemple, quand on dit que
le mariage eft défendu parle droit canon jufqu’au
quatrième degré inclußvement, c’eft-à-dire que le
quatrième degré eft compris dans la prohibition. (A )
INCOGN1T I , ( Hiß. littéraire. ) c’eft le nom qu’a
pris une fociété littéraire, établie à Venife , qui a
pour fa devife le fleuve du N il, avec cette épigraphe
, Incognito e pur noto. Si les gens de lettres
étoient moins affamés de gloire, & plus curieux de
favoir que de fe produire , il régneroit plus d’harmonie
entr’eux, les connoiffances humaines feroient
plus de progrès , & on n’attacheroit point un fi haut
prix à des luffrages que fouvent on méprife.
INCOGNITO , adv. ( Gram. & Hiß. mod. ) terme
purement italien , qui lignifie qu’un homme eft
dans un lieu , fans vouloir y être connu. Il fe dit
particulièrement des grands qui entrent dans une
v ille , & qui marchent dans les rues fans pompe, fans
cérémonie , fans leur train ordinaire, & fans les
marques de leur grandeur.
Les grands en Italie ont coutume de fe promener
dans la ville incognitb, & ils ne font pas bien-aifes
qu’on les falue dans ces occafions. Ce n’eft pas abfolument
qu’ils veuillent qu’on les méconnoiffe,
mais c’eft qu’ils ne veulent point être traités avec les
cérémonies, ni recevoir les honneurs dûs à leur
rang.
Quand les chevaux des carroffes des princes, des
cardinaux & des ambaffadeurs, n’ont point de houppes
qu’ils appellent fiocchi, & que les rideaux des
carroffes qu’ils nomment bandinelle, font tirés , ils
font cenfés être incognitb, & l’on n’eft point obligé
de s’arrêter, quand ils paffent, ni de les l'aluer.
Les cardinaux vont aufli fans calotte rouge, quand
ils veulent être incognitb. Voye[ C hapeau & C a r d
in a l . Voye[ le Dictionnaire de Trévoux.
Quand des princes voyagent, & veulent éviter
les formalités .& les difeuflions du cérémonial, ils
gardent l'incognitb, & prennent un autre nom que
leur titre de fouveraineté ; ainfi quand le duc de
Lorraine vint en France, il y parut fous le nom de
■ comte de Blamont.
JNCOLAT d ro it d’ , .{.Hiß, mod. ) c’eft ainfi
qu’on nomme en Bohème un droit que le fouverain
accorde aux étrangers qui ne font point nés dans le
royaume, en vertu duquel ils jouiffent des mêmes
prérogatives que les autres citoyens. Ce droit s’appelle
en Pologne indigenat. Les hommes devant être
regardés la plus grande richeffed’un état, les princes
font intéreffés à les attirer chez eux , & la qualité
d’étranger ne devroit jamais exclure des avantages
d’aucune fociété.
INCOMBUSTIBLE, adj. m. f. ( Chimie. ) corps
incapable du véritable embrafement, parce qu’il ne
contient point l’aliment propre du feu , que le phlo-
giftique n’eft point principe, ni immédiat ni médiat
de facompofition. Voye^C om bu st io n , Ig nitio n
& Ph lo g is t iq u e (b)
Incom bu st ib le , bo is , ( Hifi. nat. ) on affure
qu’il fe trouve en quelques endroits d'Italie des arbres
ou arbriffeaux dont le bois ne brûle point,
quand même ou le laifferoit expofé pendant plufieurs
heures confécutives dans un brafier ardent. On
ajoûte même que les miroirs ardens ne font aucun
effet fur lui ; on dit qu’à l ’extérieur il reffemble à du
bois de chêne, excepté qu’il eft plus tendre, & que
fon écorce & fon intérieur font un peu rougeâtres ;
il fe coupe & fe taille aifément, fur-tout quand il
a paffé plufieurs fois par le feu ; il tombe au fond de
l ’eau, quelques petits que foient les morceaux ; en
le mâchant dans la bouche, on n’y trouve point de
goût minéral, ni la rudeffe du fable.
Vitruve, dans fon livre II. chap. ix. attribue ces
propriétés au larix ; & Pline dit dans le livre X V I .
chap. x . de fon hiftoire naturelle t excepta larice,
quee nec ardet, nec carbonem facit, nec alio modo ignis
vi confumitur , quam lapides. Il feroit queftion de fa-,
voir quel eft l’arbre que ces auteurs ont appellé la
r ix , vû que celui à qui les Botaniftes donnent aujourd’hui
ce nom, eft très-combuftible. On a aufli trouv
é un bois incombujtible en Efpagne, près de Séville.
Voyeç les Voyages de Keyfsler , & la Bibliothèque
choijie de le Clerc, tom. X I I . pag. 5y.
INCOMMENSURABLE, adj. ( terme de Géométrie.
) il fe dit de deux quantités qui n’ont point de
mefure commune, quelque petite qu’elle foit, pour
mefurer l’une & l’autre. Voye{ C ommensurable ,
Sourd & Irr a t io n n e l .
Le côté d’un quarré eft incommenfurable avec fa
diagonale , comme le démontre Enclides ; mais il eft
commenfurable en puiflance, parce que le quarré
de la diagonale contient deux fois le quarré fait fur
le côté.
On dit aufli que des furfaces font incommenfura-
bles en puiflance, lorfqu’elles ne peuvent être mefu-
rées par aucune furface commune. (.£)
On a démontré aux mots Fr a c t io n & D iv iseur,
que fi deux nombres a , b, n’ont point de divi-
feur commun, autre que l’unité, leurs quarrés n a ,
bb, leurs cubes a 3, b3, &c. & ainfi du refte, n’auront
point de divifeur commun, autre que l’unité ;
d’où il s’enfuit que le quarré , le cube , &c. d’une
fraCtion y eft toujours une fraCtion ; j’entends ici
par fraCtion toute quantité dans laquelle a ne fe peut
divifer exactement par b ; foit que a foit plus petit
ou plus grand que b : donc tout nombre entier,
comme z , 3 , 5 , 6 , &c. qui ne fauroit avoir pour
racine quarrée un nombre entier, ne fauroit avoir
pour racine quarrée un entier, plus une fraCtion ;
donc on ne fauroit exprimer en nombre la racine
quarrée de ces fortes de nombres ; ainfi la racine
quarrée de 2 , par exemple , eft incommenfurable
à l’unité ; & en général on appelle incommenfurable
la racine du dégré m de tout nombre entier
p , dont on ne peut trouver la racine du dégré m en
nombres entiers ; car il eft démontré que cette raci;
iae ne fauroit être exprimée par quelque nombre
que ce puiffe être.
A plus forte raifon, les racines des incommenfu-
rables font incommenfurables, comme le feroit, par
exemple, laraçine de la racine de 1.
Il y a cette différence entre les incommenfurables
& les imaginaires, i° . que les incommenfurables peuvent
fe repréfenter par des lignes, ( comme la diagonale
du quarré), quoiqu’ils ne puiffent s’exprimer
exactement par des nombres ; au lieu que les imaginaires
ne peuvent mi fe repréfenter ,ni s’exprimer.
Voyt{ Im ag in a ir e . z°. Qu’on approche des incommenfurables
autant qu’on veut par le calcul ; voye^
A p p ro x im a t io n , ce qu’on ne peut faire des imaginaires
, voyt{ Eq u a t io n . (O)
INCOMMODE , adj. (Grammaire& Morale.') il
fe dit de tout ce qui nous gêne, de quelque maniéré
que ce foit. Ainfi un forgeron eft un voifin incommode.
Il y a des vertus incommodes ; on aimeroit
mieux des vices faciles. Il y a d’honnêtes fâcheux,
de bonnes gens tiès-incommodes.
In c om m o d é , adj. (Marine.) fe dit d’un vaif-
feau à qui il eft arrivé quelque accident, comme de
perdre quelques-uns de fes mâts, d’avoir fa manoeuvre
en defordre , d’être défemparé dans un combat,
ou d’avoir une voie d’eau. (Z )
In g om m o d er , verb. aCt. (Gram.) il fe prend
dans le même fens qu5incommode ; mais il a quelques
acceptions particulières. Ainfi l’on dit d’une
batterie de canon placée avantageufement, que
l’ennemi en étoit fort incommodé ; qu’un commerçant
a été incommodé par les banqueroutes qu’il a
fouffertes ; qu’on eft incommodé d’une legere blef-
fure, &c.
INCOMMODITÉ, { Médecine.) fignifïe la même
chofe que maladie legere. Voye£ Ma l a d ie .
INCOMMUTABLE, ad). (Gram. & Jurifpr. ) eft
ce qui ne peut plus être changé. Un propriétaire
incommutable eft celui qui ne peut plus être évincé
par aucun retrait, hypotheque, ou autre aCtion.
( A )
INCOMMUTABILITÉ, f. f. (Gram. & Jurifpr. )
c’eft lorfque le droit de propriété devient irrévocable
en la perfonne d’un acquéreur, lequel ne peut
plus être évincé, foit par retrait féodal, lignager ,
ou conventionnel, ou autrement. On dit alors qu’il
devient propriétaire incommutable. Voye? E v i c t
i o n . (A)
INCOMPARABLE, adj. ( Gram. ) ce qui eft fi
parfait dans fon genre, qu’on ne trouve rien qui
puiffe lui être comparé. Combien de chofes qui ont
été incomparables autrefois, & qu’on ne daigne plus
regarder ?
INCOMPATIBLE, adj. (Ph y f.) qui ne peutfub-
fifter ou demeurer avec un autre fans le détruire.
Ainfi on dit que le froid & le chaud font incompatibles
dans un même fujet ; de même le mouvement
& le repos font incompatibles dans un même corps.
Lorfque les états de deux corps font incompatibles ,
il doit néceffairement arriver du changement dans
l’état de tous les deux , ou dans celui de l’un des
deux. Ainfi quand un corps en mouvement vient en
frapper un autre en repos, il faut néceffairement
que le choc le meuve, ou que s’il %fte en repos ,
le choquant perde fon mouvement, ou change de direction.
Voye%_ C om m u n ic a t io n . (O)
In c om p a t ib l e , ( Jurifpr.) fe dit de ce qui ne
peut s’accorder avec quelqu’autre chofe. Les bénéfices
& les charges font incompatibles lorfqu’on ne
peut les poffeder en même tems. Voye^ Bénéfices
& O f f ic e s . (A)
INCOMPATIBILITÉ, f. f. (Jurifprud.) c’eft le
défaut de pouvoir réunir enfemble certaines fonctions.
II y a Certains bénéfices qui font incompatibles dans
une même perfonne, comme deux bénéfices fub eo-
dem teclo, deux bénéfices-cures, & en général tous
bénéfices qui requièrent réfidence.
Il y a aufli incompatibilité entre certains offices &
emplois, foit à caufe que l’un & l’autre exigent réfidence
, ou parce que l ’un eft au-deffous de la dignité
de l’autre, ou d’un état tout différent. Voye^ Inco
m p a t ib l e . (A )
INCOMPÉTENCE, f. f. (Jurifprud. ) eft le défaut
de pouvoir & de jurifdiCtion en la perfonne d’un
juge, pour connoître d’une affaire.
incompétence procédé de plufieurs caufes , favoir
:
i ° . En matière perfonnelle , lorfque le défendeur
n’eft pas domicilié dans l’étendue de la jurifdiCtion
où il eft afligné.
2°. S’il a été afligné devant le juge ordinaire, &
qu’il s’agiffe de chofes dont la connoiflance eft fpé-
cialement attribuée à certains juges.
30. S’il a demandé fon renvoi devant le juge de
fon privilège.
4°. En matière criminelle, tout juge eft compétent
pour informer & décréter ; mais au - delà de
cette inftruCtion, chaque juge ne peut connoître que
des crimes commis dans l’étendue de fa jurifdiCtion.
L ’ordonnance de 1667, tit. G. art. $ & 4 , veut
que les incompétences foient jugées fommairemenf à
l’audience, & que les appellations comme de juges
incompétens, foient inceffammentvuidées par expédient
au parquet.
En général l’incompétence eft ou ratione perfonot y
ouratione materioe.
La première eft lorfqu’une perfonne aflignée devant
le juge ordinaire, a le poiivoir de demander
d’être renvoyée devant le juge de fon privilège ; le
défendeur doit propofer cette incompétence in Liminc
litis ; car dès qu’il a fait le moindre a fte, par lequel
il a reconnu la jurifdiâion, il ne peut plus demander
fon renvoi, parce que l’incompétence du juge ordinaire
n’eft pas abfolue ; le défendeur a feulement la faculté
de demander fon renvoi, lorfque les chofes
font entières.
Il n’en eft pas de même, quand l’incompétence eft
ratione materia ; il ne dépend pas des parties de procéder
devant un juge qui eft abfolument incompétent
pour connoître de la matière. Le juge en ce cas doit
renvoyer devant ceux qui en doivent connoître ; ou
fi ces juges font fes fupérieurs , il doit ordonner que
les parties fe pourvoiront ; c’eft ce qui réfulte de
l’ordonnance de 1667, tit. G.
On dit quelquefois une.incompétence pour un appel
comme de juge incompétent.
Les appels comme de juge incompétent fe portent
directement au parlement, omijfo medio. Voye{ C om pétence
, D é c l in a to ir e , Ren vo i . (A )
* INCOMPLEXE, adj. (Gramm. & Logiq.) qui
n’eft pas compofé. On appelle Jyllogifmts incomple-
xts ceux dont les proportions font fimples.
| INCOMPRÉHENSIBLE, adj. ( Gram. & Mé-
taphyfque. ) qui ne peut être compris. Lorfqu’une
propofition eft incomprèhenjîble, c’eft ou la faute de
l’objet, ou la faute des mots. Dans le premier cas,
il n’y a point de reffource ; dans le fécond, il fe faut
faire expliquer les mots. Si les mots bien expliqués
, il y a contradi&ion entre les idées, la proportion
n’eft point incomprèhenjîble , elle eft fauffe ;
s ’il n’y a ni convenance ni difconvenance entre les
idées , la propofition n’eft point incomprèhenjîble,
elle eft vuide de fens. Il eft indécent d’en faire de
femblable à des gens fenfés. Il y a deux grands principes
qu’il ne faut point perdre de vûe : c’eft qu’il
n’y a rien dans l’entendement qui n’y foit venu par
la voie des fens, & qui par conféquent ne doive,