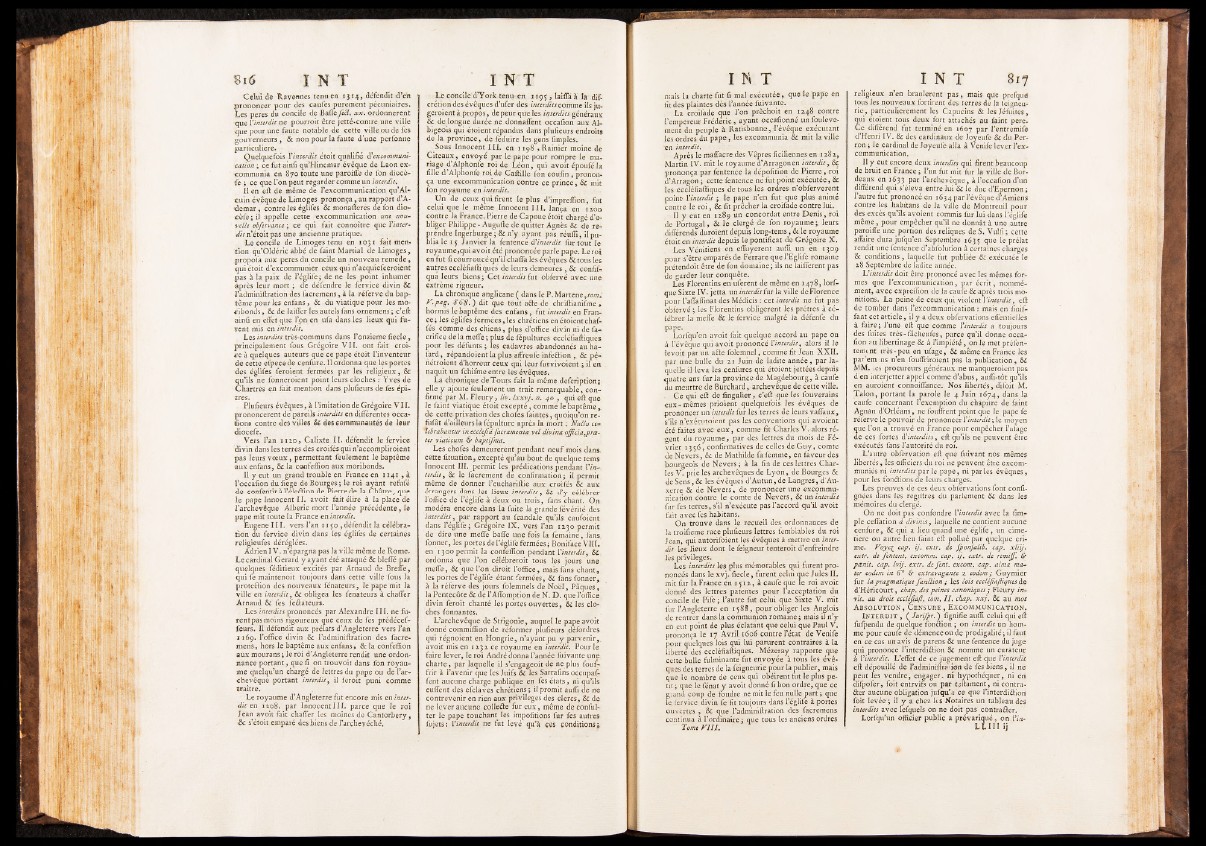
Celui de Ravennes tenu en 1314 , défendit d’en
prononcer -pour des caufes purement pécuniaires.
Les peres du concile de Bailefecl. xr.-ordonnèrent
que Y Interdit ne pourroit être jetté*contre une ville
que pour une faute notable de cette ville ou de fes
gouverneurs , & non pour la faute d’une perfonne
particulière.
Quelquefois Yinterdit étoit qualifié d’excommunication
; ce fut ainfi qu’Hincmar.évêque de Laon excommunia
en 870 toute une paroiffe de fon diocè-
fc ; ce que l’on peut regarder comme un interdit,
Il en eft de même de l’excommunication qu*Alcuin
évêque de Limoges prononça, au rapport d’A-
'demar, contre les églifes & monafteres de fon dio-
cè fe ; il appelle cette excommunication une nouvelle
obfervance ; ce qui fait connoître que Y interdit
n’étoit pas une ancienne pratique.
Le concile de Limoges tenu en 1031 fait mention
qu’Oldéric abbé de faint Martial de Limoges,
propofa aux peres du concile un nouveau remede,
qui étoit d’excommunier ceux qui n’acquiefceroient
pas à la paix de l’églife ; de ne les point inhumer
après leur mort ; de défendre le fervice divin &
l’adminiftration des facremens , à la réferve du baptême
pour les enfans, & du viatique pour les moribonds,
& de laiffer les autels fans ornemens ; c’eft
ainfi en effet que l’on en ufa dans les lieux qui furent
mis en interdit.
Les interdits très-communs dans l’onzieme fiecle,
principalement fous Grégoire V I I . ont fait croire
à quelques auteurs que ce pape étoit l’inventeur
de cette efpecede cenfure. Il ordonna que les portes
des églifes feroient fermées par les religieux, &
qu’ils ne tonneraient point leurs cloches : Yves de
Chartres en fait mention dans plufieurs de fès épi-
ires.
Plufieurs évêques, à l ’imitation de Grégoire V I I .
prononcèrent de pareils interdits en différentes occasions
contre des villes & des communautés de leur
diocefe.
Vers l’an 1 120, Calixte IL défendit le fervice
divin dans les terres des croifés qui n’accompliroient
pas leurs voe u x , permettant feulement le baptême
aux enfans, & la confeffion aux moribonds.
Il y eut un grand trouble en France en 1141 , à
l ’occafion du fiepe de Bourges ; le roi ayant refufé
de confentir à l’eleétion de Pierre de la Châtre, que
le pape Innocent 11. avoit fait élire à la place de
l ’archevêque Alberic mort l’année précédente, le
pape mit toute la France en interdit.
Eugene I I I . vers l’an 1 150 , défendit la célébration
du fervice divin dans les églifes de certaines
religieufes déréglées.
Adrien IV . n’épargna pas la ville même de Rome.
Le cardinal Gérard y ayant été attaqué & bleffé par
quelques féditieux excités par Arnaud de Breffe,
oui fe maintenoit toujours dans cette ville fous la
proteûion des nouveaux fénateurs, le pape mit la
ville en interdit, & obligea les fenateurs à chaffer
Arnaud & fes feâateurs.
Les interdits prononcés par Alexandre III. ne furent
pas moins rigoureux que ceux de fes prédécef-
feurs. II défendit aux prélats d’Angleterre vers l’an
1169. l’office divin ,& l’adminiftration des facremens,
hors le baptême aux enfans, & la confeffion
aux mourans ; le roi d’Angleterre rendit une ordonnance
portant, que fi on trouvoit dans fon royaume
quelqu’un chargé de lettres du pape ou de l’archevêque
portant interdit, il feroit puni comme
traître.
Le royaume d’Angleterre fut encore mis en interdit
ext 1208. par Innocent I II. parce que le roi
Jean avoit fait chaffer les moines de Cantorbery,
& s’étoit emparé des biens de l’archevéché.
Le concile d’York tenu-en 1 1 9 5 , laiffà à la dit
crétion des évêques d’ufer des interdits comme ils; jugeraient
à.propos, de peur que les interdits généraux
ôc de longue durée ne donnaffent occafion aux Albigeois
qui étoient répandus dans plufieurs endroits
de la province, de féduire les gens fimples.
Sous Innocent I I I . en 1198 , Rainier moine de
Citeaux, envoyé par le pape pour rompre le ma.
riage d’Alphonfe roi de Léon, qui avoit époufé la
fille d’Alphonfe roi de Caftille fon eoufin , prononça
une excommunication contre ce prince, & mit
fon royaume en interdit*
Un de ceux qui firent le plus d’impreffion, fut
celui que le même Innocent I I I . lança en 1200
contre la France. Pierre de Capoue étoit chargé d’o bliger
Philippe - Augufte de quitter Agnès & de reprendre
Ingerburge ; & n’y ayant pas. réuffi, il publia
le 1 5 Janvier la fentence d’interdit fur tout le
royaume,qui avoit été prononcée parle pape. Leroi
en fut fi courroucé qu’il chaffa les évêques & tous les
autres eccléfiaftiques de leurs demeures, & confit
qua leurs biens ; Cet interdit fut obfervé avec une
extrême rigueur,
La chronique anglicane ( dans le P.Martene,WOT.’
Vpag. 8 6$.,) dit que tout afte de chriftianifme ,
hormis le baptême des enfans, fut interdit en France
; les églifes fermées, les chrétiens en étoient chaf-
fés comme des chiens, plus d’office divin ni de fa-
crifîce de la meffe ; plus de fépultures eccléfiaftiques.
pour les défunts ; les cadavres abandonnés au hâ-
fard, répandoient la plus affreufe infeCtion , & pénétraient
d’horreur ceux qui leur furvivoient ; il en
naquit un fehifine entre lès évêques.
La chronique de Tours fait la même defeription;
elle y ajoute feulement un trait remarquable, confirmé
par M. Fleury > liv. Ixxvj. n. 40 , qui eft que
le faint viatique étoit excepté, commë le baptême ,.
de cette privàtion des chofes faintes, quoiqu’on re-
fufât d’ailleurs la fépulture après la mort : Nulla ce-
lebrabantur in ecclejiâ facramenta vel divina officia,prêter
viaticum & baptifma.
Les chofes demeurèrent pendant neuf mois dans
cette fituation, excepté qu’au bout de quelque tems
Innocent III. permit les prédications pendant Yin-
terdit, & le facrement de confirmation; il permit
même de donner l’euchariftie aux croifés & aux
étrangers dans les lieux interdits, & d’y célébrer
l’office de l’églife à deux ou trois, fans chant. On
modéra encore dans la fuite la grande févérité des
interdits, par rapport au fcandale qu’ils caufoient
dans l’églife ; Grégoire IX. vers l’an .1230 permit
de dire une meffe baffe une fois la femaine, fans,
fonner, les portes de l’églife fermées ; BonifaceVIIÎ.
en 1300 permit la confeffion pendant Y interdit, &
ordonna que l ’on célébrerait tous les jours une
meffe, & que l’on dirait l’office, mais fans chant,
les portes de l’églife étant fermées, & fans fonner,
à la réferve des jours folemnels de Noël, Pâques,
la Pentecôte & de l’Affomption de N. D. que l’office
divin feroit chanté les portes ouvertes, & les cloches
fonnantes.
L’archevêque de Strigonie, auquel le pape avoit
donné commiffion de réformer plufieurs défordres
qui régnoient en Hongrie, n’ayant pu y parvenir,
avoit mis en 1232 ce royaume en interdit. Pour le
faire lever, le roi André donna l’année fuivante une
charte, par laquelle il s’engageoit de ne plus fouf-
frir à l’avenir que les Juifs & les Sarràfuis occupaf-
fent aucune charge publique en fes états, ni qu’ils
euffent des efclaves chrétiens ; il promit auffi de ne
contrevenir en rien aux privilèges des clercs, & de
ne lever aucune colle&e fur eux, même de conful-
ter le pape touchant les impofitions fur fes autres
fujets: Yinterdit ne fut levé qu’à ces conditions ;
mais h charte fut fi mal exécutée, que le pape en
fit des plaintes dès l’année fuivante.
La croifade que l’on prechoit en 1248 contre
l’empereur Frédéric, ayant occafionné un foulevé-
ment du peuple à Ratisbonne, Tévêqiie exécutant
les ordres du pape, les excommunia &c mit la ville
en interdit.
Après le maffacre des Vêpres ficiliennes en 1282,
Martin IV. mit le royaume d’Arragonen interdit,
prononça par fentence la dépofition de Pierre, roi
d’Arragon ; cette fentence ne fut point exécutée, &
les eccléfiaftiques de tous les ordres n’obferverent
point Yinterdit ; le pape n’en fu t que plus animé
contre le ro i, & fit prêcher la croifade contre lui.
Il y élit en 1289 un concordat entre Denis, roi
de Portugal, & le clergé de fon royaume ; leurs
différends duraient depuis long-tems, & le royaume
étoit en interdit depuis le pontificat de Grégoire X.
Les Vénitiens en effuyerent auffi un en 1309
pour s’être emparés de Ferrare que l’Eglife romaine
prétendoit être de fon domaine ; ils ne laifferent pas
de garder leur conquête.
Les Florentins en uferent de même en 1478, lorf-
que Sixte IV. jetta un interdit {iir la ville de Florence
pour l ’affaffinat des Médicis : cet interdit ne fut pas
obfervé ; les Florentins obligèrent les prêtres à célébrer
la meffe & le fervice malgré la défenfe du
pape.
Lorfqu’on avoit fait quelque accord au pape ou
à l’évêque qui avoit prononcé Yinterdit, alors il le
levoit par un a£te folemnel, comme fit Jean XXII.
par une bulle du 21 Juin de ladite année, par laquelle
il leva les cenfures qui étoient jettées depuis
quatre ans fur la province de Magdebourg, à caufe
du meurtre de Burchard, archevêque de cette villè.
Ge qui eft de fingulier, c’eft que les fouverains
eux-mêmes prioient quelquefois les évêques de
prononcer un interdit fur les terres de leurs vaffaux,
s’ils n’exécutoient pas les conventions qui avoient
été faites avec eu x, comme fit Charles V . alors récent
du royaume, par des lettres du mois de Février
1356, confirmatives de celles de G u y , comte
de Nevers, & de Mathilde fa femme, en faveur des
bourgeois de Nevers ; à la fin de ces lettres Charles
V . prie les archevêques de L y on , de Bourges &
de Sens, & les évêques d’Autun, de Langres, d'Auxerre
& de Nevers, de prononcer une excommunication
contre le comte de Nevers, & u n interdit
fur fes terres, s’il n’exécute pas l’accord qu’il avoit
fait avec fes habitans.
On trouve dans le recueil des ordonnances de
la troifieme race plufieurs lettres femblables du roi
Jean, qui autorifoient les évêques à mettre en interdit
les lieux dont le feigneur tenterait d’enfreindre
lès privilèges.
Les interdits les plus mémorables qui furent pro*
noncés dans le xvj. fiecle, furent celui que Jules II.
mit fur la France en 15 12 , à caufe que le roi avoit
donné dés lettres patentes pour l’acceptation du
concile de Pife ; l’autre fut celui qUe Sixte V. mit
fur l’Angleterre en 1588, popr obliger les Anglois
de rentrer dans la communion romaine ; mais il n’y
en eut point de plus éclatant que celui que Paul V.
prononça le 17 Avril 1606 contre l’état de Venife
pour quelques lois qui lui parurent contraires à la
liberté des eccléfiaftiques. Mézeray rapporte que
cette bulle fulminante fut envoyée à tous les évêques
des terres de la feigneurie pour la publier, mais
que le nombre de ceux qui obéirent tut le plus petit
; que le fénat y avoit donné fi bon ordre, que ce
grand coup de foudre ne mit le feu nulle part ; que
le fervice divin fe fit toujours dans l’églife à portes
ouvertes , & que l’adminiftration des facremens
continua à l’ordinaire ; que tous les anciens ordres
Tome V III.
religieux n’en branlèrent pa s, mais que prefquô
tous les nouveaux fortirent des terres de la leigneu-
rie , particulièrement les Capucins & les Jéfuites,
qui étoient tous deux fort attachés au faint pere.
Ce différend fut terminé en 1607 par l’entremife
d’Henri IV. & des cardinaux de Joyeufe & du Perron
; le cardinal de Joyeufe alla à Venife lever l’excommunication.
Il y eut encore deux interdits qui firent beaucoup
de bruit en France ; l’un fut mit fur la ville de Bordeaux
en 1633 par l’archevêque, à l’occafion d’un
différend qui s’éleva entre lui & le duc d’Epernon ;
l’autre fut prononcé en 1634 par l’évêque d’Amiens
contre les habitans de la. ville de Montreuil pour
des excès qu’ils avoient commis fur lui dans Ééglife
même, pour empêcher qu’il ne donnât à une .autre
paroiffe une portion des reliques de S. Vulfi; cette
affaire dura jufqu’en Septembre 16,3.5 ^ue prélat
rendit une fentence d’abfolution à certaines charges
& conditions, laquelle fut publiée & exécutée le
.28 Septembre de ladite année.
interdit doit être prononcé avec les mêmes formes
que l ’excommunication, par écrit, nommément,
avec expreffion de la caufe & après trois mo-
nitions. La peine de ceux qui violent Yinterdit, eft
de tomber dans l’excommunication: mais.en finif-
fant cet article, il y a deux obfervations effentielles
à faire; l’une eft que comme Yinterdit a toujours
des fuites très-fâcheufes, parce qu’il donne occafion
au libertinage &: à l’impiété, on le met préfen-
temtnt très-peu en ufage, & même en France les
par’em :ns n’en fouffriroient pas la publication, &c
MM. ies procureurs généraux ne manqueraient pas
d'en interjetter appel comme d’abus, auffi-tôt qu’ils
en auraient connoiffance. Nos libertés, difoit M.
Talon, portant la parole le 4 Juin 1674, dans la
caufe concernant l’exemption du chapitre de faint
Agnan d’Orléans, ne fouffrent point que le pape fe
rélèrve le pouvoir de prononcer Yinterdit ; le moyen
que l’on a trouvé en France pour empêcher l’ufagé
de ces fortes à’interdits, eft qu’ils ne peuvent être
exécutés fans l’autorité du roi.
L’autre obfervation eft que fuivant nos mêmes
libertés, les officiers du roi ne peuvent être excommuniés
ni interdits par le pape, ni parles évêques,
pour les fondions de leurs charges.
Les preuves de ces deux obfervations font confi-
gnées dans les regiftres du parlement &c dans les
mémoires du clergé..
On ne doit pas confondre Yinterdit avec la fini-
pie ceffation à divinis, laquelle ne contient aucune'
cenfure, & qui a lieu quand une églife, un cimetière
ou autre lieu faint eft pollué par quelque crime.
Voye{ cap. ij. extr. de fponjalib. cap. xliijt
extr. de fententi excomrn. cap. ij'. extr. de remiffi. &
pcenit. càp. Ivij. extr. de fent. excom. cap. a.lma mater
eodem in 6° & extravagante 2. eodem ; Guymier
fur la pragmatique fanclion ; les lois eçcléjîajliques de
d’Héricourt, chap. des peines cdnoniques ; Fleury in*
vit. au droit ecclejîafl, tom. I I . chap. xx j. oC au mot
A b so lu t io n , C ensure , Ex com m u n ic a t io n .
Int erd it , ( Jurïfpr. ) fignifie auffi celui qui eft
fufpendu de quelque fonction ; on interdit un homme
pour caufe de démence ou de prodigalité; il faut
en ce cas u'n aVis de parens & une fentence du juge
qiti prononce l’interdifrion & nomme un curateur
à Yinterdit. L’effet de ce jugement eft que Yinterdit
eft dépouillé de l’adminiftra-lGin de fes biens, il ne
peut les vendre, engager, ni hypothéquer, ni en
difpofer, foit entrvifs ou par teffament, ni contrarier
aucune obligation jufqu’i ce que l’interdifriort
fôit levée ; il y a chez Us Notaires un tableau des’
interdits avec lefquels on ne doit pas contracter.
Lorfqu’un officier public a prévariqué, on Vin*
L L IH ij