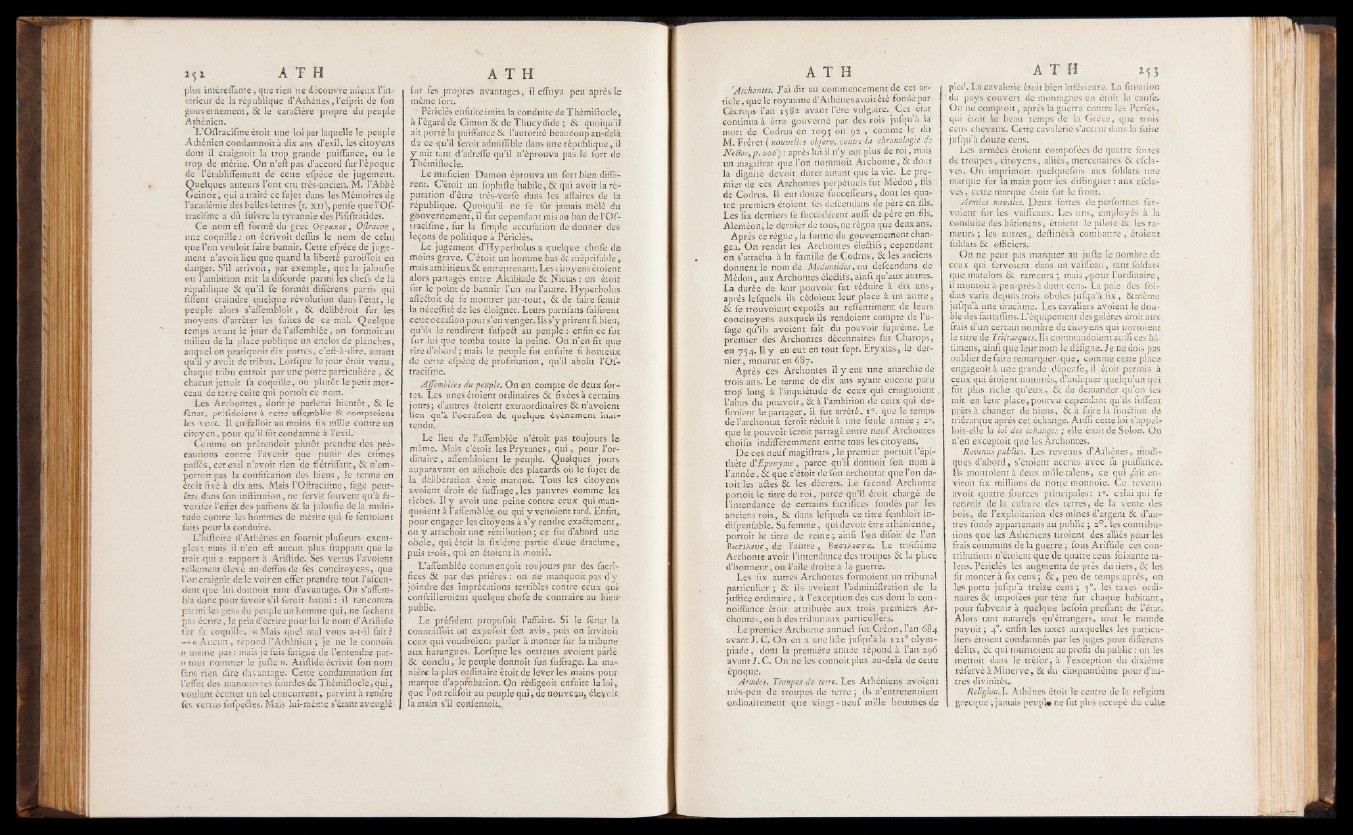
plus intéreffante, que rien ne découvre mieux l’intérieur
de la république d’Athènes, l’efprit de fon
gouvernement, & le cara&ère propre du peuple
Athénien.
L’Qftracifme étoit une loi par laquelle le peuple
Athénien condamnoità dix ans d’exil, les citoyens
dont il craignoit la trop grande puiffance, ou le
trop de mérite. On n’en pas d’accord fur l’époque
de l’établiffenient de cette efpèce de jugement.
Quelques auteurs l’ont cru très-ancien. M. l’Abbé
Geinoz, qui a traité ce lu jet dans les Mémoires de
l’académie des belles-lettres (t. x i i ), penfe que l’Of-
tracifme a dû fuivre la tyrannie des Pififtratides.
Ce nom eft formé du grec Oçç&kov , OJlracon ,
une coquille ; on écrivoit deffus le nom dé celui
que l’on voiiloit faire bannir. Cette efpèce de jugement
n’avoit lieu que quand la liberté paroiffoit en
danger. S’il arrivoit, par exemple, que la jaloufie
ou l’ambition mit la difcorde parmi les chefs de la
république Sc qu’il fe formât différens partis qui
fiffent craindre quelque révolution dans l’état, le
peuple alors s’affembloit, & délibêroit fur les
moyens d’arrêter les fuites de ce mal. Quelque
temps avant le jour de l’affemblée, on formoit au
milieu de la place publique un enclos de planches,
auquel on pratiquoit dix portes, c’eft-à-dire, autant
qu’il y avoir de tribus, Lorfque le jour étoit venu,
chaque tribu entroit par une porte particulière, &
chacun jettoit fa coquille, ou plutôt le petit morceau
de terre cuite qui portoit ce nom.
Les Archontes, dont je parlerai bientôt, 8c le
fénat, préfidoient à cette afl'emblée & comptoient
les voix. Il en falloir au moins fix mille contre un
citoyen, pour qu’il fût condamné à l’exil.
Comme on prétendoit plutôt prendre des précautions
contre l’avenir que punir des crimes
paffés, cet exil n’avoit rien de fi étrillant, 8t n’em-
portoit pas la confifcation des biens, le terme en
étcit fixé à dix ans. Mais l’Oftracifme, fage peut-
être dans fon inftitution, ne fervit fouvent qu’à fa-
vorifer l’effet des paffions & la jaloufie de la multitude.
contre les hommes de mérite qui fe fentoient
faits pour la conduire.
L’hiftoire d’Athènes en fournit plufieurs exemples
mais il n’en eft aucun plus frappant que le
trait qui a rapport à Ariflide. Ses vertus l’avoient
tellement élevé au-deffus de fes concitoyens, que
l’on craignit de le voir en effet prendre tout l’afcen-
dant que lui donnoit tant d’avantage. On s’affem-
bla donc, pour favoir s’il feroit .banni : il rencontra
parmi les gens du peuple un homme qui, ne fachant
pas écrire, le pria d’écrire pour lui le nom d’Ariflide
l'ur fa coquille.. « Mais quel mal vous a-t-il fait ?
—. ti Aucun , répond l’Athénien ;. je ne le connois
p même pas: mais je fuis fatigué de l’entendre par-
>7 tout nommer le jiifte ». Ariflide écrivit fon nom
fans rien, dire davantage. Cette condamnation fut
l’effet des manoeuvres four.des.de Thémïftocîe ? qui,..
voulant écarter un tel concurrent, parvint à rendre
fes vertus fufpeéles. Mais lui-même s’étant aveuglé
fur fes propres avantages, il effuya peu après lé
même fort.
Périclès enfuite imita la,conduite de Thémiflocle,
à l’égard de Cimon & de Thucydide ; & quoiqu’il
ait porté la puiffance & l’autorité beaucoup au-delà
de ce qu’il ieroit admifïible dans une république, il
y mit tant d’adreffe qu’il n’éprouva pas le fort de
Thémiflocle.
Le muficien Danton éprouva un fort bien différent.
C ’étoit un fophifle habile, & qui avoit la réputation
d’être très-verfé dans les affaires de la
république. Quoiqu’il ne fe fût jamais mêlé dii
gouvernement, il fut cependant mis au ban de l’O ftracifme
, fur la fimple accufation de donner des-
leçons de politique à Périclès.
Le jugement d’Hyperbolus a quelque chofe de
moins grave. C ’êtoit un homme bas Si méprifable,.
mais ambitieux & entreprenant. Les citoyens étoient
alors partagés entre Alcibiade & Nicias : on étoit
fur le point de bannir l’un ou l’autre, Hyperbolus
affeéloit de fe montrer par-tout, & de faire fentir
la néceflité de les éloigner. Leurs partifans faiftrent
cette occafion pour s’en venger. Us s’y prirent fi bien,
qu’ils le rendirent fufpeél au peuple : enfin ce fut
fur lui que tomba toute la peine. On n’en fit que
rire d’abord ; mais le peuple fut enfuite fi honteux
de cette efpèce de profanation, qu’il abolit l’Q f-
tracifme.
AJfemblées du peuple. On en compte de deux fortes.
Les unes étoient ordinaires & fixées à certains,
joûrs; d’autres étoient extraordinaires & n ’avoient
lieu qu’à l’occafion de quelque événement inattendu.
Le lieu de Faflemblêe n’êtoit pas toujours les-
même. Mais c’étoit les Prytanes, qui, pour l’ordinaire
, affembloient le peuple. Quelques jours
auparavant on affiehoit des placards où le fujet de
la délibération étoit marqué. Tous les citoyens
avoient droit de fuffrage, les pauvres comme les
riches. Il y avoit une peine contre ceux qui manquèrent
à l’affemblée ou qui y yenoient tard» Enfin,,
pour engager les citoyens à s’y rendre exactement,.
on y attachoit une rétribution ; ce fut d’abord une
obole, qui étoit la fixième partie d’une drachme,,
puis f o i s ,, qui en étoient la moitié. ,
L’affemblée commençoit toujours par des faerî-
fices & par des prières : on ne manqnoit pas d’y
joindre des imprécations terribles contre ceux qui-
confeilleroient quelque chofe de contraire au bien-
public.
Le préfident propofbit l’affaire. Si le fénat là.
connoiffoit on expofoit fon avis., puis on invitoit
ceux qui voudroient parler à monter fur la tribune
aux harangues. Lorfque les orateurs avoient parlé
& conclu, le peuple donnoit fon fuffrage. La manière
la-plus ordinaire étoit de lever les mains pour-
marque d’approbation. On rédigeoit enfuite la loi
que Fon relifoit au peuple qui , de nouveau, èleyoifc
la main s’il c.onfentoit*
Archontes. J’ai dit au commencement de cet article,
que le royaume d’Athènes avoit été fondé par
Cécrops l’an 1582. avant l’ère vulgaire. Cet état
continua à être gouverné par des'rois jufqu’à la
mort de Codrus en 109,5 ou 9a » comme K ^
M. Fréret ( nouvelles obj'erv. contre lu chronologie de
Nettor, p. 2.06) : .après lui.il n’y eut plus de roi, mais
un magiffrat que l’on nommoit Archonte, & dont
la dignité devoit durer autant que la vie. Le premier
de ces Archontes perpétuels fut Médon, fils
de Codrus. Il eut douze fucceffeurs, dont les quatre
premiers étoient fes defeendans de père en fils.
Les fix derniers fe fuccédèrent aufli de père en fils.
Alcméon, le dernier de tous,ne régna que deux ans. •
Après ce règne, la forme du gouvernement changea.
On rendit les Archontes éle&ifs ; cependant
on s’attacha à la famille de Codrus, 8c les anciens
donnent le nom de Médontides, ou defeendans de
Médon, aux Archontes électifs, ainfi qu’aux autres.
La durée de leur pouvoir fut réduite a dix ans,
après lefquels ils cédoient leur place a.un autre,
& fe trouvoient expofés au reffentiment de leurs
concitoyens auxquels ils rendoient compte de 1 u-
fage qu’ils avoient fait du pouvoir fuprême. Le
premier des Archontes décennaires fut Charops,
en 754. Il y en eut en tout fept. Eryxias, le dernier
, mourut en 687, : ;
Après ces Archontes il y eut une anarchie de
trois ans. Le terme de dix ans ayant encore paru
trop long à l’inquiétude de ceux quk eraignoient.
l’abus du pouvoir, & à l’ambition de ceux qui de-
firoient le partager, il fut arrêté, i° . que le temps
de l’archontat feroit réduit à une feule année ; 2°. .
que le pouvoir feroit partagé entre neuf Archontes
choifis indifféremment entre tous les citoyens.
De ces neuf magiftrats, le premier portoit l’épithète
Eponyme , parce qu’il donnoit fon nom à
l ’année, & que c’étoit de fon archontat que l’on dâ-
toit les a&es 8c les décrets. Le fécond Archonte
portoit Le titre de roi, parce qu’il étoit chargé de
l ’intendance de certains facrifices fondés par les
anciens rois, & dans lefquels ce titre fembloit in-
difpenfabîe. Sa femme, qui devoit être athénienne,
portoit le titre de reine,; ainfi l’on difoit de l’un
Bcttr/Àgur, de l’autre, BcL<rihetrcrci. Le troifième
Archonte avoit l’intendance des troupes 8c la place
d’honneur, ou 4’aîlè droite à la guerre.
Les fix autres Archontes fbrmoient.un tribunal
particulier ; 8c ils avoient l’adminiffration de la
juftice ordinaire, à l’exception des cas dont la con-
noiffance étoit attribuée aux trois premiers Archontes,
ou à des tribunaux particuliers.
Le premier Archonte annuel fut Créon, l’an 684
avant J. C. On en a une lifte jufqit’àla 12,1e olympiade
, dont la première année répond à l’an 2.96
avant J. C. On ne les connoît plus: au-delà de cette
époque. -
Armées. Troupes de- terre. Les Athéniens avoient
très-peu de troupes de terre ; ils n’entretenoient
ordinairement que vingt - neuf mille hommes de
pied. La cavalerie étoit bien inférieure. La fituation
du pays couvert de montagnes en étoit la caufe»
On ne comptoit, après la guerre contre les Perfes,
qui étoit le beau temps de la Grèce, que trois
cens chevaux. Cette cavalerie s’accrut dans la fuite
jufqu’à douze cens.
Les armées étoient compofées de quatre foi tes
de troupes, citoyens, alliés, mercenaires 8c efcla-
ves. On imprimoit quelquefois aux foldats une
marque fur la main pour les diftinguer : aux efcla-
v és , cette marque étoit fur le front.
Armées navales. Deux fortes de personnes fer-
voient fur les vaiffeaux. Les uns, employés à la
conduite des bâtimens, étoient le pilote & les rameurs;
les autres, deftinésà combattre, étoient
foldats 8c officiers.
On ne peut pas marquer au jufte le nombre de
ceux qui fervoient dans un vaiffeau, tant foldats
que matelots 8c rameurs ;, mais /pour l’ordinaire,
il montôit à-peu-.près, à deux cens. La paie des fol-
dats, varia depuis trois oboles jufqu’à f ix , &même
jufqu’à une drachme. Les cavaliers avoient le double
des fantaflins. L’équipement des galères étoit aux
frais d’un certain nombre de citoyens qui portoient
le titre de Triérarques. Ils commandoient aulfi ces bâtimens,
ainfi que leur nom le’défigne. Je ne dois pas
oublier de faire remarquer.que, comme cette place
engageoit à une grande dépe-nfe, il étoit permis à
ceux qui étoient nommés, d’indiquer quelqu’un qui
fût plus riche qu’eux, 8c de demander qu’on les
mît en leur place,pourvu cependant qu’ils fuffent
prêts à changer de biens, 8c à faire la fonction de
triérarque après cetéchange. Aufli cette loi s’appel-
loit-elle la loi des échanges ; elle étoit de. Solon. On
n’en exceptoit que les Archontes.
Revenus publics. Les revenus d’Athènes, modiques
d’abord, s’étoient accrus avec fa puiffance.
Ils montoient à deux mille talens, ce qui /ait environ
fix millions de nôtre monnoie. Ce revenu
avoit quatre fources principales: i°. csîui qui fe
retiroit de la culture des terres, de la vente des
bois, de l’exploitation des mines d’argent 8c d’autres
fonds appartenais au public ; 2.0. les contributions
que les Athéniens tiroient des alliés pour les
frais communs de la guerre ; fous Ariftide ces contributions
n’étoient que de quatre cens, foixante talens.
Périclès tes augmenta de près du tiers, & les
fit monter à fix cens ; 8c, peu de temps après, on
les porta jufqu’à treize cens; 30. les taxes ordinaires
& impofées par tête fur chaque habitant,
pour fubvenir à quelque befoin preflant de l’état.
Alors tant naturels qu’étrangers, tout le monde
payoit ; 40. enfin les taxes auxquelles les particu-.
lïers étoient condamnés par les juges pour différens
délits , 8c qui tournoient an profit du publie : on tes
met toit dans le tréfor, à ^exception du dixième
réfervé à Minerve, & du- cinquantième pour d’autres
divinités.,
Religion,\. Athènes étoit le centre de la religion;
grecque ; jamais peu pi# ne fut plus occupé du culte.