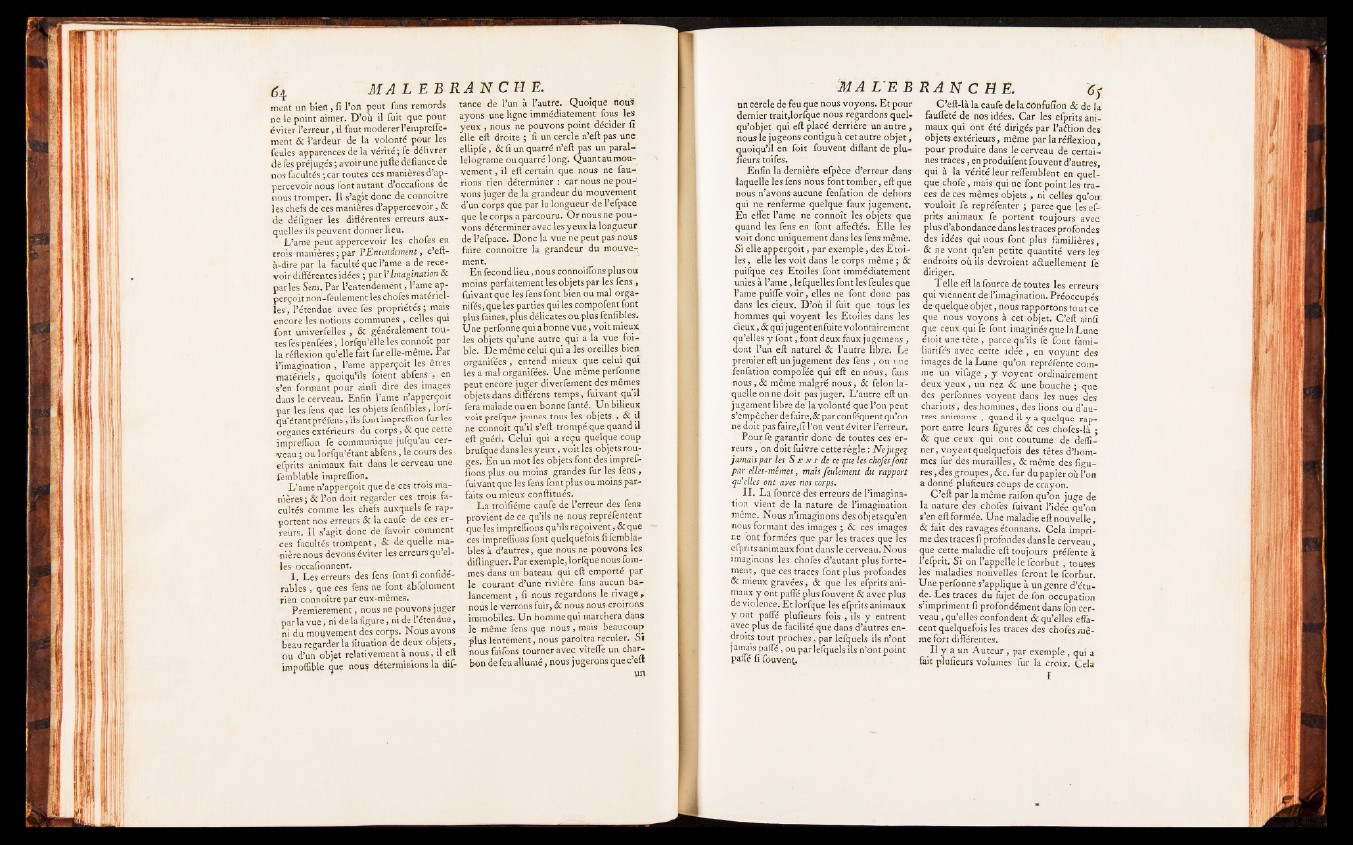
M A L E B R A N C H E .
ment un bien , fi l9on peut fans remords
ne le point aimer. D’où il fuit que pour
éviter l’erreur, il faut modérer l’emprefle-
ment & l’ardeur de la volonté pour les
feules apparences de la vérité; fe délivrer
de fes préjugés ; avoir une jufte défiance de
nos facultés ; car toutes ces manières d’ap-
percevoir nous font autant d’occafions^ de
nous tromper. Il s’agit donc de connoître
les chefs de ces manières d’appercevoir, ô c
de défigner les différentes erreurs auxquelles
ils peuvent donner lieu.
L’ame peut appercevoir les chofes en
trois manières ; par l’E n t e n d em e n t , c’eft-
à-dire par la faculté que l’ame a de recevoir
differentes idées ; par l’ Im a g in a t io n ô c
parles S e n s . Par l’entendement, l’ame apperçoit
non-feulement les chofes materielles
, l’étendue avec fes propriétés ; mais
encore les notions communes , celles qui
font universelles , Ôc généralement toutes
fespenfées, loriqu’elle les connoit par
la réflexion qu’elle fait fur elle-même. Par
l’imagination , l’ame apperçoit les êtres
matériels, quoiqu’ils foient abfens , en
s’en formant pour ainfî dire des images
dans le cerveau. Enfin l’ame n’apperçojt
par les fens que les objets fenfibles, lorf-
qu’étant préfens, ils font impreflïon fur les
organes extérieurs du corps, & que cette
impreflïon fe communique jufqu’au cerveau
; ou lorfqu’étant abfens, le cours des
efprits animaux fait dans le cerveau une
femblable impreflïon.
L’ame n’apperçoit que de ces trois manières;
ôc l’on doit regarder ces trois facultés
comme les chefs auxquels fe rapportent
nos erreurs Ôc la caufe de ces erreurs.
Il s’agit donc de favoir comment
ces facultés trompent, & de quelle manière
nous devons éviter les erreurs qu’elles
occafionnent.
I. Les erreurs des fens font fi confidé-
rables , que ces fens ne font abfplument
rien connoître par eux-mêmes.
Premièrement, nous ne pouvons juger
par la vue, ni de la figure, ni de l’étendue,
ni du mouvement des corps. Nous avons
beau regarder la fituation de deux objets,
ou d’un objet relativement à nous, il eft
impoflibie que nous déterminions la diftance
de l’un à l’autre. Quoique nous
ayons une ligne immédiatement fous les
yeux, nous ne pouvons point décider fi
elle eft droite ; fi un cercle n’eft pas une
ellipfe, ô c fi un quarré n’eft pas un paral-
lelogrameouquarré long. Quantaumou-
vement, il eft certain que nous ne fau-.
rions rien déterminer : car nous ne pouvons
juger de la grandeur du mouvement
d’un corps que par la longueur de l’efpace
que le corps a parcouru. Or nous ne pouvons
déterminer avec les yeux la longueur
de l’efpace. Donc la vue ne peut pas nous
faire connoître la grandeur du mouvement.
En fécond lieu, nous connoiflons plus ou
moins parfaitement les objets par les fens.,
fuivant que les fens font bien ou mal orga-
nifés, que les parties qui les compofentfont
plus faines, plus délicates ou plus fenfibles.
Une perfonne qui a bonne vue, voit mieux
les objets qu’une autre qui a la vue foi-
ble. De même celui qui a les oreilles bien
organifées, entend mieux que celui qui
les a mal organifées. Une même perfonne
peut encore juger diverfement des memes
objets dans différens temps, fuivant qu’il
fera malade ou en bonne fante. Un bilieux
voit prefque jaunes tous les objets , ô c il
ne connoît qu’il s’eft trompé que quand il
eft guéri. Celui qui a reçu quelque coup
brufque dans les yeux, voit les objets rouges.
En un mot les objets font des impref*
fions plus ou moins grandes fur les fens,
fuivant que les fens font plus ou moins parafai
ts ou mieux conftitués.
La troifiéme caufe de l’erreur des fens
provient de ce qu’ils ne nous repréfentent
que les impreffïons qu’ils reçoivent, Ôc que
ces impreffïons font quelquefois fi fembla«-
bles à d’autres, que nous ne pouvons les
diftinguer. Par exemple, lorfque nous fôm-
mes dans un bateau qui eft emporté par
le courant d’une rivière fans aucun balancement
, fi nous regardons le rivage,
nous le verrons fuir, ôc nous nous croirons
immobiles. Un homme qui marchera dans
le même fens que nous , mais beaucoup
plus lentement nous paroî'tra reculer. Si
nous faifons tourner avec vîteflfe un charbon
de feu allumé, nous jugerons que c’eft
UIV
MA L E B
un cercle de feu que nous voyons. Et pour
dernier trait,lorfque nous regardons quel-
qu’objet qui eft placé derrière un autre ,
nous le jugeons contigu à cet autre objet,
quoiqu’il en foit fouvent diftant de plusieurs
toifes.
Enfin la dernière efpèce d’erreur dans
laquelle les fens nous font tomber, eft que
nous n’avons aucune fenfation de dehors
qui ne renferme quelque faux jugement.
En effet l’ame ne connoît les objets que
quand les fens en font affeétés. Elle les
voit donc uniquement dans les fens même.
Si elle apperçoit, par exemple, des Etoiles
, elle les voit dans le corps même ; ô c
puifque ces Etoiles font immédiatement
unies à l’ame, lefquelles font les feules que
l’ame puiffe voir, elles ne font donc pas
dans les cieux. D’on il fuit que tous les
hommes qui voyent les Etoiles dans les
cieux, ô c qui jugentenfuite volontairement
qu’elles y font, font deux faux jugemens,
dont l’un eft naturel ô c l’autre libre. Le
premier eft un jugement des fens , ou une
fenfation compofée qui eft en nous , fans
nous, ô c même malgré nous, ô c félon laquelle
on ne doit pas juger. L’autre eft un
jugement libre de la volonté què l’on peut
s’empêcher de faire,& par conféquent qu’on
ne doit pas faire,fi l’on veut éviter l’erreur.
Pourfe garantir donc de toutes ces erreurs
, on doit fuivre cette règle : N e j u g e ç
ja tn a is p a r le s S £ n s d e c e q u e le s ch o fe s fo n t
p a r e lle s -m êm e s , m a is f e u lem e n t d u ra p p o r t
q u e l le s o n t a v e c n o s corps.
II. La fource des erreurs de l’imagination
vient de la nature de l’imagination
même. Nous n’imaginons des objetsqu’en
nous formant dés images ; ô c ces images
r.e 'ont formées que par les traces que les
efprits animaux font dans le cerveau. Nous
imaginons les chofes d’autant plus fortement,
que ces traces font plus profondes
ô c mieux gravées, & que les efprits animaux
y ont pafle plus fouvent & avec plus
de violence. Et lorfque les efprits animaux
y ont pafle plufieurs fois , ils ÿ entrent
avec plus de facilité que dans d’autres endroits
tout proches, par lefqüels ils n’ont
jamais pafle, ou par lefqüels ils n’ont point
paffe fi fouvent,
R A N C H E . '65
C’eft-là la caufe de la confufion & de la
fâuffeté de nos idées. Car les elprits animaux
qui ont été dirigés par l’aâion des
objets extérieurs, même par la réflexion,
pour produire dans le cerveau de certain
nés traces, en produifent fouvent d’autres,
qui à la vérité leur reffemblent en quelque
chofe, mais qui ne font point les traces
de ces mêmes objets , ni" celles qu’oit:
vouloit fe repréfenter ; parce que les efprits
animaux fe portent toujours avec
plus d’abondance dans les traces profondes
des idées qui nous fönt plus familières,
& ne vont qu’en petite quantité vers les
endroits où ils devroient actuellement fe
diriger.
Telle eft la fource de toutes les erreurs'
qui viennent del’imagination. Préoccupés
de quelque objet, nous rapportons tout ce
que nous voyons à cet objet. C’eft ainfi
que ceux qui fe font imaginés que la Lune
étoit une tête , parce qu’ils fe font fami-
liârifés avec cette idée, en voyant des
images de la Lune qu’on repréfènte comme
un vifage , y voyent ordinairement
deux yeux,: un nez & une bouche ; que
des perfonnes voyent dans les nues dés
chariots, des hommes, des lions ou d’autres
animaux , quand il y a quelque rapport
entre leurs figures & ces ehofes-là ;
& que ceux qui ont coutume de deïîï-
ner, voyent quelquefois des têtes d’hommes
fur des murailles, &même des figures
, des groupes, & c . fur du papier où l’on
a donné plufieurs coups de crayon.
C ’eft par la même raifon qu’on juge de
la nature des chofes fuivant l’idée qu’on
s’en eft formée. Une maladie eft nouvelle,
& fait des ravages étonnans. Çela imprime
des traces fi profondes dans le cerveau,
que cette maladie eft toujours préfente à
l’efprit. Sien l’appelle le fcorbut, toutes
les maladies nouvelles feront le fcorbut.
Une perfonne s’applique à un genre d’étude.
Les traces du fujet de fon occupation
s'impriment fi profondément dans fon cerveau
, qu’elles confondent & qu’elles effacent
quelquefois les traces des chofes même
fort différentes.
Il y a un Auteur, par exemple, qui a
fait plufieurs volumes.fur la croix. Cela
I