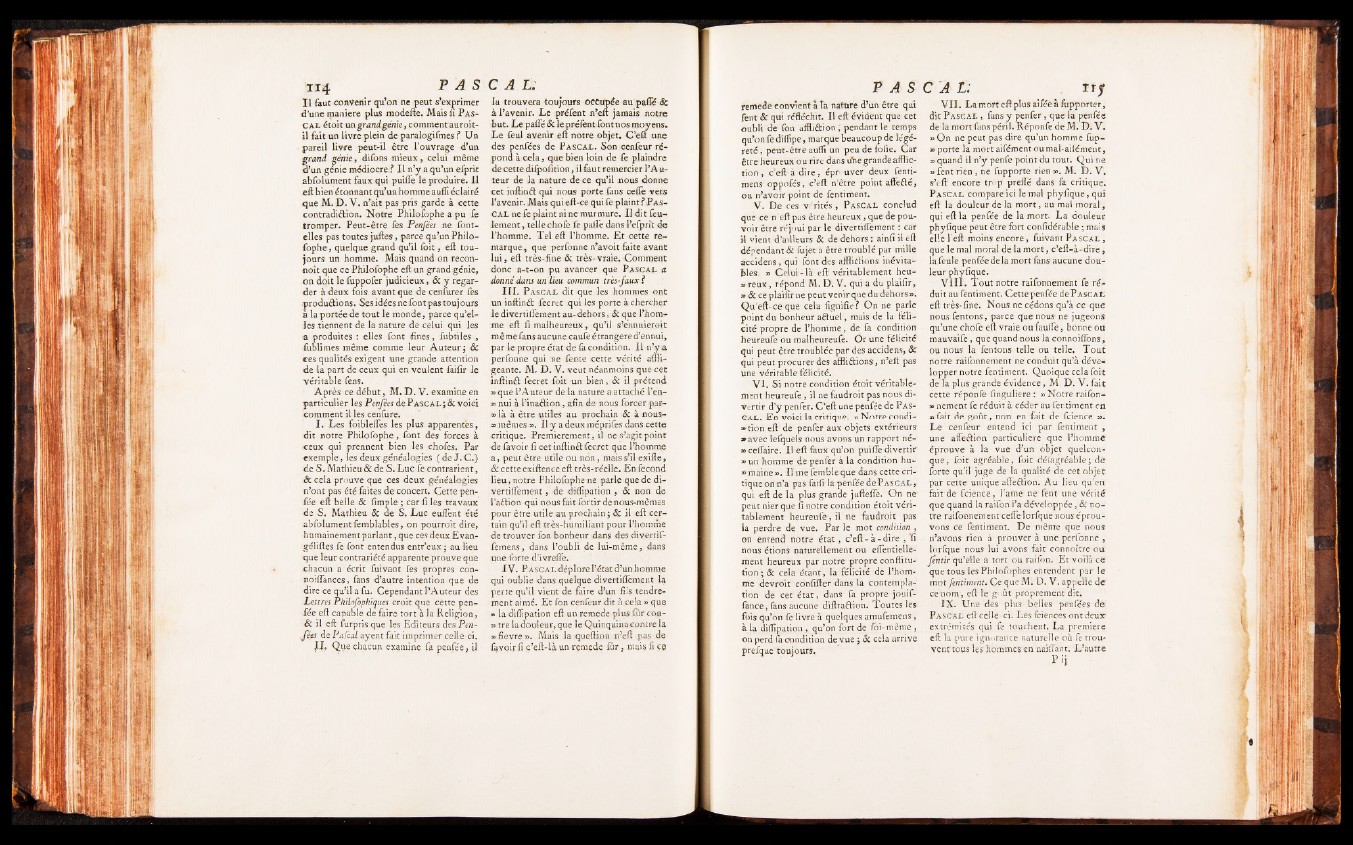
Il faut convenir qu’on ne peut s’exprimer
d’une maniéré plus modefte. Mais fi Pasc
a l étoit un grand génie, comment auroit-
il fait un livre plein de paralogifmes ? Un
pareil livre peut-il être l’ouvrage d’un
grand génie, difons mieux, celui même
d’un génie médiocre ? Il n’y a qu’un efprit
abfolument faux qui puiffe le produire. Il
eft bien étonnant qu’un homme auffiéclairé
que M. D. V. n’ait pas pris garde à cette
contradiction. Notre Philofophe a pu fe
tromper. Peut-être fes Penfées ne font-
elles pas toutes fophe, quelque jgurfatneds, qpua’ricl ef oqiut’,u ne fPt htioluojours
un homme. Mais quand on recon-
noît que ce Philofophe eft un grand génie,
on doit le fuppofer judicieux, ôc y regarder
à deux fois avant que de cenfurer lès
produébions. Ses idées ne font pas toujours
à la portée de tout le monde, parce qu’elles
tiennent de la nature de celui qui les
n produites : elles font -fines, fubtiles ,
-fublimes même comme leur Auteur; ôc ces qualités exigent une grande attention
de la part de ceux qui en veulent faifir le
véritable fens.
Après ce début, M. D. V. examine en
particulier les Penfées de Pascal ; & voici
comment il les cenfure.
I. Les foiblefles les plus apparentes,
dit notre Philofophe, font des forces à
ceexuexm pqluei, lperse dnenuexn tg ébnieéna lolegsi esc h(ô dfees J. . CPa.)r
de S. Mathieu ôc de S. Luc fe contrarient,
nôc’o cnetl ap apsr oéutév efa qituees dcee sc odnecuexr t.g énéalogies Cette penfée
eft belle ôc fimple ; car fi les travaux
de S. Mathieu Ôc de S. Luc euffent été
abfolument femblables, on pourroit dire,
humainement parlant, que ces deux Evan-
géliftes fe font entendus entr’eux ; au lieu
que leur contrariété apparente prouve que
chacun a écrit fuivant fes propres con-
noiiïances, fans d’autre intention que de
dire ce qu’il a fu. Cependant l’Auteur des
Lettres Philofophiques croit que cette pen-
fée eft capable de faire tort à la Religion,
& il eft furpris que les Editeurs desPen-
.fées de Pafcal ayent fait imprimer celle ci.
II, Q$e chacun examine fa penfée, il
la trouvera toujours occupée au palîe &
à l’avenir. Le préfent n’eft jamais notre
but. Le palfé ôc le prélèntfontnos moyens.
Le feul avenir eft notre objet. C’eft une
des penfées de Pascal. Son cenfeur répond
à cela, que bien loin de fe plaindre
de cette dilpofition, il faut remercier l’Aucteeut
rin dftei nléat nqautiu nreo udse pcoe rqteu f’ialn -sn ocuesf ièd ovnenrse
l’avenir. Mais quieft-ce qui fe plaint ? Pascal
ne fe plaint ni ne murmure. Il dit feulement
, telle choie fe pâlie dans l’efprlt de
ml’haormqumee, . qTuee lp eefrtf oln’hnoem nm’aev.o Eit tf aciteet taev arent
lui, eft très-fine ôc très-vraie.Comment
donc a-t-on pu avancer que Pascal a
donné dans un Lieu commun très-faux? III. Pascal dit que les hommes ont
un inftinét fecret qui les porte à chercher
le divertiIfement au-dehors, & que l’homme
eft fi malheureux , qu’il s’ènnuieroit
mêmefans aucune caufe étrangère d’ennui,
par le propre état de là condition. Il n’y a
perfonne qui me lente cette vérité affligeante.
M. D. V. veut néanmoins que cet
inftinét lècret foit un bien, ôc il prétend
» que l’Auteur de la nature a attaché l’en-
» nui à l’inaétion, afin de nous forcer par-
»là à être utiles au prochain <& à nous-
»cr mitiêqmuees. »P.r eIlm yi èar demeuexn mt, éipl rnifee ss ’daagnits pcoeitntet
de favoir fi cet inftinét fecret que l’homme
a, peut être utile ou non, mais s’il exifte,
ôc cette exiftence eft très-réelle. En fécond
lieu, notre Philofophe ne parle que de di-
vertiflement, de diflipation , ôc non de
l’aétion qui nous fait fortir de nous-mêmes
pour être utile au prochain ; ôc il eft certain
qu’il eft très-humiliant pour l’homme
de trouver fon bonheur dans des divertif-
femens, dans l’oubli de lui-même , dans
Une forte d’ivreflè.
IV. Pascal déplore lîétat d’un homme
qui oublie dans quelque divertifiTement la
perte qu’il vient de faire d’un fils tendre»
m lean dt iafilmipéa.t ioEnt effotn u cne rnefmeuerd dei tp làu cse fluar » c qoune-
» tre la doul eur, que le Quinquin a con tre la
»fievre». Mais la queftion n’eft pas de
f^voip fi ç’eft-là un rçmede fur, mais fi çq
remede convient à îà nature d’un être qui
fent ôc qui réfléchit. Il eft évident que cet
oubli de fon affliétion ; pendant le temps
qu’on fe diflrpe, marque beaucoup de légèreté,
peut-être auftî un peu de folie. Car
être heureux ou rire dans u'ne grande affliction
, c’eft à dire, éprouver deux fenti-
mens oppofés, c’eft n’être point affeéte,
©u n’avoir point de fentiment.
V. De ces v érités , Pascal conclud
que ce n’eft pas être heureux, que de pouvoir
être réjoui par le divertifiement : car
il vient d’ailleurs & de dehors : ainfi il eft
dépendant Ôc fujet à être troublé par mille
accidens, qui font des affliétions inévitables.
» Celui - là eft véritablement heu-
» reux, répond M. D. V. qui a du plaifir,
» & ce plaifir ne peut venir que du dehors».
Q u’eft-ce que cela lignifie? On ne parle
point du bonheur aétuel, mais de la félicité
propre de l’homme, de fa condition
heureufe ou malheureufe. Or une félicité
qui peut être troublée par des accidens, ôc
qui peut procurer des affliétions, n’elt pas
une véritable félicité.
V I . Si notre condition étoit véritablement
heureufe, il ne faudroit pas nous divertir
d’y penfer. C ’eft une penfée de Pascal.
En voici la critique. » Notre condi-
» tion eft de penfer aux objets extérieurs
»avec lefquels nous avons un rapport né-
» ceffaire. Il eft faux qu’on puiftè divertir
» un homme de penfer à la condition hu~
» maine ». Il me femble que dans cette critique
on n’a pas farfi la penfée de Pascal ,
qui eft de la plus grande jufteffe. On ne
peut nier que fi notre condition étoit véritablement
heureufe, il ne faudroit pas
la perdre de vue. Par le mot condition ,
on entend notre é ta t , c’eft - à - dire , fi
nous étions naturellement ou elfentielle-
ment heureux par notre propre conftitu-
tion ; ôc cela étant, la félicité de l’homme
devroit confifter dans la contemplation
de cet état, dans fa propre jouif-
fance, fans aucune diftraétion. Toutes les
fois qu’on fe livre à quelques amufemens,
à la diflipation, qu’on fort de foi-même ,
on perd fa condition de vue ; & cela arrive
prefque toujours.
VII. La mort eft plus aifée à fupporter,
dit Pascal , fans y penfer, que la penfée
de la mort fans péril. Réponfe de M. D. V.
» On ne peut pas dire qu’un homme fup-
» porte la mort aifémentoumal-ailément,
» quand il n’y penfe point du tout. Qui ne
» fent rien , ne fupporte rien ». M. D. V.
s’eft encore trop prefle dans fa critique.
Pascal compare ici le mal phyfique, qui
eft la douleur de la mort, au mal moral,
qui eft la penfée de la mort. La douleur
phyfique peut être fort confidérable ; mais
elle l eft moins encore, fuivant Pa scal, que le mal moral de la mort, c’eft-à-dire,
laXeule penfée de la mort fans aucune douleur
phyfique.
V III. Tout notre raifonnement fe réduit
au fentiment. Cette penfée dePASCAE
eft très-fine. Nous ne cédons qu’à ce que
nous fentons, parce que nous ne jugeons
qu’une chofe eft vraie ou faufie, bonne ou
mauvaife, que quand nous la connoifïbns,
ou nous la fentons telle ou telle. Tout
notre raifonnement ne conduit qu’à développer
notre fentiment. Quoique cela foit
de la plus grande évidence, M. D. V. fait
cette réponfe finguliere: »Notre raifon-
» nement fe réduit à céder au fentiment en
» fait de goût, non en fait de fcience ».
Le cenfeur entend ici par fentiment ,
éupnreo uavlfee éàti olna pvaureti cdu’luiènr eo bqjueet lq’huoelnciomné
que, foit agréable, foit déïagréable; dé
forte qu’il juge de la qualité de cet objet
par cette unique affeétion. Au lieu qu’ent
fait de fcience, l’ame ne-fent une vérité
que quand la raifon l’a développée, ôc novtroen
rsa icfeo nfneenmtimenetn cte. fîeD leo rfmquême neo qusu eé pnroouus
n’avons rien à prouver à une perfonne ,
lorfque nous lui avons* fait connoître ou
Jentir qu’elle a tort ou raifon. Et voilà cé
que tous les Philofophes entendent par le
mot fentiment. Ce que M. D. V. appelle de
cenom, eft le goût proprement dit.
IX. Une des plus belles penfées de
Pascal eft celle-ci. Les fcierrces ont deux1
extrémités qui fe touchent. La première
eft la pure ignorance naturelle où fe trouvent
tous les-hommes en naifïant. L’autre
p ü