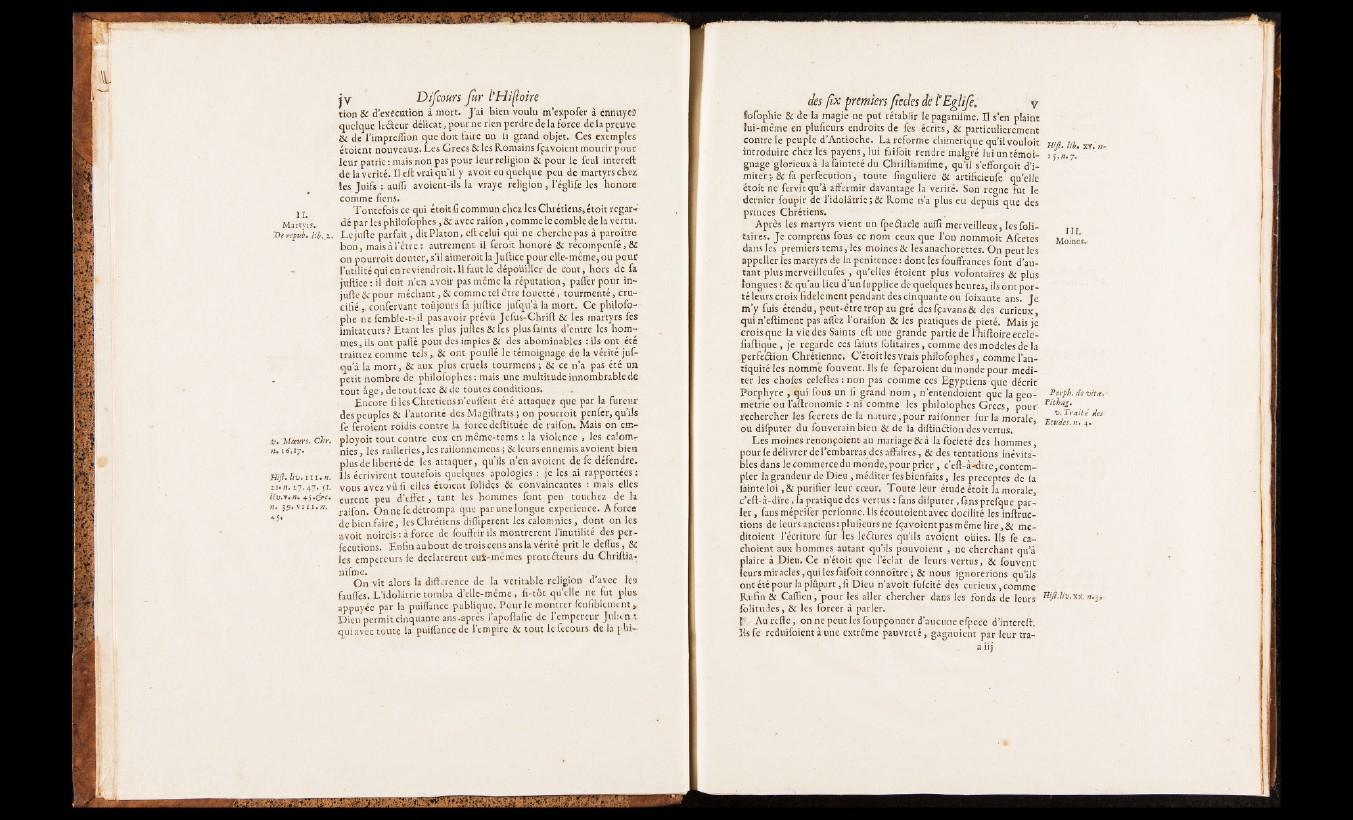
tion 8c d’execution à mort. J ’ai bien voulu m’expofer à ennuyé?
quelque ledeur délicat, pour ne rien perdre de la force delà preuve
& de l’impreffion que dott faire un li grand objet. Ces exemples
étoient nouveaux. Les Grecs 8c les Romains fpavoient mourir pour
leur patrie : mais non pas pour leur religion 8c pour le feul intereft
de la vérité. Il eft vrai qu’il y avoit eu quelque peu de martyrs chez
les Juifs : auiîi avoient-ils la vraye religion , 1’églife les honore
comme fiens.
Toutefois ce qui étoit fi commun chez les Chrétiens,étoit regar-è
dé par les philofophes, 8c avec raifon, comme le comble de la vertu,
lib.z. Lejuile parfait, dit Platon, eft celui qui ne cherchepas à paroître
b on, maisàl’être: autrement il feroit honoré 8c récompenfé, 8c
on pourroit douter, s’il aimeroit la Juftice pour elle-même, ou pour
l’utilité qui en reviendroit.il faut le dépouiller de tou t, hors de fa
juftice : 11 doit n’en avoir pas même la réputation, paffer pour in-
jufte 8c pour méchant, 8c comme tel être fouetté, tourmenté, crucifié
, confervant toûjours fa juftice jufqü’à la mort. Ce philofo-
phe ne fembie-t-il pas avoir prévu Jefus-Chrift 8c les martyrs fes
imitateurs ? Etant les plus juftes 8c les plus faints d’entre les hom-
xrres, ils ont paifé pour des impies 8c des abominables : ils ont été
traittez comme tels.,. 8c ont pouffé le témoignage de la vérité juf-
qu’à la mort, 8c aux plus cruels tourmens ; 8c ce n'a pas été un
petit nombre de philofophes: mais une multitude innombrable de
tout â g e , de tout lexe 8c de toutes conditions.
Encore fi les Chrétiens n’euffent été attaquez que par la fureur
des peuples 8c l’autorité des Magiftrats; on pourroit penfer, qu’ils
fe feroient roidis contre la force deftituée de raifon. Mais on em-
cÆr. ployoit tou t contre eux en même-tems :1a violence , les calomnies
5 l es railleries, les raifonnemens ; 8c leurs ennemis avoient bien
plus de liberté de les attaquer, qu’ils n’en avoient de fe défendre,
i.». Ils écrivirent toutefois quelques apologies : je les ai rapportées:
|. j.i vous avez vû fi elles étoient folides 8c convaincantes : mais elles
& c . eutent peu d’e ffe t, tant les hommes font peu touchez de la
■ raifon. Onnefedétrompa que parunelongue experience. A force
d e b i e n - f a i r e , les Chrétiens difliperent les calomnies j dont on les
avoit noircis : à force de fouffrir ils montrèrent l’inutilité des per-
fecutions. Enfin au bout de trois cens ans la vérité prit le deffus, &
les empereurs le declarerent eut-mêmes protc&eurs du Chriftia»
aifme.
On vit alors la différence de la véritable religion d avec les
f a u f f e s . L ’idolâtrie tomba d’elle-même, fi-tôt qu’elle ne fut plus
appuyée par la puiffance publique. Pour le montrer fenfiblement,
D i e u permit cinquante ans .après l’apoftafie de l’empereur Ju lien i
qui avec toute la puiffance de l’empire 8c tout le fecours. de la phi-
(ofophie 8c de la magie ne puf rétablir lepaganilme. II s’en plaint
lui-même en plufieurs endroits de fes écrits, 8c particulièrement
Contre le peuple d’Antioche. La reforme chimérique qu’il vouloit
introduire chez les payens,lui faifoit rendre malgré lui un témoignage
glorieux à lafaintetédu Chriftianifme, qu’il s’efforçoit d'imiter;
& fa perfecution, toute finguliere 8c artificieufc quelle
étoit ne'fervit qu’à affermit davantage la vérité. Son regne fut le
dernier foupir de l’idolâtrie ; 8c Rome n’a plus eu depuis que des
princes Chrétiens.
Après les martyrs vient un fpeâacle auffr merveilleux, Iesfoli-
taires. Je comprens fous ce nom ceux que l’on nommoit Afcetes
dans les premiers tems,des moines 8c les anachorettes. On peut les
appeller les martyrs de la penitence : dont les fouffrances font d’autant
plus merveilleufes , qu’elles étoient plus volontaires 8c plus
longues : 8c qu’au lieu d’unluppiiee dequelques heures, ils ont porté
leurs croix fidelement pendant des cinquante ou foixante ans. Je
m’y fuis étendu, peut-être trop au gré des fça vans & des curieux,
qui n’eftiment pas affez l'oraifon 8c les pratiques de pieté. Mais je
crois que la vie des Saints eft une grande partie de l'hiftoire eccle-
fiaftique, je regarde ces faints folitaires, comme des modèles de la
perfeâion Chrétienne. C ’étoit les vrais philofophes, comme l’antiquité
les nomme fouvent. Ils fe feparoient du monde pour méditer
les chofes celeftes : non pas comme ces Egyptiens que décrit’
Porphyre , qui fous un fi grand n om, n ’entendoient que la geo-
metrie ou l’aftronomie : ni comme les philoiophes Grecs, pour
réchercher les fecrets de là nature, pour railonner fur la morale
ou difputer du fouverain bien 8c de la diftinétiondes vertus.
Les moinesrenonçoient au mariage8cà lafocieté des hommes,
pour ie délivrer de l’embarras des affaires., 8c des tentations inévitables
dans le commerce du monde, pour prier , c’eft-à-dire, contempler
la grandeur de D ieu , méditer fes bienfaits, les préceptes de (a
Jàinteloi ,8c purifier leur coeur. Toute leur étude étoit la morale,
c’eft-à-dire, la pratique des vertus : fans difputer ,fansprefque parler
, fans méprifer perfonne. Ils écoutoient avec docilité les inftruc-
tions de leurs anciens: plufieurs ne fçavoientpasmêmelire, 8c me-
ditoient l ’écriture lûr les leâures qu’ils avoient oüies. Ils fe ca-
choient aux hommes autant qu’ils pouvoient , ne cherchant qu’à
plaire à Dieu. Ce n’étoit que l’éclat de leurs vertus, 8c fouvent
leurs miracles,qui les faifoit connoître; 8c nous ignorerions qu’ils
ont été pour la plupart, fi Dieu n’avoit fufeité des curieux, comme
Rufin 8c Caflien, pour les aller chercher dans les- fonds de leurs
folitudes, 8c les forcer à parler.
£• Aurefte, on ne peut les foupçonner d’aucune efpece d’intereft;
Iisfe reduifoient à une extrême pauvreté, gagnoient par leurtraa
iij
Hift. lib . XV. ?...
i J.»./.
I II.
Moines*-
Porph. de vit#a-
Pithag.
V. Traité des-
Etudes, n* 4»
Hifi.liv. xx,