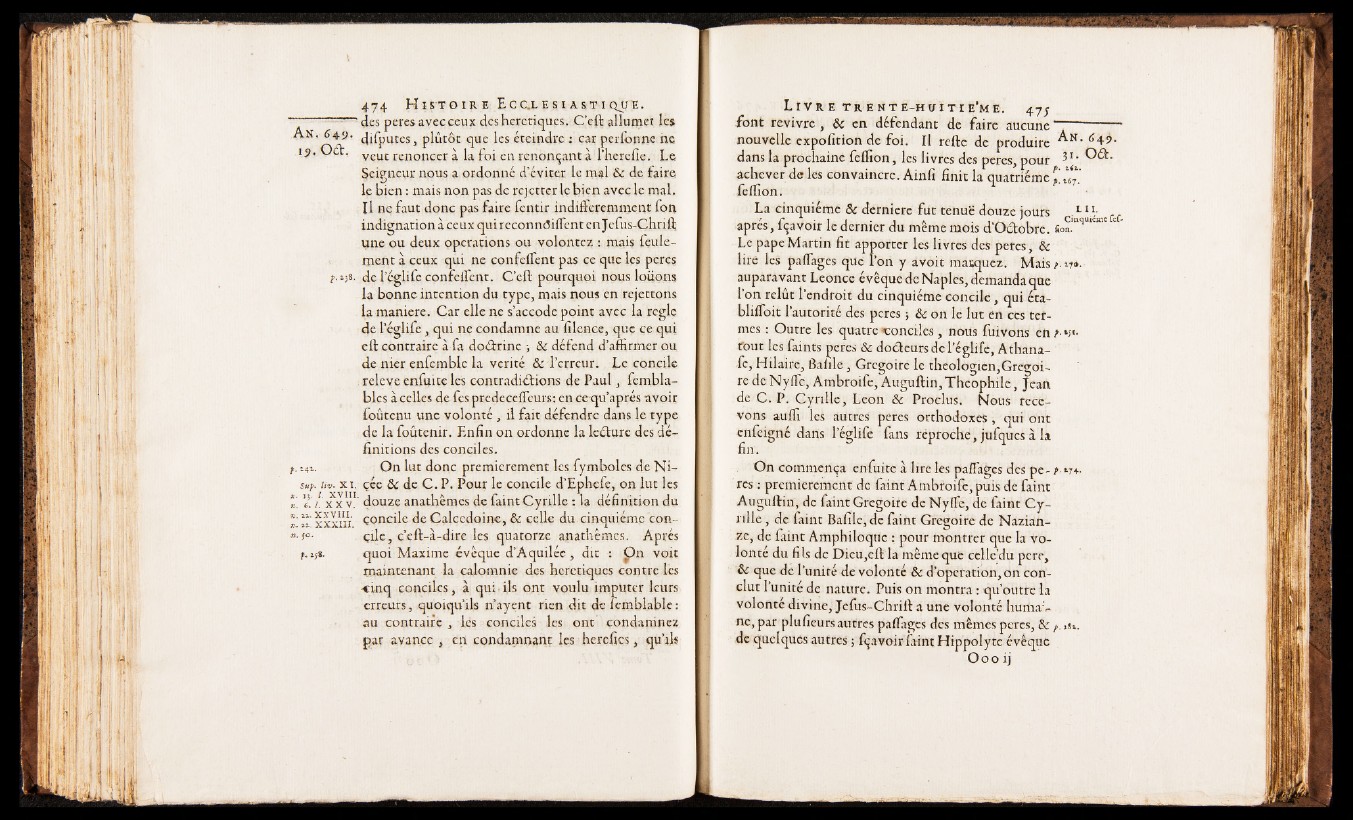
A n . 649.
15, Odt,
f . i ; 8 .
t • 141-
Sup. /¿v. X I.
je. 13. X VIII
». 6. /. X X V.
n. i l . X X VIII.
* . i l . X X X I II .
n. 50.
f.iji.
4 7 4 H i s t o i r e E c c j t E s i A s T i Q t i E .
des peres avec ceux desherctiquçs. C ’eft allumer les
difputcs, plûtôt que les éteindre : car perfionne he
veuc renoncer à la lo i en renonçant à Thcrefie. Le
Seigneur nous a ordonné d’éviter le mal & de faire
le bien : mais non pas de rejetterlebien avec le mal.
Il ne faut donc pas faire fentir indifféremment fon
indignation a ceux quireconnôiffcnt en Jcfus-Chrift
une ou deux opérations ou volonte z : mais feulement
à ceux qui ne confefTent pas ce que les peres
de 1 eglife confefTent. C ’eft pourquoi nous louons
la bonne intention du type, mais nous en rejettons
la maniéré. C a r elle ne s’accode point avec la reglç
de le g l i f e , qui ne condamne au filence, que ce qui
eft contraire à fa doéïrine -, 6c défend d'affirmer ou
de nier enfemble la vérité & l’erreur. Le concile
releve enfuitc les contradictions de Paul , fembla-
bles à celles de fes predeccffcurs: en ce-qu’apres avoir
foûtenu une volonté , il fait défendre dans le type
de la foutenir. Enfin on ordonne la leékurc des définitions
des conciles.
O n lut donc premièrement les fymbolcs de N i-
çée 6c de C . P. Pour le concile d’Ephefe, on lut les
douze anathêmes de faint C y r ille : la définition du
çoncile de Calcédoine , & celle du cinquième conc
ile , ceft-à -d ire les quatorze anathêmes. Après
quoi Maxime évêque d’A q u i lé c , dit : O n vo it
maintenant la calomnie des hcrctiques contre les
-cinq conciles , à qui ils ont voulu imputer leurs
erreurs, quoiqu’ils n’ayent rien dit de femblable:
au contraire , lés conciles les ont condamnez
par avance , en condamnant les herefies, qu’ils
L i v r e t r e n t e -h t i i t i e ’m e . 4 7 ;
fo n t revivre , 6c en défendant de faire aucune -------------
nouvelle expofition de fo i. Il refte de produire É ï l r
dans la prochaine fe ffion , les livres des peres, pour 31 :
achever dff les convaincre. Ainfi finit la quatrième ! ^
feffion. •
La cinquième & dérniere fut tenue douze jours .L*i
après, fçavoir le dernier du même mois d’O ctobre. fion.'n<!Ulcmc c
Le pape M artin fit apporter les livres des peres , 6c
lire les paffages que Ton y a voit masquez. Mais?. *7*.
auparavant Leonce évêque de Naplés, demanda que
Ton relût l ’endroit du cinquième co n c ile , qui éta-
bliifoit l ’autorité des peres ; & on le lut en ces termes
: Outre les quatre «conciles , nous fuivons en t- m-
fout les faints peres 6c d od eu r sd e l’églife, Athâna-
fc, Hilaire, B a ille , Grégoire le théologien,Grégoire
de Nyffe, Ambroife, A u gu ftin ,T h é o p h ile , Jean
de C . P. C y r ille , Léon 6c Produs. Nous recevons
auffi les autres peres o rth o d o x e s , qui ont
enfeigné dans Téglife fans réproche, jufques à la
fin.
On commença en fuite à lire les paffages des p e - 1• *74.
res : premièrement de faint Ambroife, puis de faint
Auguftin, de faint Grégoire de N y ffe, de faint C y rille
, de faint Baille, de faint Grégoire de N a z ian-
ze, de faint Amphiloque : pour montrer que la v o lonté
du fi ls de Dieu,eft la même que celle’du pere,
6c que de l ’unité de volonté & d’opération, on conclut
l’unité de nature. Puis on montra : qu’outre la
volonté divine, Jefus-Chrift a une volonté humaine,
par plufieurs autres paffages des mêmes peres, & ¡,. »»».
de quelques autres ; fçavoir faint Hippolyte évêque
O o o ij