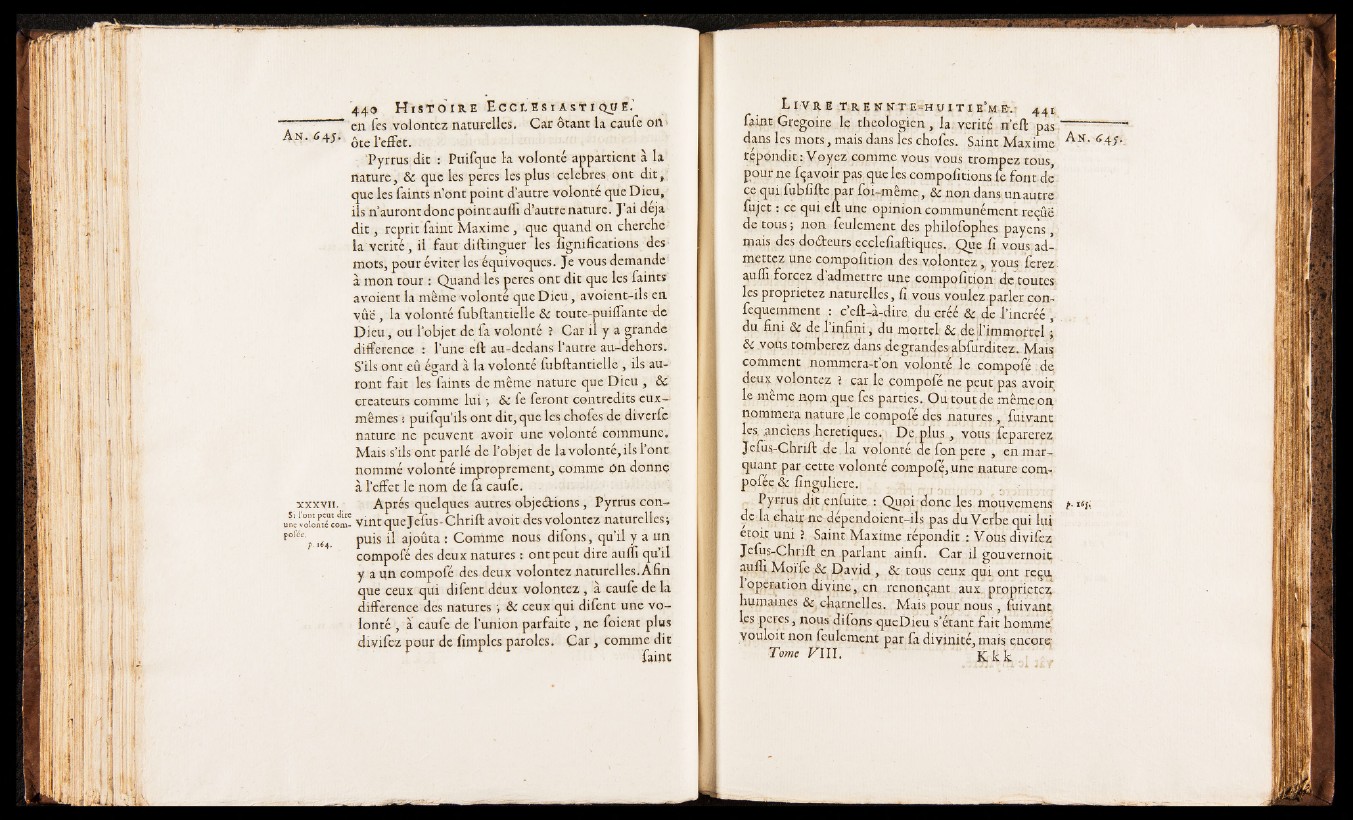
4 4 » H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .’
en fes volon te z naturelles. Car ôtant la caufe on >
ôte l’effet.
'Pyrrus dit : Puifque la volonté appartient à la
nature, & que les peres les plus célébrés ont d i t |
que les faints n’ont point d’autre volonté que Dieu,
ils n’auront donc point auffi d’autre nature. J’ai deja
d i t , reprit faint M a x im e , que quand on cherche
la vérité , il faut diftinguer les lignifications des
mots, pour éviter les équivoques. Je vous demande
à mon tour : Quand les peres ont dit que les faints
avoient la même volonté que D ieu , avoient-ils en
vue , la volonté fubftantielle & toute-puiffante-dc
D ie u , ou l’objet de fa volonté ? Car il y a grande
différence : l ’une eft au-dedans l ’autre au-dehors.
S’ils ont eû égard à la volonté fu b ftantie lle , ils auront
fait les faints de même nature que Dieu , &
créateurs comme lui ; & fe feront contredits e u x -
mêmes : puifqu’ils ont dit, que les chofes de diverfe
nature ne peuvent avoir une volonté commune.
Mais s’ils ont parlé de l ’objet de la volonté , ils 1 ont
nommé volonté improprement, comme Qn donne
à l’effet le nom de fa caufe.
Après quelques autres ob je ctions, Pyrrus con -
! vin tqueJe fus-Chrift avoir des volon te z naturelles;
puis il ajouta : Comme nous difons, qu’il y a un
compofé des deux natures : ont peut dire auffi qu’il
y a un compofé des deux volon te z naturelles. A fin
que ceux qui difent deux vo lon te z , à caufe de la
différence des natures ; & ceux qui difent une v o lonté
, à caufe de l’union parfaite , ne foient plus
d iv ife z pour de fimples paroles. Car , comme dit
L I V R E T R E N N T E=H U I T I E’M E v 441,
faint Grégoire le th é o lo g ien , la.veritp n’eft p a s -------
dans les mots, mais dans les chofes. Saint Maxime
répondit: V o y e z comme vous vous trompez tous,
pour ne fçavoir pas que les compofitions le fo n t de
ce quiifubfifte par foi-même., & non dans unautre
fiijet : ce qui eft une opinion communément repûe
de tous ; non feulement des philofophes pa yens,
mais des docteurs ecclefîaftiques., Que fi vous admettez
une compofition des v o lo n te z , vous ferez
auffi forcez d admettre une compofition de toutes
les proprietez naturelles, fi vous voulez.parler con-
fe.quemment : c’eftTà-dire du créé & de l ’incréé ,
du fini & de 1 in f in i, du mortel & de l'immortel ;
& vous tomberez dans de grandes abfurditcz. Mais
comment nommera-t on volonté Je compofé : de,
deux volontez ? car le compofé ne peut pas avoir
le me me nom,que fes parties. Ou tout de même on
nommera nature ,1e compofé des natures , fuivant
les. anciens hérétiques. D c ’plus., vous feparerez
Jcfus-Chrift de, la volonté de fon pere , en mar-:
quant par cette volonté compofé, .une nature com-
pofée & finguliere.
r Q uo i donc les mouvemens tdeja,
chaiync'dépendoient-ils pas du Verbe qui lui
etoit uni ? Saint Maxime répondit : Vous divifez
Jcfus-Chrift en parlant ainfi. Car il gouvernoit,
auifi. Moife & Da vid , & tous ceux qui ont repu
1 opération d iv in e ,, en renonçant aux. proprietez
humaines charnelles. Mais pour, n o u s , fuivant,
les pères, nous difons queDieu s’étant fait homme,
youloit non feulement par fa divinité, mais encore;
Tome V l l l , - J£kk ,