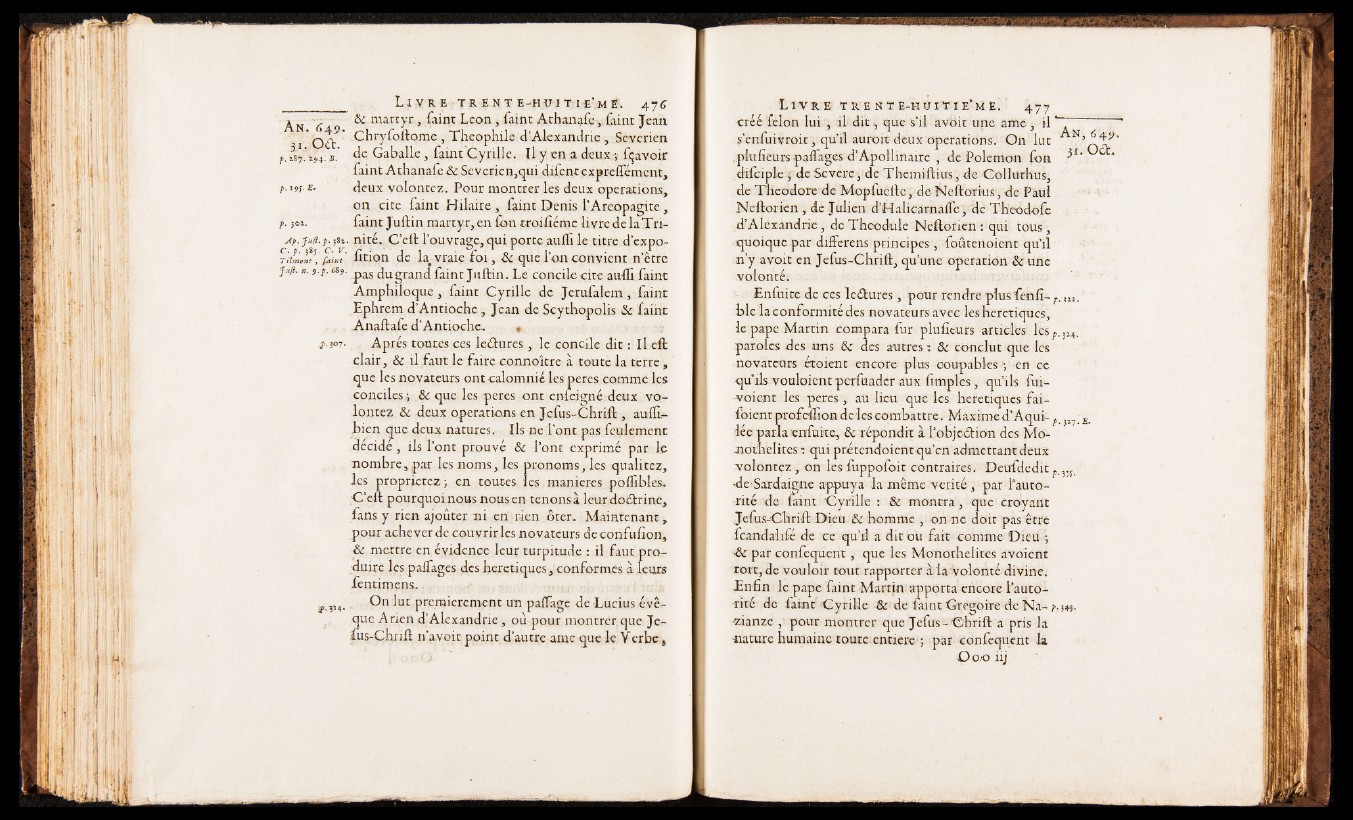
A n . ¿45».
31. Odt.
Ïÿ4- S.
f . »<>;. E .
p. 301.
Ap. Jufi. p. 38»
c . p. 383. C. V.
Tilmont , faint
fafi- n. 9. p. ¿8?.
4».f©7-
L I V I E T R E N T E-HCI T I e ’ m Ê. 4 7 S
Sc m a r ty r , faint L é o n , faint A th an a fe ,, faint Jean
C h r y fo f tom e , Théophile d'Alexandrie , Severien
de G a b a lle , faint C y r ille . Il y en a deux -, fçavoir
faint A thanafe Sc Severien,qui difent expreifément,
deux vo lon te z. Pour montrer les deux opérations,
on cite faint H ila ir e , faint Denis l’Areop ag ite ,
faint Juftin martyr, en ion troihéme livre de la T r inité.
C ’eft l ’ouvrage, qui porte aufh le titre d’expo-
lîtion de ha vraie f o i , ■& que l’o n convient n’être
pas du grand faint Juftin. Le concile cite aufh faint
Am p h ilo q u e , faint C y r ille de Jerufalem, faint
Ephrem d’A n t io ch e , Jean de Scythopolis & faint
Anaftafe d’Antioche. *
Après tontes ces leétures, le concile dit : Il eft
c la ir , & il faut le faire connoître à toute la terre,
que les novateurs ont calomnié les peres comme les
conciles ; & que les peres on t enfeighé deux v o -
lon te z Sc deux opérations en J e fu s -C h r ift, aufti-
bien que deux natures. Ils ne l’ont pas feulement
d é c id é , ils l ’ont prouvé & l ’ont exprimé par le
n om b re , par les n oms, les pronoms, les qualité?,
les proprietez ; en toutes les manières poffibles.
C ’eft pourquoi nous nous en tenons à leur doétrine,
fans y rien ajoûter n i en rien ôter. M ain ten ant,
pour achever de couvrir les novateurs deconfufion,
Sc mettre en évidence leur turpitude : il faut produire
les palfages des hcretiques, conformes à leurs
fen tim en s ..
On lut premièrement un paifage de Lucius évêque
Arien d’A lex an d r ie , où pour montrer que Je-
ius-Chrift n’avoit point d’autre amc que le V e r b e ,
L i v r e t r e n t e -h u i t i e ’ m e . 4 7 7
créé félon lui , il dit a, que s’il avoit une ame , il
s’en fu iv ro it, qu’il auroit deux opérations. O n lut
phtheurs palfages d’Apollinaire , de Polemon fon
d ifc ip le , de Severe, de T hcmiftius , de Colluthus,
de Tlieodore de M op fuc ftc , de Neftorius’, de Paul
Neftorien , de Julien d’Halicârnaife, de Theodofe
d’A le x an d r ie , de Theodule Neftorien : qui to u s ,
quoique par differens principes, foûtenoient qu’il
n ’y avoit en Jefus-Chrift, qu’une opération Sc une
volonté.
Enfuite de ces le c tu re s , pour rendre plus f e n f i - ,
fcle la conformité des novateurs avec les hérétiques,
le pape Martin compara fur plufiturs articles les^
paroles des uns & des autres : Sc conclut que les
novateurs croient encore plus coupables -y en ce
qu’ ils voulo ien t perfuader aux fimples , qu’ils fui-
v o ien t les p e re s , au lieu que les hcretiques fa i-
fo ientprofcîfion deles combattre. Maximed’A q u i- .
léc parla enfuite, & répondit à l ’objcéHon des Mo-
nothelitcs : qui prétendoient q u ’en admettant deux
v o lo n te z , on les fuppofoit contraires. Deufdcdit t
d e Sardaigne appuya la même vérité , par l’ autorité
d e-fain t C y r ille : Sc m o n tra , que croyant
Jefus-Chrift D ieu & homme , on ne doit pas être
feandalifé de ce qu’il a dit ou fait comme Dieu -,
Sc par co n feq u cn t, que les Monorhelites avoient
tor t, de vouloir tout rapporter à la vo lon té divine.
E n fin le pape faint Martin apporta encore l’autor
ité de faint C y r ille Sc de faint Grégoire de N a - t
•zianze ,î pour montrer que J e fu s -C h r ift a pris la
nature humaine toute entière ; par confequcnt la
-Qo.o iij
A n , 645».
31. O c t,
’•ni-
■ w