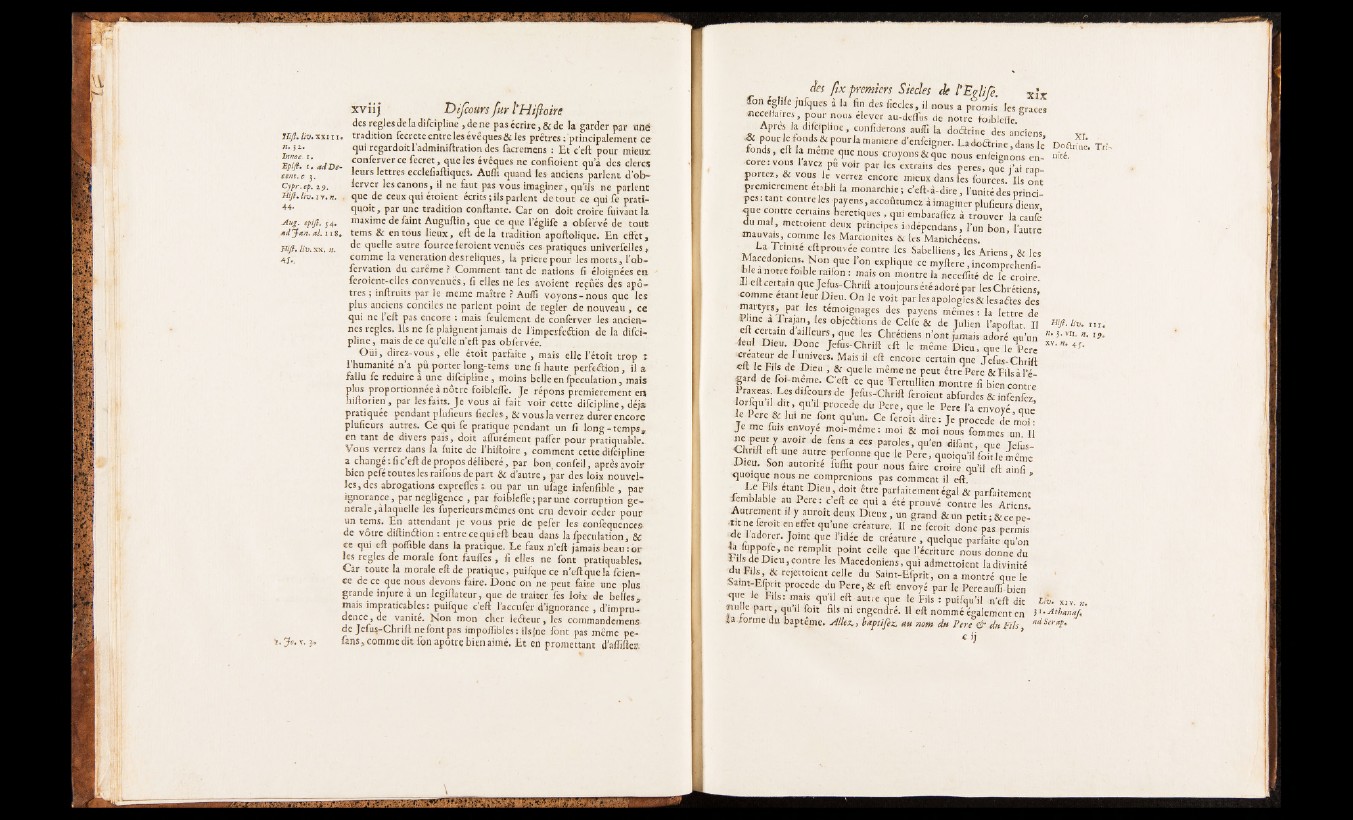
11
H § j j |
HP’ n
«mWe§aA mil üîPI
1
üI
f g j
'fe r '
Usa S.
fia? ¡1
lhjl. liVt xxi 11.
n. j i .
J»»0i. i.
EpiJÎ. i . ad Decent.
c j.
Cypr.ep. z$.
Hift• /ù>. i y, »,
44-
epijl. 54.
*</jfa». <*/. n i ,
Jîifi, liv, xx. ».
H
ï . J o . T. >
x vi i j Dijcours fur l'Hijloire
des réglés de la difeipline , de ne pas écrire, & de la garder par utïé
, tradition fecrete entre les évêques & les prêtres : principalement ce
qui regardoit l’adminiftration des facremens : E t c’eft pour mieux,
conferverce fecret, que les évêques ne confioient qua des clercs
leurs lettres eccleiiaftiques. Auffi quand les anciens parlent d'ob-
lerver les canons, il ne faut pas vous imaginer, qu’ils ne parlent
. que de ceux qui étolent écrits ; ils parlent de tout ce qui fe prati-
q uoit, par une tradition confiante. Car on doit croire fuivant la
maxime de faint Auguftin, que ce que l’églife a obfervé de tout
tems & en tous lieu x , eft d elà tradition apaftolique. En effet,
de quelle autre fource leroient venues ces pratiques unlverfelles,
comme la vénération desreliques, la prierepour les morts, l’ob-
fervation du carême ? Comment tant de nations fi éloignées en
feroient-elles convenues, fi elles ne les avoient reçues des apô-;
très ; inftruits par le meme martre ? Auffi voyons-nous que les
plus anciens conciles ne parlent point de regler de nouveau , ce
qui ne 1 eft pas encore ; mais feulement de conlèrver les ancien*
nés réglés. Ils ne fe plaignent jamais de limperfeâion de la difei-
pline, mais de ce qu’elle n’eft pas obfervée.
O u i, direz-vous, elle etoit parfaite , mais elle l’étoit trop t
l ’humanité n’a pû porter long-tems une fi haute pe rfeâ ion, il a
fallu fe réduire à une difeipline, moins belle en fpeculation, mais
plus proportionnée à nôtre foibleffe. Je répons premièrement en
hiftorien, par les faits. Je vous ai fait voir cette difeipline, déjà
pratiquée pendant plufieurs iiecles, & vous la verrez durer encore
plufieurs autres. Ce qui fè pratique pendant un fi lon g - tem p s ,
en tant de divers pais, doit affurément paffer pour pratiquable.
Vous verrez dans la faite de l’hiftoire , comment cette difeipline
a change tfi c eft de propos délibéré, par bon conicil, après avoir
bien pefé toutesles raifons de part & d’autre, par des loix nouvelle
s, des abrogations exprefles t ou par un ufage infenfible , par
ignorance, par négligence , par foibleffe; par une corruption g e ,
nerale,àlaquelle les fuperieursmêmes ont cru devoir ceder pour
un tems. En attendant je vous prie de pefer les confequences
de vôtre diftinilion : entre ce qui e ft beau dans la fpeculation, &
ce qui eft poflible dans la pratique. Le faux n’eft jamais beau : or
les réglés de morale font fauffes , fi elles ne font pratiquables.
Car toute la morale eft de pratique, puifquece n’eft que la feien-
ce de ce que nous devons faire. Donc on ne peut faite une plus
grande injure à un legiflateur, que de traiter fes loix de belles,,
mais impraticables: puifque c’eft l ’accufer d’ignorance , d’imprudence,
de vanité. Non mon cher leéteur, les commandemens
de Jefus.-Chrift ne font pas impoffibles: ils [ne font pas même pe-
fanscomme dit fon apotrç bien aimé. E t en promettant d’affifteffi.
ffoa églife julques à la fin des fiedes, il nous a promis' fes eraces
aieceilaires, pour nous elever au-deffus de notre foibleffe.
Apres la difeipline, confinerons auffi la do&rine des anciens, y ,
fond«*"1 ÎH°n s* Pourlaman>erc d’enfeigner. La doftrine, dans le f i f e
fonds, eft la meme que nous croyons & que nous enfeignons en- »'d.
<ore: vous lavez pu voir par les extraits des peres, que j’ai rapportez,
& vous le verrez encore mieux dans les fources. Ils ont
premièrement établi la monarchie; c’eft-à-dire, l’unité des principes
: tant contre les payens, accoûtumez àimaginer plufieurs dieux
q u e contre certains heretiques , qui embaraffez à trouver îa eaufe
du mal, mettoient deux principes indépendans, l ’un bon, l ’autre
mauvais, comme les Marcionites & les Manichéens.
La Trinité eftprouvée contre les Sabelliens, les Ariens, & les
Macédoniens. Non que 1 on explique ce myftere,incomprehenfi-
b e a notre foible raifon : mais on montre la neceffité de le croire,
a eftcertain que Jefus-Chrift a toujours été adoré par les Chrétiens!
■comme étant leur D ieu. On le voit par les apologies êclesades des
martyrs, par les témoignages des payens mêmes : la lettre de
I fine a Trajan, les objerâions de Ce lfe & de Julien l’apoftat. Il mfl- *»• r
eit certain d ailleurs, que les Chrétiens n’ont jamais adoré qu’un s i S f “ »®
, Die"- P onc Jetas-Chrift eft le même Dieu , que le Pere "* 4 i‘
»ff j univers. Mais il eft encore certain que Jefus-Chrift
«lt le Fils de Dieu , & que le même ne peut être Pere & Fils à l’égard
de foi-meme. C ’eft ce que Tertullien montre fi bien contre
Praxeas Les difeoursde Jefus-Chrift feroient abfurdes & infenfez
e Î “ S ? « ! qU r Pr° Cede du P£r, e ’ ^UC le Pere 1 envoyé, que
cre & lui ne font qu un. Ce feroit dire : Je procédé de moi •
Je me fuis envoyé moi-même: moi & moi nous fommes un II
ne peut y .avoir de fens à ces paroles, qu’en difant, que Jefus-
D i T f f i Une amr? Petfo«ne que le Pere, quoiqu'il foitle même
Dieu. Son autorité fuffit pour nous faire croire qu’il eft ainfi
quoique nous ne comprenions pas comment il eft. S
r V j F f s f e Dieu.’ ^oit étre parfaitement égal & parfaitement
lemblable au Pere: c eft ce qui a ete prouvé contre les Ariens.
Autrement il y auroit deux D ieu x , un grand & un petit ; & ce petit
ne feroit en effet qu’une créature. Il ne feroit donc pas permis
de 1
adorer. Joint que l’idée de créature, quelque parfaite qu’on
la iuppofe, ne remplit point celle que l’écriture nous donne du
frils de D ieu,contre les Macédoniens, qui admettoient la divinité
m Fils, & rejettoient celle du Saint-Efprit, on a montré que le
aaint-Efprit procédé du Pere, & eft envoyé par le Pere auffi bien
que le Fils: mais qu’il eft autre que le Fils : puifqu’il n’eft dit z L xzv. ».
smne part, qu il fou fils ni engendré. Il eft nommé également en 3
'-¿thmaf,
îa.forme du baptême. Æex. , baptifez. au nom du Pere & du f i l s , Scrat '