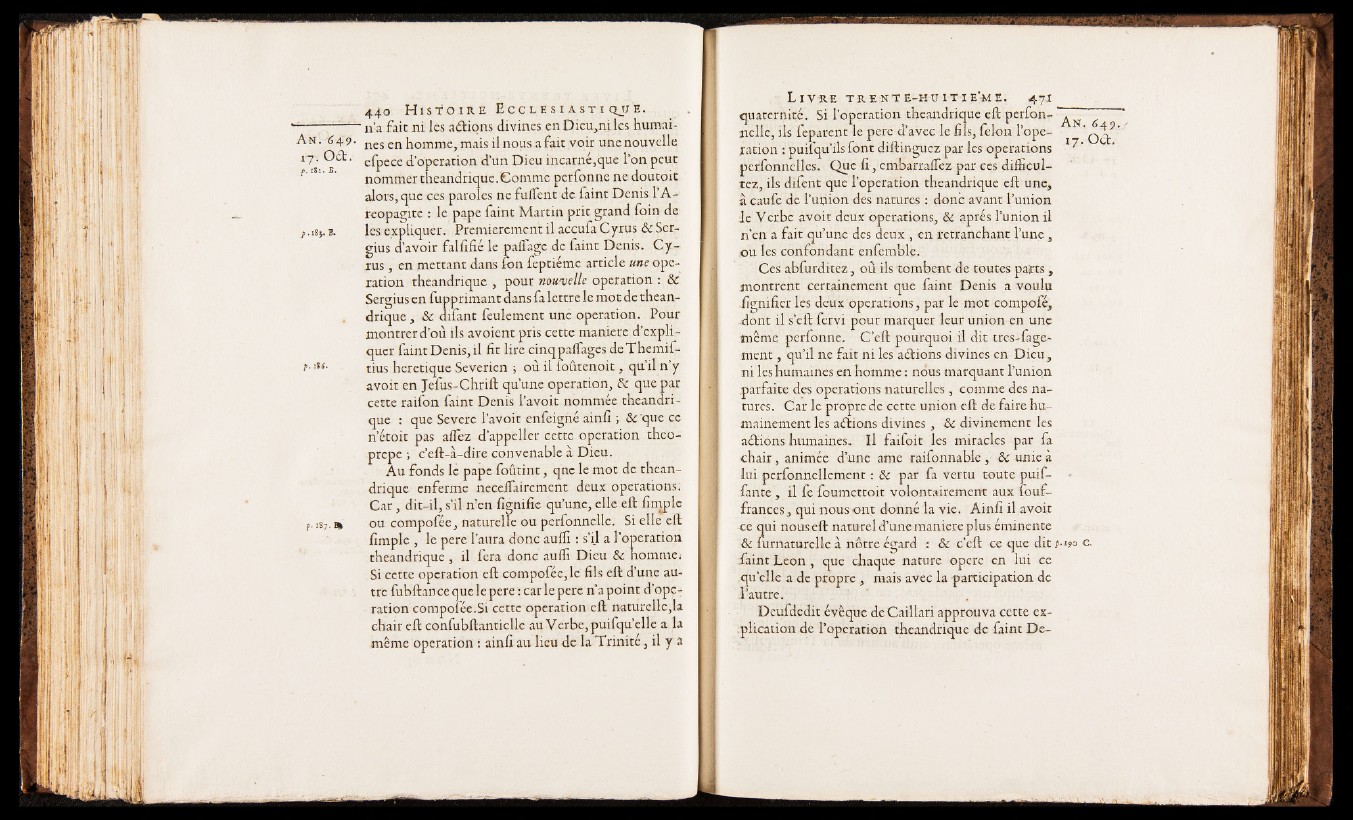
4 4 0 H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q j i e .
- - n’a fait ni les aélions divines en Dieu,ni les humai-
6 nés en homme, mais il nous a fait voir une nouvelle
P P f • efpece d’opération d’un Dieu incarné,que l’on peut
nommer theandrique. Comme perfonne ne doutoit
alors, que ces paroles ne fuifent de faint Denis l’A -
reopagite : le pape faint Martin prit grand foin de
b. les expliquer. Premièrement il accufa Cyrus & Sergius
d’avoir faliiiié le paifage de iaint Denis. C y rus
, en mettant dans ion feptiéme article une opération
theandrique , pour nouvelle opération : &c
Sergius en fupprimant dans fa lettre le mot de theandrique
, & difant feulement une opération. Pour
montrer d’où ils avoient pris cette maniéré d’expliquer
faint D enis, il fit lire cinq paifages d eT h em if-
tius heretique Severien ; où il fo û ten o it, qu’il n y
avoit en Jefus-Chrift qu’une opération, & que par
cette raifon faint Denis l ’avoit nommée theandrique
: que Severe l’avoit enfeigné ainfi ; & 'que ce
n’étoit pas allez d’appeller cette opération theo-
prepe ; c’eft-à-dire convenable à Dieu.
A u fonds le pape fo û tin t , qne le mot de theandrique
enferme necelfairement deux opérations:
C a r , d it-il, s’il n?cn fignifie qu’une, elle eft fimplc
. % ou compofée, naturelle ou pêrfonnellc. Si elle eft
fimple , le pere l’aura donc auffi : s’il a l’opération
theandrique , il fera donc auffi Dieu & homme.
Si cette opération eft compofée, le fils eft d’une autre
fubftance que le pere : car le pere n’a point d’ope-;
ration compofée.Si cette opération eft naturelle,la
chair eft confubftanticlle au Verbe , puifqu’elle a la
-même opération : ainfi âu lieu de la T r in ité , il y a
L i v r e t r e n t e - h u i t i e ’-m e . 4 7 1
quaternité. Si l’opération theandrique eft perfon- ~ |
nc lle , ils feparent le pere d’avec le fils, félon l’ope- ■ çy \
ration : puifqu’ils font diftinguez par les opérations 1 -
petfonnelles. Que f i , embarraifez par ces difficul-
te z , ils difent que l ’opération theandrique eft une,
a caufe de l’union des natures ; donc avant l’union
le Verbe avoit deux opérations, & après l’union il
n’en a fait qu’une des deux , en retranchant l’u n e ,
ou les confondant enfemble.
Ces abfurditez , où ils tombent de toutes paîrts,
montrent certainement que faint Denis a voulu
fignifier les deux opérations, par le mot compofé,
dont il s’eft fervi pour marquer leur union en une
même perfonne. C ’eft pourquoi il dit tres-fage-
m en t, qu’il ne fait ni les a ¿lions divines en D ieu ,
ni les humaines en homme: nous marquant l ’union
.parfaite des opérations naturelles, comme des natures.
Car le propre de cette union eft de faire humainement
les aélions divines , &c divinement les
aélions humaines. Il faifoit les miracles par fa
chair , animée d une ame raifonnable , & unie à
lui perfonnellement : & par fa vertu toute puif-
fante , il fe foumettoit volontairement aux fo u f-
frances, qui nous o n t donné la vie. A in fi il avoit
o e qui nous eft naturel d’une maniéré plus éminente
& furnaturelle à nôtre égard : & c’eft ce que diti-oo c.
ia in t Léon , que chaque nature opere en lui ce
qu’elle a de propre , mais avec la participation de
l ’autre. .
Dcufdedit évêque de Caillari approuva cette explication
de l ’opération theandrique de faint D e -