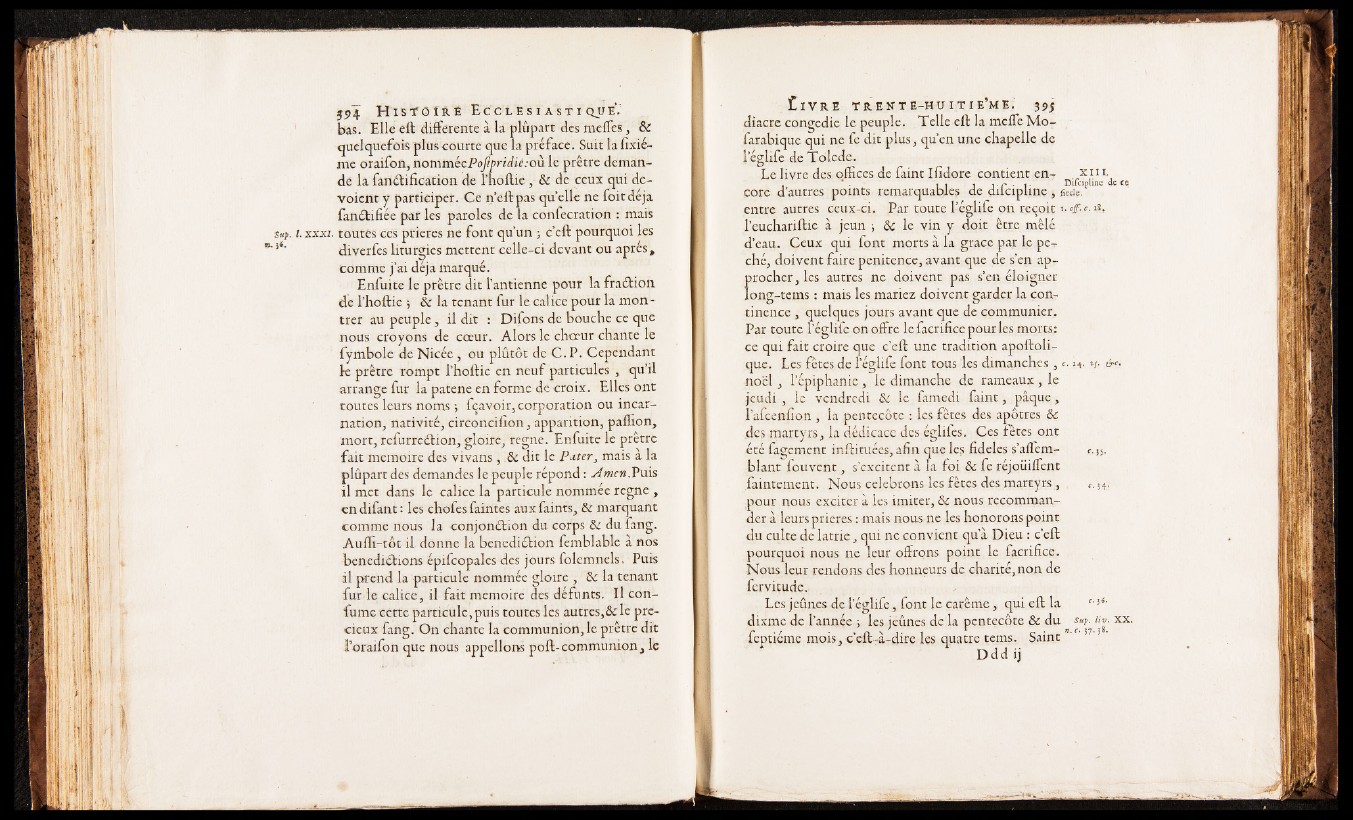
suf. l. x,
3*.
55>4 H i S ' T ô i S . É E c c l e s i a s t i q u e .
bas. Elle eft différente à la plûpart des meffes, &
quelquefois plus courte que la préface. Suit la fixié-
me oraifon, nommêcPoflpridiè.-où le prêtre demande
la fanétification de l’h o ft ie , & de ceux qui de-
Voient y participer. C e n’eftpas q u e lle ne foitdeja
fanéfifiée par les paroles de la confecration : mais
toutes ces prières ne fo n t qu’un ; c’eft pourquoi les
diverfes liturgies mettent celle-c i devant ou après,
Comme j’ai déjà marqué.
Enfuite le ptêtre dit l’antienne pour la fradtion
de l’hoftie 5 & la tenant fur le calice pour la m on trer
au p eu p le , il dit : Difons de bouche ce que
nous croyons de coeur. Alors le choeur chante le
fym b o le de Nicée , ou plutôt d eC. P. Cependant
le prêtre rompt l’hoftie en n euf particules , qu’il
arrange fur la patene en forme de croix. Elles ont
toutes leurs noms -, fçavoir, corporation ou incarnation,
na tivité, circon c iiion , apparition, paillon,
mort, refurredtion, glo ire, regne. Enfuite le prêtre
fa it mémoire des v iv a n s , & dit le Pater, mais à la
plûpart des demandes le peuple répond : Amen. Puis
i l met dans le calice la particule nommée regne ,
en difant : les chofes faintes aux faints, & marquant
comme nous la conjondtion du corps & du fang.
A u lïï- tô t il donne la benedidtion femblable à nos
benedidtions épifcopales des jours folemnels. Puis
i l prend la particule nommée gloire , &c la tenant
fu r le calice, il fait mémoire des défunts. Il con -
fume cette particule, puis toutes les autres,& le précieux
fang. On chante la communion, le prêtre dit
l ’oraifon que nous appelions poft-communion, le
24, ZJ. & c .
L i v r e t r e n t e - h u i t i e ’m e .' 395
diacre congédié le peuple. Te lle eft la meffe M o -
farabique qui ne fe dit plus, quen une chapelle de
l ’églifc de T ô lede.
Le livre des offices de faint Ifidore contient enT x 11 r-,
* . » i 1 i r • t - D ifc ip lin e de ce
çore d’autres points remarquables de dilcipline -, fieçie.
entre autres ceux-ci. Par toute l’églife on reçoit >»,
l ’euchariftie à jeun ; & le vin y doit être mêlé
d’eau. Ceux qui font morts à la grâce par le peT
ché, doivent faire penitence, avant que de s’en approcher,
les autres ne doivent pas s’en éloigner
long-tems : mais les mariez doivent garder la continence
, quelques jours avant que de communier.
Par toute l’églife on offre le facrifice pour les morts:
ce qui fait croire que c’eft une tradition apoftoli-
que. Les fêtes de l’églife font tous les dimanches , c.
noël , l’épiphanie , le dimanche de rameaux , le
jeudi , le vendredi & le famedi fa in t , pâque,
l ’afcenfion , la pentecôte : les fêtes des apôtres &
des martyrs, la dédicace des églifes. Ces fêtes ont
été fagement inftituées,afin que les fideles s’affem-
blant fo u v e n t , s’excitent à la fo i & fe réjoüiffent
faintement. Nous célébrons les fêtes des martyrs, <■. î4,
pour nous exciter à les imiter, & nous recommander
à leurs prières : mais nous ne les honorons point
du culte de latr ie , qui ne convient qu’à Dieu : c’eft
pourquoi nous ne leur offrons point le facrifice.
Nous leur rendons des honneurs de charité, non de
fervitude.
Les jeûnes de l’é g life , font le carême, qui eft la c‘ 5i-
dixmc de l’année ; les jeûnes de la pentecôte & du $«?• ^ xx.
lcptieme mois^ c eit-a-dire les quatre tems. baint
D d d ij
c.55.
’ 37-