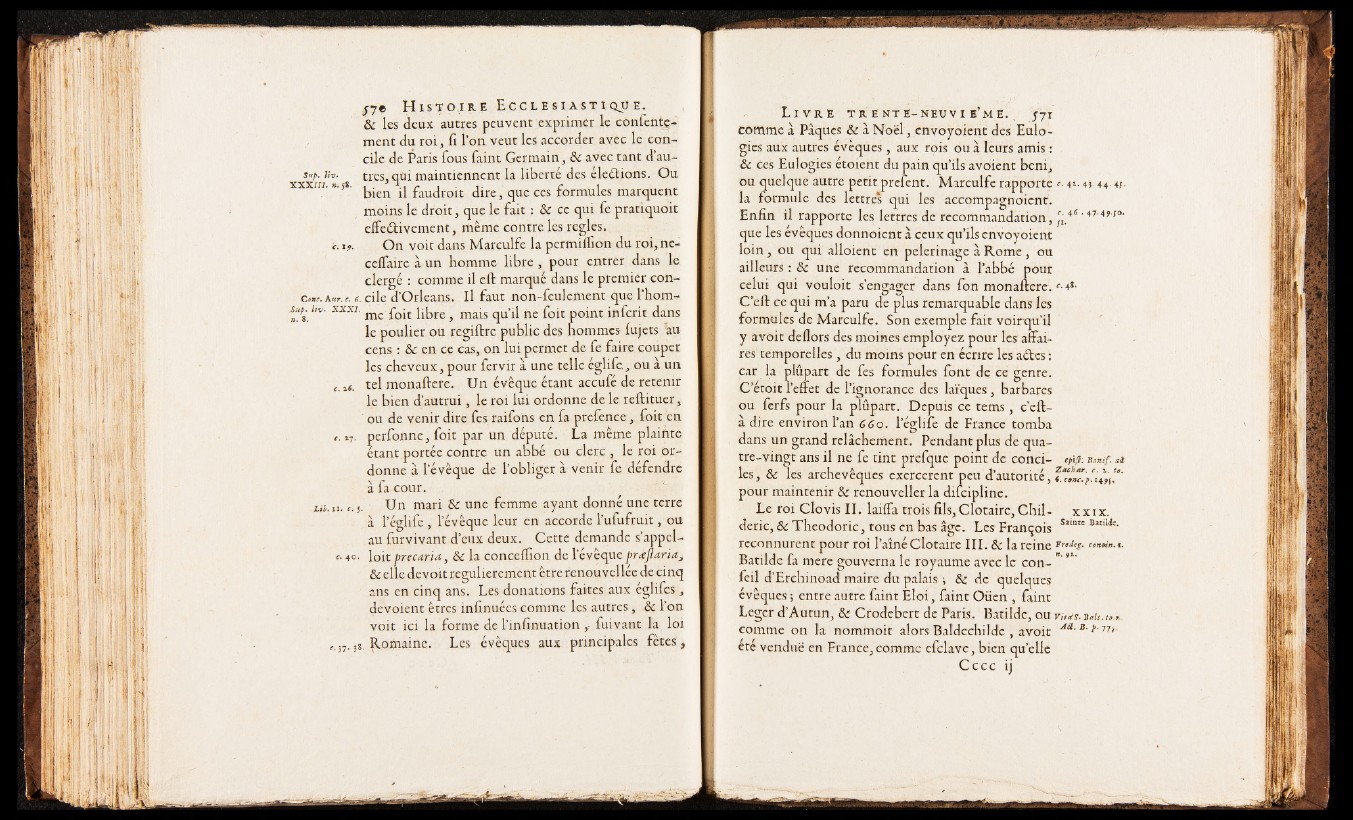
Sup. Ytv.
XXX/IZ. ». 5«.
1 . 19.
Cone. Aur. c. 6
.Sup. liv • XXXI
». 8.
c. 16.
c. 17.
Lib. i l . c.
c. 40.
¿ 7 e H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
& les deux autres peuvent exprimer le cûnlentement
du ro i, fi l’on veut les accorder avec le concile
de Paris fous faint Germain, 8c avec tant d’autres,
qui maintiennent la liberté des éleétions. Ou
bien il faudroit dire, que ces formules marquent
moins le droit, que le fait : & ce qui fe pratiquoit
effeéfcivement, même contre les réglés.
On voit dans Marculfe la permiffion du roi,nc-
ceffaire à un homme lib re , pour entrer dans le
clergé : comme il eft marqué dans le premier concile
d’Orleans. Il faut non-feulement que l’homme
foit lib re , mais qu’il ne foit point inferit dans
le poulier ou regiftre public des hommes iujets au
cens : & en ce cas, on lui permet de fe faire couper
les cheveux, pour fervir à une telle églife., ou à un
tel monaftere. Un évêque étant accufé de retenir
le bien d’autrui, le roi lui ordonne de le reftituer,
ou de venir dire fes raifons en fa prefence, foit en
perfonne, foit par un député. La même plainte
étant portée contre un abbé ou c lerc , le roi ordonne
à l’évêque de l’obliger à venir fe défendre
à fa cour.
Un mari & une femme ayant donné une terre
à le g life , levêque leur en accorde l’ufufruit, ou
au fur vivant d’eux deux. Cette demande s’appel-
loit precarioe, & la conceffion de l’évêque proeflariaj
8c elle devoit regulierement être renouvellée de cinq
ans en cinq ans. Les donations faites aux églifes ,
devoient êtres infinuées comme les autres, Ôc l’on
voit ici la forme de l’infinuation ,• fuivant la loi
!.. Romaine. Les évêques aux principales fêtes ,
L i v r e t r e n t e - n e u v i e ’ m e . 5 7 1
comme à Pâques 8c à N o ë l, envoyoient des Eulo-
gies aux autres évêques , aux rois ou à leurs amis :
8c ces Eulogies étoient du pain qu’ils avoient béni,
ou quelque autre petit prefent. Marculfe rapporte ^ 4». 4) 44.45
la formule des lettrel qui les accompagnoicnt.
Enfin il rapporte les lettres de recommandation, jj.45 ' 47'4M(>’
que les évêques donnoient à ceux qu’ils envoyoient
lo in , ou qui alloient en pelerinage à R om e , ou
ailleurs : & une recommandation à l’abbé pour
celui qui vouloit s’engager dans fon monaftere; *-4*-
C ’eft ce qui m’a paru de plus remarquable dans les
formules de Marculfe. Son exemple fait voirqu’il
y âvôit deflors des moines employez pour les affaires
temporelles , du moins pour en écrire les aâxs :
car la plûpart de fes formules font de ce genre.
C ’étoit l’effet de l’ignorance des laïques, barbares
ou ferfs pour la plûpart. Depuis ce tems, c’eft-
à dire environ l’an 6 6 o. leglife de France tomba
dans un grand relâchement. Pendant plus de quatre
vingt ans il ne fe tint prefque point de conci- «m«: b
les, & les archevêques exercerent peu d’autorité,
pour maintenir 8c renouveller la difeipline.
Le roi Cio vis 11. laiffa trois fils, Clotaire, Chil- x x i x.
deric, 8c Theodoric, tous en bas âge. Les François Samtc Battlic'
reconnurent pour roi l’aîné Clotaire III. 8c la reine comin.i,
Batilde fa mere gouverna le royaume avec le con- 91
feil d’Erchinoad maire du palais ; 8c de quelques
évêques ; entre autre faint E lo i, faint Oiien , faint
Léger d’Autun, & Crodcbert de Paris. Batilde, ou v m s .
comme on la nommoit alors Baldechilde, avoir Aa z -ti7>-
été vendue en France,comme efclave, bien quelle
C c c c ij