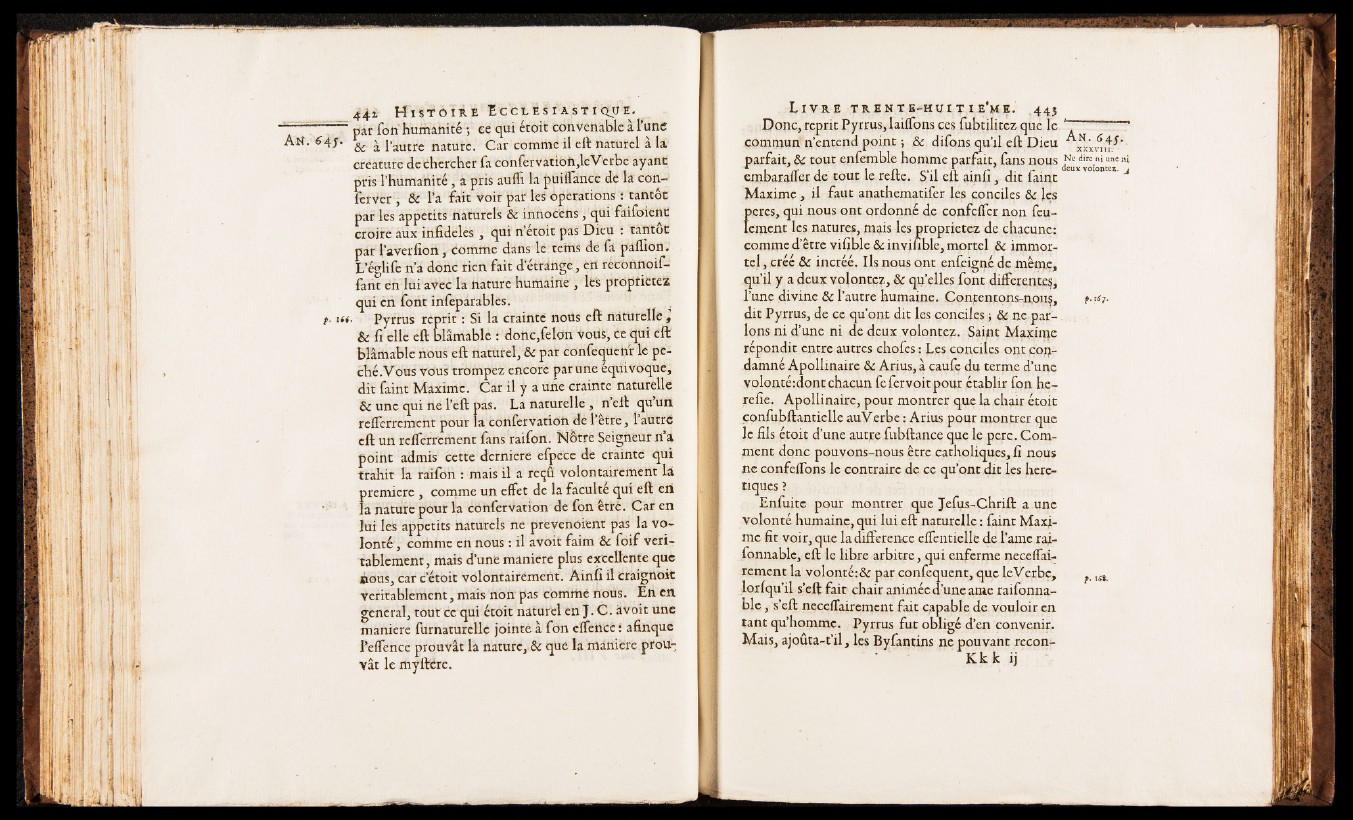
44* H i s t o i r e E c c l e s i a s t i q u e .
paf fonhumâhité ; ec qui écoit convehable à l’une
A K . 64j> & v i'auçrc nature. Car comme il cft naturel à la
créature de chercher fa confervatioü,leVerbe ayant
pris l’humanité, à pris aüffi la puiifance de la co n -
lcrvcr , & l’a fait vo ir pat lès opérations : tantôt
par les appétits naturels & innoCens, qüi faifoicnt
croire aux infidèles , qui n’étoit pas Dieu : tantôt
par l’a v e r fio n , comme dans lé teins de fit palfion.
E’églife n’a donc rien fait d é trange, èn reconnoif-
fànt en lui avec la nature hurtiainè', lés prôpfiétez
qui en font infepàrables. ,
p. i«. Pyrrus reprit : Si la crainte nous eft naturelle ,
& fi elle eft blâmable : donc,félon vous, te qui eft
blâmable nous eft naturel, & par confcquenr le péché
.Vous vous trompez encore par une eqitivoque,
dit faint Maxime. Car il y a une crainte naturelle
& une qui ne l’eft pas. La naturelle , n eft qu uli
refferrement pour la confervatioP de 1 ê tre, 1 autre
eft un reiferrement fans raifon. Nôtre Seigneur il à
point admis cette derniere efpéte de crainte qui
trahit la raifon : mais il a retjü volontairement là
première , comme un effet de la faculté qui eft en
la nature pour la confervation de fon être. Ca r en
lui les appétits naturels ne prevenoient pas la v o lo
n t é , comme en nous : il a voit faim & fo i f véritab
lement, mais d’une maniéré plus excellente que
pous, car c’étoit volontairement. A in fi il cràignoit
véritablement, mais non pas comme nous. En en
gênerai, tout ce qui étoit naturel en J . C . àvoit une
maniéré fürnaturelle jointe â fo n effehcè : afinque
I’effence prouvât la nature, & que la manière prouvât
le myftére.
L i v r e t r e n t e -h u i t i e 'm e . 445
D o n c , reprit Pyrrus, biffons ces fubtilitez que le
commun n’entend point ; & difons qu’i l eft Dieu
parfait, & tout enfemble homme parfait, fans nous
embaraffer de tout le reftç. S’il eft a in fi, dit faint
M a x im e , il faut anathematifer les conciles & les
()eres, qui nous ont ordonné de confeffer non feu-
çment les natures, mais les proprietez de chacune:
çornmc d’être vifible & invjlible, mortel &c immorte
l , créé & incréé. Ils nous ont enfeigné de même,
qu’il y a deux vo lon te z , & qu’elles font différente?,
l ’une divine & l ’autre humaine. Contcntons-nou?,
dit Pyrrus, de ce qu’ont dit les conciles ; & ne parlons
ni d’une ni de deux volontez. Saipt Maxiipe
répondit entre autres chofes : Les conciles opt condamné
Apollinaire & Arius, à caufe du terme d’une
volonté:dont chacun fe fe rvo it pour établir fon he-
refie. Apollinaire , pour montrer que la chair étoit
çonfubftantielle auVerbe : Arius pour m ontrer que
le fils étoit d’une autre fubftance que le pere. C om ment
donc pouvons-nous être catholiques, fi nous
pc confeffons le contraire de ce qu’ont dit les hérétiques
?
Enfuitc pour montrer que Jefus-Chrift a une
vo lon té humaine, qui lui e ft naturelle : faint Maxime
fit voir, que la différence effentielle de l’amc raj-
fonnablc, cft le libre arbitre, qui enferme neceffai-
rement la vo lon té :& par confequept, que leVerbe,
loriqu’il s’eft fait chair animée d’une ame raifonna-
b l e , s’eft neccffairement fait capable de vouloir en
tant qu’homme. Pyrrus fu t obligé d’en convenir.
Mais , ajoûta-t’i l , les Byfantins ne pouvant recon-
‘ K k k ij
A n . 64J.
.xkxviir.
Ne dire ni une ni
deux volontez. j
p . ÿ k
p. 16%.