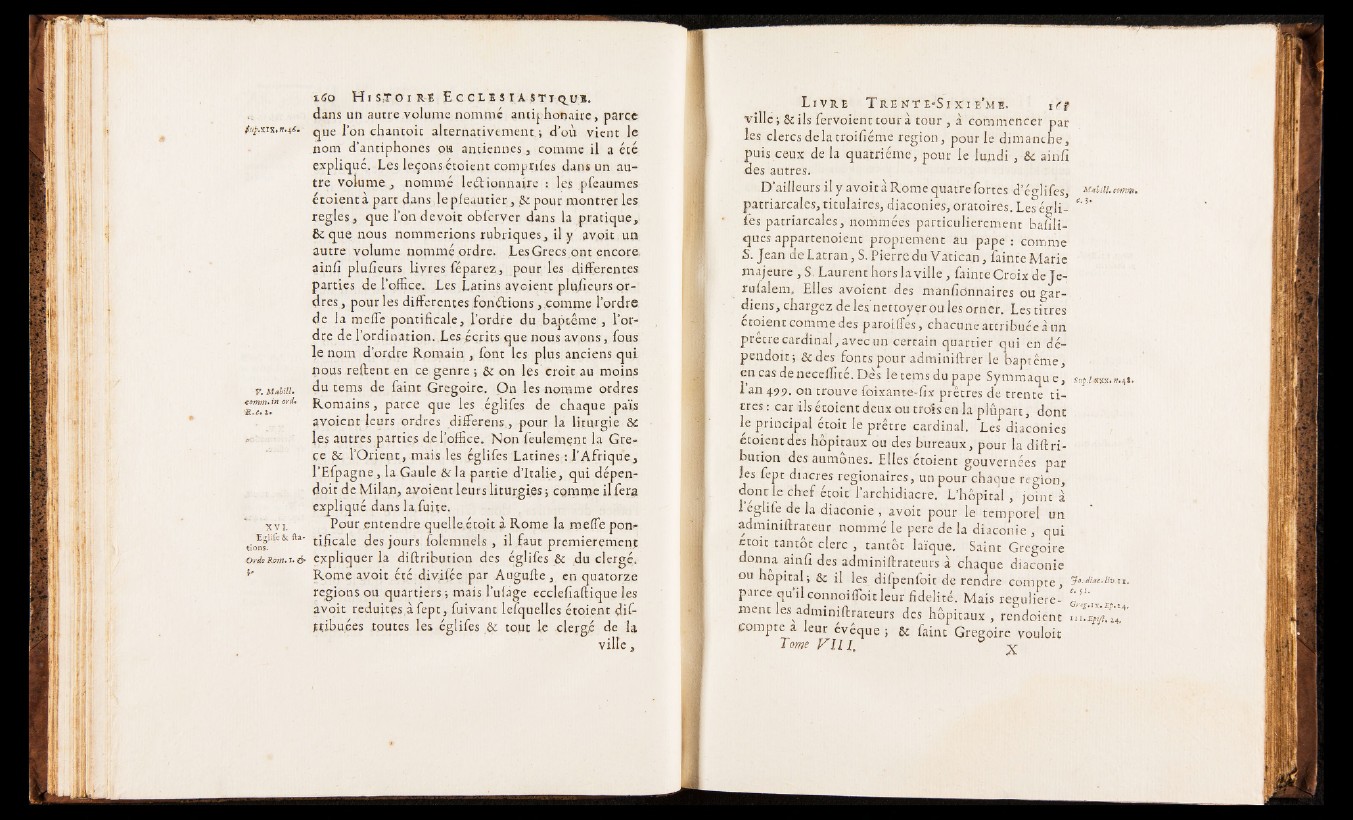
F it
¡ i l
i l
flff
». 4Í.
l£o H I S,T O I R t E C C L £ S I A S T I Q_U S.
dans un autre volume nomme antiphoftaire, parce
que l’on chantoic alternativement ; d'où vient le
nom d’antiphones ou antiennes, comme il a été
expliqué. Les leçons étoient compriies dans un autre
volume , nommé lé g io n n a ire : les pfeaumes
é to ien t à part dans lep le au tie r , & pour montrer les
réglés , que l’on d e vo it obferver dans la pratique,
8c que nous nommerions rubriques, il y avoir un
autre volume nommé ordre. Les Grecs .ont encore,
ainfi plufieurs livres fép arez , pour les différentes
parties de l’office. Les Latins avoient plufieurs o rd
re s , pour les différentes fo n d io n s , ,comme l’ordre
de la meffe pontificale, l ’ordre du b a p têm e , l’ordre
de l’ordination.,Les écrits que nous a v o n s , fous
le nom d’ordre Rpmain , font les plus anciens qui
nous relient en ce genre ; & on les croit au moins
du tems de faint Grégoire. On les nomme ordres
R om a in s , parce que les églifes de chaque païs
avoient leurs ordres différais., pour la liturgie &
les autres parties de l’office. Non feulement la Gre-
çe 5c l’O r ien t, mais les églifes Latines :J’A f r iq u e ,
l ’E fp a gn e , la Gaule & la partie d’Italie, qui dépeu-
doit de Milan, avoient leurs liturgies ; comme ilfer#
expliqué dans la.fuite.
Pour entendre quelle,étoit à Rome la meffe pontificale
des jours folemnels , il faut premièrement
orioKom.i.é' expliquer la diftribution des églifes & du clergé.
Rome avoit été d ivjfée par A u g u fte , en quatorze
régions ou quartiers; mais l’uiàge ecclefiaftique les
avoit réduites,à fep t, fuivant lefquelles étoient dif-
ftibuées toutes les églifes f c tout le clergé de la
v iU c ,
F. Mabill.
eomm* in ord.
X V I .
Eglife & fta
tions,
1 ;
j¡ifilili
L i v r e T r e n t e - S i x i e’me. i a
v i l le ; 5cils fe rvoien ttourà tour , à commencer par
les clercs de la troifiéme région, pour le d imanch e ,
puis ceux de la quatrième, pour le lundi , &c ainfi
des autres.
D'ailleurs il y avoit à Rome quatre fortes d’églifes,
patriarcales, titulaires, diaconies, oratoires. Les é g lifes
patriarcales, nommées particulièrement bafili-
ques appartenoient proprement au pape : comme
S. Jean de Lacran, S. Pierre du V a tic an , fainte Marie
majeure , S. Laurent hors la v i l l e , fainte C roix de Je-
ruialem, Biles avoient des manfidnnaires ou g ardiens,
chargez deles nettoyer ou les orner. Les titres
etoient comme des paroiffes, chacune attribuée à un
prêtre cardinal, avec un certain quartier qui en dé-
p en do it; & des fonts pour adminiftrer le baptême,
en cas de neceffiré. Dés le tems du pape Symmaqu e ,
1 an 499. on trouve foixante-fix prêtres de trente t i tres:
car ils étoient deux ou trois en la plûpart, dont
le principal étoit le prêtre cardinal. Les diaconies
etoient des hôpitaux ou des bureaux, pour la d iftr ibution
des aumônes. Elles étoient gouvernées par
les fept diacres regionaires, un pour chaque région,
dont le ch e f étoit l ’archidiacre. L ’hôpital , joint à
1 eglife de la diaconie , avoir pour le temporel un
adminiftrateur nommé le pere de la diaconie , qui
cto it tantôt clerc , tantôt laïque. Saint Grégoire
donna ainfi des adminiftrateurs à chaque diaconie
ou hôpital; & il les difpenfoit de rendre com p te ,
paice qu il connoiftoit leur fidélité. Mais reguliere-
menc les adminiftrateurs des hôpitaux , rendoient
compte a leur évêque ; &c faint Grégoire vouloic
Tome F lU . x
MabilU comm*
¿.3.
Sup.l XXX» n.4t.
Jo. diac.liv.i i .
c. JI.
Greg.ix.Ep.i^.
ni.EpiJl, i4,