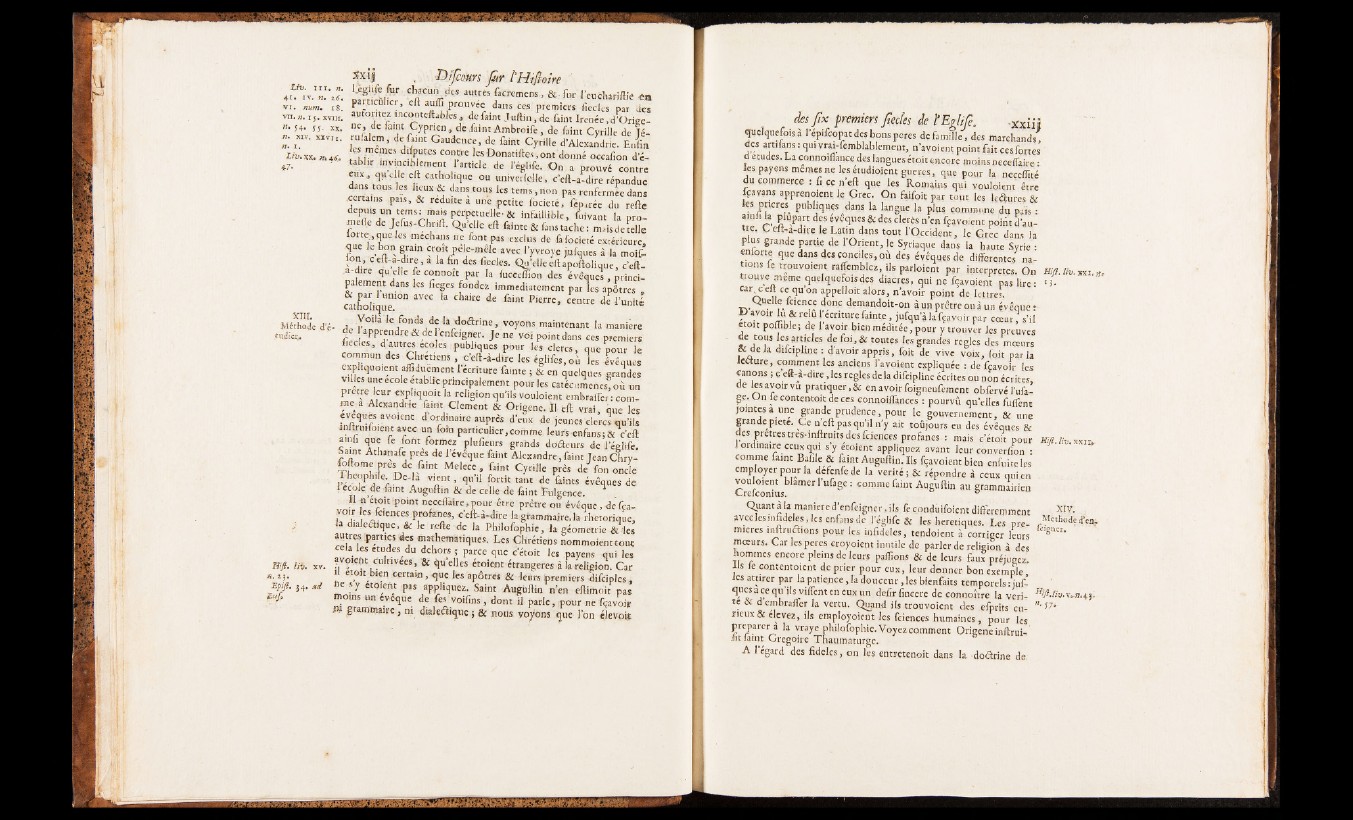
f ri ! . DJfiators f i r I’Hifioire Jp!‘£ ^flWlSK & fui l’^liarißle m
V I . mm. i g . p - ’ e f t a“™ prouvée dans ces premiers flecks par des
va.n. 1 5 .XVIII. autornez ïncqnteftabks, defaint Ju ftin .d e faint Irenée .d'Orige-
i4’ ” • x*- n<7 , , „C yPn en . de faint Ambroife, de faint Cyrille de Té-
* !UtïII‘ ,rurale'n * d^ ' nt Gaudence, de faint Cyrille d’Alexandrie. Enfin
JÄ.XX. C° ^ re le,sDonatifte!i - ont donné occaflon d’é-
J tabl.r invinciblement la rtick de lëglife. O n a prouvé contre
eu x, quelle eft catholique ou univerldle. cëft-a-dire répandue
4ans tous les lieux & dans tous les teins, non pas renfermée dans
.certains pais, & redutte a une petite focieté, fép.rée du refte
fuivant la pro-
S elle de Jefus-Chrift. Quelle eft fainte & fans tache: nia is de telle
iorte;, que les -medians ne font pas exclus de fa focieté extérieure,
1 1 I S i f l “ ? ltcPel1e-®éie » « c l'yvroye jufques à i m o it
io n , ceft-a-dire, a la fin des fieoles. Qu'elkeitapoftolique, c'eft-
a-drre quelle fe connoit par la fucceffion des évêques , princi-
pa ment dans les fieges fondez immédiatement par les apôtres
o t h o î i “ 10" aVe£ k ^ &im Pl£rre> ccmre de l ’unité
Mélode d’é- d e ' t w ' Î ^ ^ r ^ ’ voyons maintenant la maniéré
tudier. de 1
apprendre & d e lenfeigner. Je ne voi pointdans ces premiers
fle c k s , d autres ecoles publiques pour les clercs, que pour le
commun des Chretiens , okft-à-dire les églifes.où les iv êq u e s
expliquoient affiduement 1 écriture fainte ; & en quelques grandes
villes une ecole établie principalement pour les catécumenesfoù un
p r ê ta Jeur expliquoit la religion qu’ils vouloient tmbraffer : corn-
ffle a Alexandrie faint Clement & Origene. ft. eft vrai, que les
eveques aveuent d’ordinaire auprès d’eux de jeunes clercs q u ’ils
l H W S “ ec un foin particulier,comme leurs■enfans;& c’eft
amfi que fe foftt formez plufieurs grahds ¿odeurs de lëg life .
Saint Athanafe près de iëvêque faint Alexandre, faint Jean Chry-
foftome près de faint Melece . faint Cyrille près de fon oncle
T h eop k le . De-la v ien t, qu’il fortit tant de faims évêques de
• S ,, fann & de celle de faint Fùlgence.
Il n ’étoit‘point neeeflaire.pour être prêtre ou évêque, defoa-
« „ fe n c e s profanes, c’eft-à-dire la grammaire, la rhétorique,
la dialectique, & le refte de la Philofophic, la géométrie & les
autres .parties des mathématiques. Les Chrétiens nommoientt-out
cela les etudes du dehors ; parce que cëtoit les payens qui les
Hiß. Hi. XV. ¿ultivees, & quelles étoient étrangères à la religion. Car
*’ 1J’ « etoit bien certain, que les apôtres & -leurs premiers difciples ,
zpifi. 14. «rf “ « f.y «Oieât pas appliquez. Saint Augiiftin n’en eftithoit pas
»oms un eveque de fes’voifins, dont il parle, pour ne feavoir
fn grammaire, ni diakéfigue ; & nous voÿtfns <jue Ion éleVoijt
des jfix premiers Jîecles de l’Eglifi, -xxiiâ
quelquefois à l ’épifeopat des bons peres de famille, des marchands
des amrans: qui vraisemblablement, n’a voient point fait ces fortes’
d etudes. La connoiflance des langues étoit encore moins neceflaire •
les payens meraesne les étudioient gueres, que pour la neceflité
du commerce : fi ce n’eft que les Romains qui vouloient être
lçavans apprenoient le Grec. On faifoit paf tppt (es k àu r e s &
k s prtcres pubhque.s dans la langue la plus commune du pais •
M À d?s * des e»««s n’ep fpavoient point d’autte.
C eit-a-dire 1e Latin dans tout l’O ccident, k Grec dans la
plus grande partie de l’Orient, |e Syriaque dans la haute Syrie ■
enlortq que dans des conciles, où de? évêques de différentes natiouve
^ QUVQieT Mf emale2!,“ trouve meme quelquefois des diascrpe^s, 0qiuein tn eP ?fqr avMqiept paKs lire- 13-
car c eit ce qu’on appeiloit alors, n’avoir point de lettres.
Queue feience donc demandoit-on àunprêtFeouàun évêque
V avoir lu & re u l’écriture fainte, jufqu’à la fçavoir par coeur, s’ii
etoit poljibk ; dç 1 avoir bien méditée, pour y trouver les preuves
e tous les articles de fo i, & toutes les grandes réglés des moeurs
& delà diiciphne : d avoir appris, foit de vive voix, foit parla
lecture, comment les anciens l’a voient expliquée : de fçavoir les
canons ; ç’eft-à-dire, les réglés de la difeipline écrites ou non écrites,
de les avoir vu pratiquer, & en avoir foigneufement obfervél’ufa-
ge. O n le contemoit de ces connoilfances : pourvu qu’elles fulfent
jointes a une grande prudence, pour le gouvernement, & une
grande piete. Ce n eft pas qu’il n’y ait toujours eu des évêques &
l w l re-rei tre!' ia (*™its,d^ i'tielicts profanes : mais c’étoit pour W Ë Ë M sT
1 ordinaire ceux qui s y etoient appliquez avant leur converfion :
comme lamt Bafile & faint Auguftin. Ils fçavoient bien enfuiteks
employer pour la défenfede la vérité; & répondre à ceux qui en
Crëfcônflts §C : conimciaiutAuguftin au grammairien
Qjiant à la maniéré d’enfeigner, ils feconduifoient différemment ÜÉ iveclesmfideles,les enfansde l’églife & les heretiques. Les pre rMètKi> *d '« i
mieres inftruflions pour les infidèles, tendoient à corriger leurs gnet-
moeurs. Carksperes eroyoient inutile de parler de religion à des
hommes encore pleins de leurs pallions & de leurs faux préjugez
Ils k contentoient de prier pour eux, leur donner bon exemple
les attirer par la patience, la douceur, les bienfaits temporels : juf-
quesa cequ’jlsviflenteneuxun defir fincere de connoître la veri- B W M i l i j l
te oc d embralfer la vertu. Qt£and ils trouvoient des eiprits eu- n' ¿7i
rieux& élevez, ils employoient les feiences humaines, pour les
préparera la vraye philofophie. Voyezcomment Origene inftrui-
iàt iaint Grégoire Thaumaturge.
A l’égard des fideles, on les entretenoit dans la doârine de