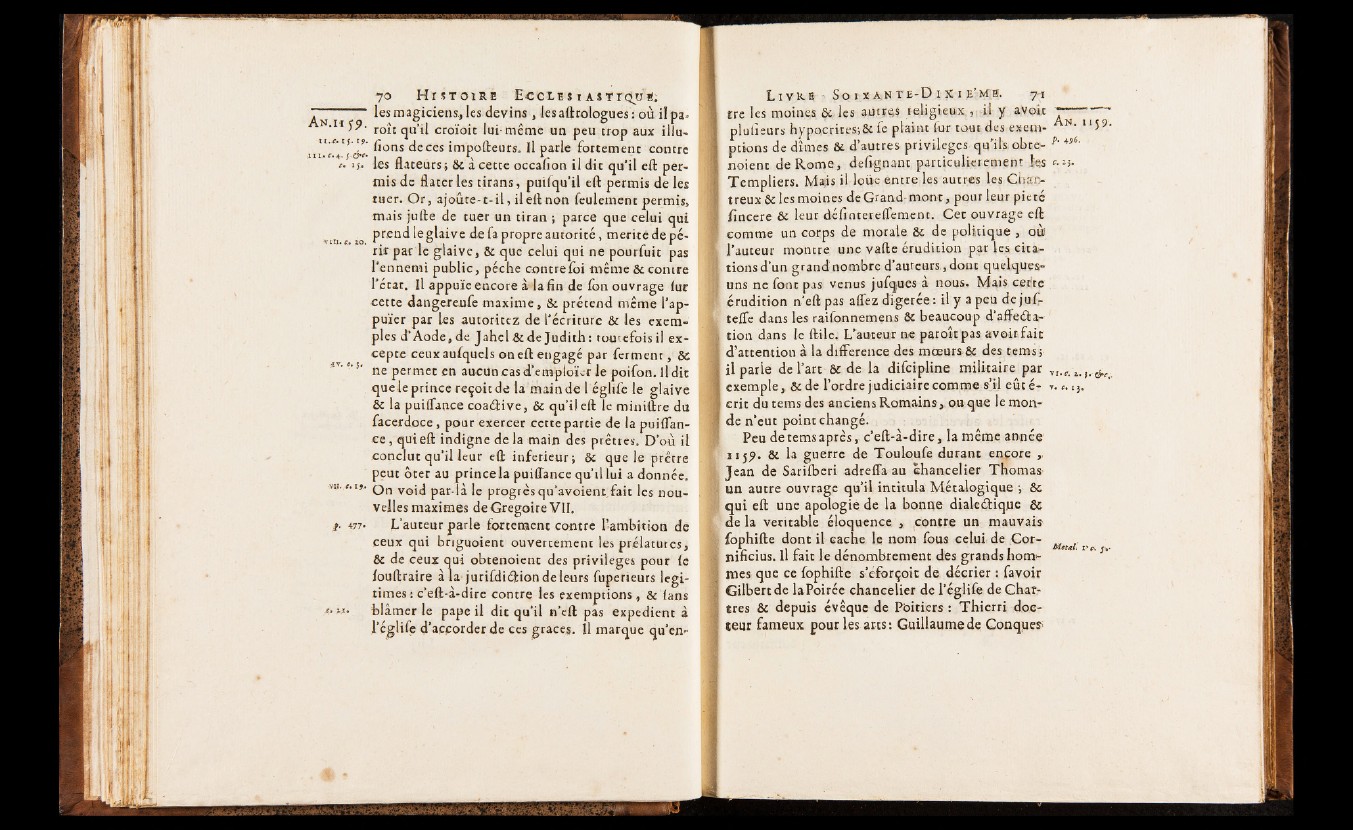
A n. i i y?.
I I .T . 15. 19,
¡il l. r.4. $.&e>
c* 15..
v m . c., 20.
¿v. ». 3.
VII.*. I^.
477®
•f® .M®
*
70 H i s t o i r e E c o l e s i a s t r çju E.
les magiciens, les devins , les aftrologues 2 ou il pa-
roît qu’il croïoit lui même un peu trop aux illu-
uons de ces impofteurs. Il parle fortement contre
les flateurs,; & à cette occafion il dit qu'il eft permis
de flaterles titans, puifqu’il eft permis de les
tuer. O r , ajoute-t-il, il eft non feulement permis,
mais jufte de tuer un tiran ; parce que celui qui
prend le glaive de fa propre autorité, mérité de périr
par le glaive, Si que celui qui ne pourfuit pas
l’ ennemi public, pèche contre foi même & contre
l’état. Il appuïeencoreàlalîn de ion ouvrage lur
cette dangereufe maxime, Si prétend même l’ap-
puïer par Les autoritez de l’écriture Si les exemples
d’ Aode,de Jahel& de Judith: toutefois il excepte
ceux aufquels on eft engagé par ferment, Si
ne permet en aucun cas d’emploïer le poifon. Il dit
quele prince reçoit de la main de 1 églife le glaive
& la puiflance coa&ive, & qu’il eft le miniftre du
facerdoce, pour exercer cette partie de la puiflan-
c e , qui eft indigne de la main des prêtres. D ’où il
conclut qu’il leur eft inférieur; Si que le prêtre
peut ôter au princela puiffance qu’il lui a donnée.
On void par-là le progrès qu’avoient,fait les nouvelles
maximes de Grégoire ¥ II.
L’auteur parle fortement contre l’ambition de
ceux qui briguoient ouvertement les prélatutes,
& de ceux qui obtenoient des privilèges pour le
iouftraire à la jurifdiitiondeleurs fuperieurs légitimés
: c’eft-à-dire contre les exemptions, & fans
blâmer le pape il dit qu’il n’eft pas expédient à
l ’églife d’acporder de ces grâces. Il marque qu’entre
L l V K S S O 1 X A N T E-D I X I E ’ MIE. 7 1
es moines les autres religieux , il ÿ avoir
pluiieurs hypocri tes;& fe plaint lur tout des exemptions
de dîmes Si d’autres privilèges qu’ils, obre-
noient de Rome, defi-gnant particulièrement les m
Templiers. Mais il loiàe entre les autres les Chartreux
& les moines de Grand-mont, pour leur pieté
fincere Si leur défintereffemenc. Cet ouvrage eft
comme un corps de morale Si de politique , où
l ’auteur montre une vafte érudition par les eka^
tionsd’un grand nombre d’auteurs,dont quelques-
uns ne font pas venus jufques a nous. Mai® cette
érudition n’eft pas allez digerée : il y a peu de juf-
teife dans les raifonnemens fit beaucoup d’affeêfea-
tion dans le ftile. L’auteur ne paroîtpas avoififait
d’attention à la différence des moeurs & des rems ;
il parle de l’art Si de la difcipline militaire par
exemple, Si de l’ordre judiciaire comme s’il eût é-
erit du tems des anciens Romains, ou que le monde
n’eut point changé.
Peu de tems après, c’eft-à-dire, la même année
i i j^ . Si la guerre de Touloufe durant encore ,,
Jean de Sariiberi adreffa au chancelier Thomas
un autre ouvrage qu’il intitula Métalogique ; Si
qui eft une apologie de la bonne dialectique Si
d e là véritable éloquence;, contre un mauvais
fophifte dont il cache le nom fous celui de Cor-
nificius. Il fait le dénombrement des grands hom>-
mes que ce fophifte s’éforçoit de décrier : favoir
Gilbert de laPoirée chancelier de l’églife de Chartres
& depuis évêque de Pbitiers : Thierri docteur
fameux pour les arts: Guillaume de Conques
A n . 1159.
P* 4 96.
v i . e. 2. |
v . c, 13 .
ISI
a