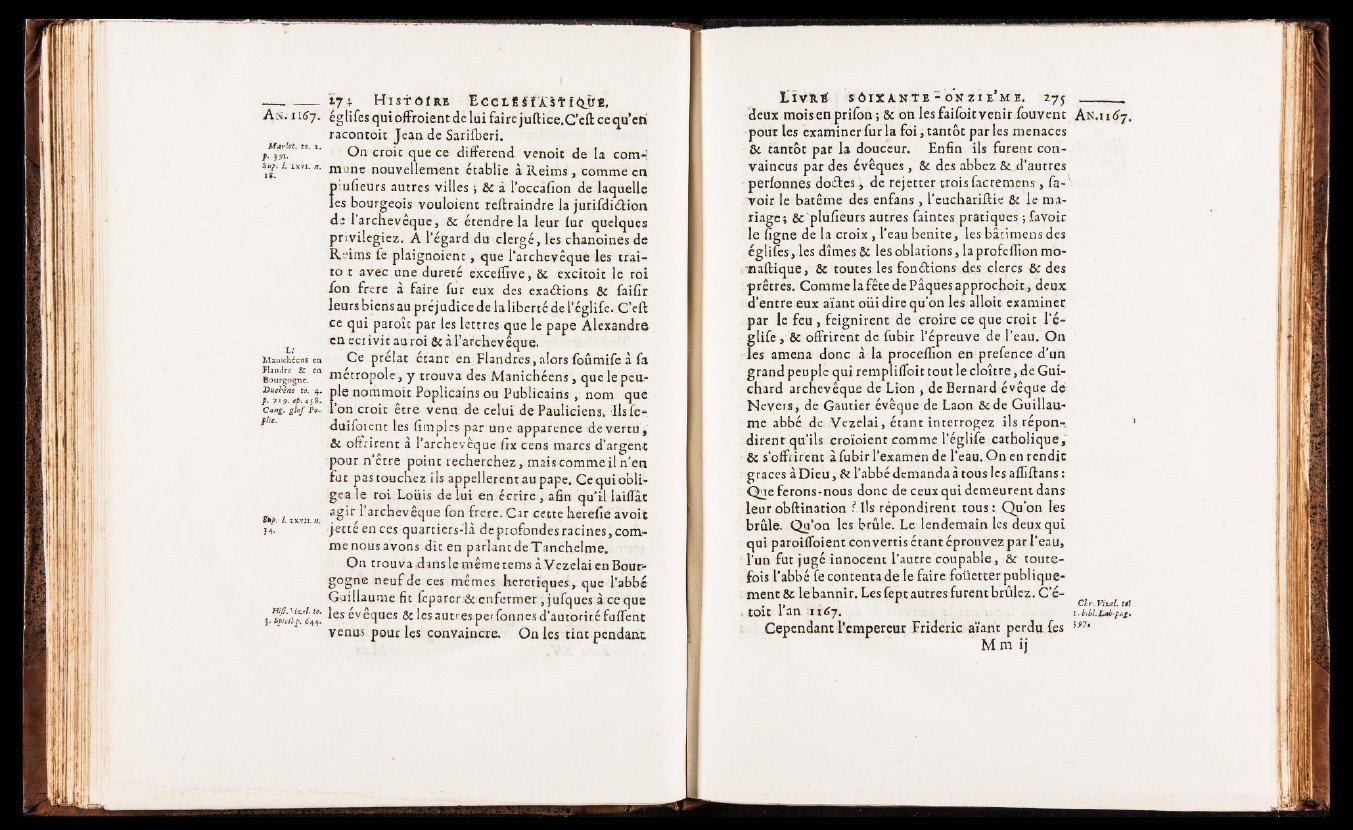
A n. 1167.
M a r lo t. to. x .
f. 391.
Sup. I. i x v i . n.
18 .
L:
Manichéens en
Flandre & en
B ou rg o gn e .
Du chêne to. 4 .
$ . 7 1 9 - ep. 458.
C a n g . g l o f Po-
fh c .
Skp. I. LXV2I. n.
M
"Hifi. Vfael. to.
J. Spicil.p. ¿44 .
174. H i s t o ir e E e e L S S ïÀ s ï iQ j r e .
églifes quiofFroient de lui faire juftice.C’efl: ce qu’eh
racontoit Jean de Sariiberi.
On croie que ce différend venoit de la com?
mune nouvellement établie à R e im s, comme en
piufieurs autres villes ; & à l’occafion de laquelle
les bourgeois vouloient reftraindre la jurifdiéfion
de 1 arclieveque, & étendre la leur iur quelques
privilégiez. A l’égard du clergé, les chanoines de
R eims fe plaignoient, que l’archevêque les trai-
to t avec une dureté exceflrve, & excitoit le roi
fon fre re a faire fur eux des exaêtions &c faifir
leurs biens au préjudice de laliberté de l’églife. C ’eft
ce qui paroîc par les lettres que le pape Alexandre
en écrivit au roi Sc à i’archevcque.
Ce prélat étant en Flandres,alors foûmife à fâ
métropole, y trouva des Manichéens, que le peuple
nornmoit Poplicains ou Publicains , nom que
l’on croit être venu de celui de Pauliciens. Ils fc-
duifoient les fimples par une apparence d e v e n u ,
& offrirent à l’archevêque fix ceDs marcs d’argent
pour n’être point recherchez, mais comme il n’en
fuc pas touchez ils appellerentaupape. Ce qui obligea
le roi Loiiis de lui en écrire , afin qu’il biffât
agir l archevêque fon frere. Car cette herefie avoir
jettéences quartiers-là deprafondesracines,com-
menousavons dit en parlantdeTanchelme.
On trouva-danslemême tems à Vezelai en Bourgogne
neuf de ces mêmes hérétiques, que l’abbs
Guillaume fit £èparer:& enfermer , jufques à ce que
les ev eques & les au très per fon nés d’autorité fuiTent
venus pour les convaincre. On les tint pendant
E î v r î s ô i x a n t e - o n z i e’ m b . 275 _____.
deux mois en prifon ; 8£ on les faifoic venir fouvent AN.udy.
pour les examiner fur la fo i, tantôt parles menaces
8t tantôt par la douceur. Enfin ils furent convaincus
par des évêques, 8c des abbez & d’autres
peribnnes doétes de rejetter trois facremens, fa-'
voir le batême des enfans , l’euchariftiç & le mariage;
& plufieurs autres faintes pratiques ;favoir
le figne de la croix , l’eau benite, les bâtimens des
eglifes, les dîmes & les oblations, la profellion mo-
'naftique, & toutes les fonctions des clercs & des
prêtres. Comme la fête de Pâques approchoit, deux
d’entre eux aïant oüi dire qu’on les alloit examiner
par le feu , feignirent de croire ce que croit l ’é-
g li fe , & offrirent de fubir l’épreuve de l’eau. On
les amena donc à la proceifion en prefence d’un
grand peuple qui rempliffoit tout le c loître, de Gui-
chard archevêque de Lion , de Bernard évêque dé
Nevers, de Gautier évêque de Laon & d e Guillaume
abbé de Ve ze la i, étant interrogez ils répon-, >
dirent qu’ils croïoient comme l’églife catholique,
& s’offrirent à fubir l’examen de l’eau. On en rendit
grâces à Dieu, & l’abbé demanda à tous lesaffiftans ;
Que ferons-nous donc de ceux qui demeurent dans
leur obftination ? Ils répondirent tous: Q u ’on les
brûle. Qu’on les brûle. Le lendemain les deux qui
qui paroiffoient convertis étant éprouvez par l’eau,
l’un fut jugé innocent l’autre coupable, & toutefois
l’abbé fe contenta de le faire foüetter publiquement
& le bannir. Les fepe autres furent brûlez. C ’é-
. «, r 1 C/.r. Vitcel. têl
toit lan ;m <>7. . .
Cependant Tempereur Frideric aïant perdu fes >>7'
M m ij