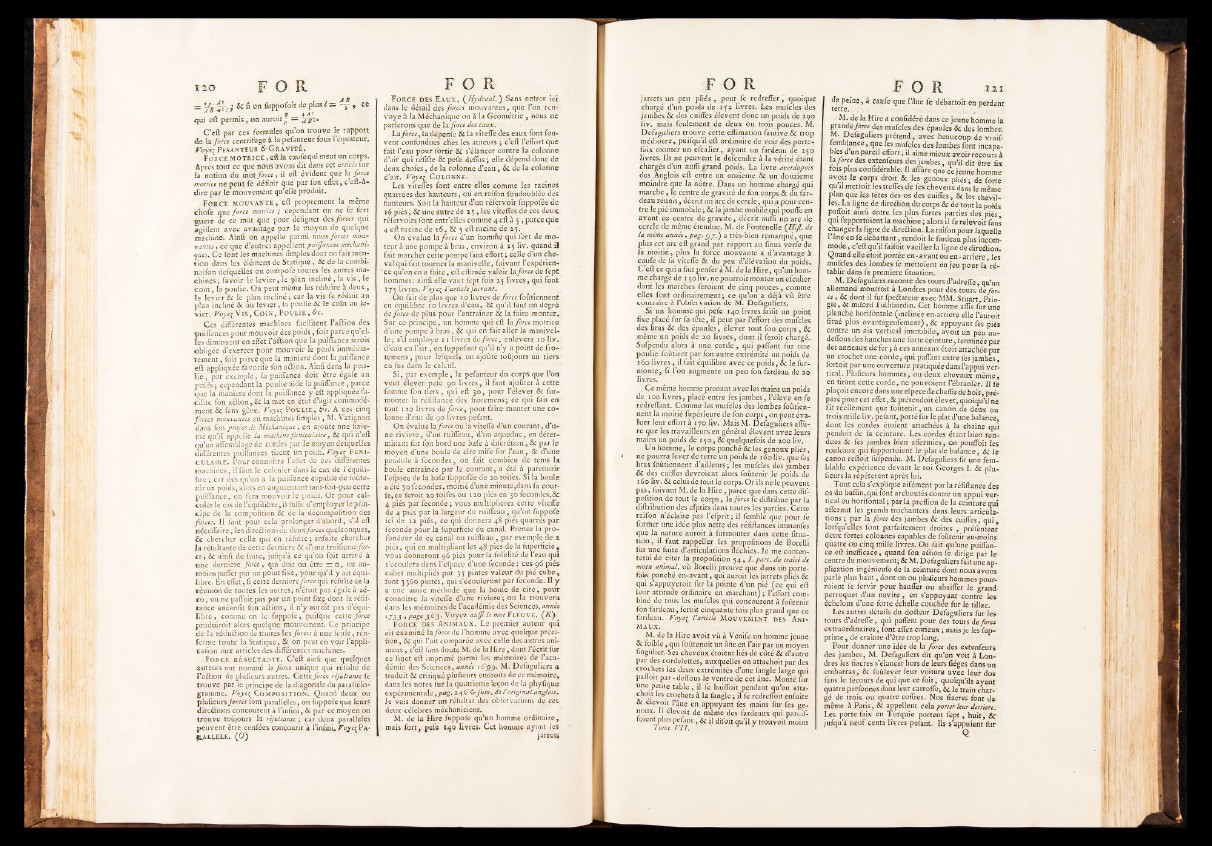
= I l2 -~ L • & fi on fuppofoit de plus l — — y ce
qui• efnt permfi s, on auroi• t 5-> _— 4- ^a js t »
C ’eft par ces formules qu’on trouve le rapport
de la force centrifuge à la pefanteur fous l’équateur.
Voyc^ Pesanteur ^ G ravité.
Force motrice, eft la caufequi meut un corps.
Après tout ce que nous avons dit dans cet article lur
la notion du mot force , il eft évident que la force
motrice ne peut fe définir que par fon effet, c eft-à-
dire par le mouvement qu’elle produit.
Force MOUVANTE, eft proprement la même
thofe que force motrice ; cependant on ne fe fert
■ guère de ce mot que pour défigner des forces qui
.agiffent avec avantage par le moyen de quelque
machine. Ainfi on appelle parmi nous/ère« mou-
yantts, ce que d’autres appellent puiffances méckani-
fîtes. Ce font les machines fimples dont on fait mention
dans les élémens de Statique, & de la combi-
naifon defquelles on compofe.toutes les autres ma-
chines; favoir le levier, le plan incliné, la v is , le
c o in , la poulie. On peut même les réduire à deux,
le levier 8c le plan incliné ; car ta vis fe réduit au
plan incliné & au levier, la poulie 8c le coin au levier.
Voye\_V i s , Coin, Poulie, &c.
Ces différentes machines facilitent l’aftion des
pui fiances'pour mouvoir des poids, foit parce qu’elles
diminuent en effet l’a&ion que la puiflance feroit
obligée d’exercer pour mouvoir le poids immédiatement
, foit parce que la maniéré dont la puiflance
eft appliquée favorife fon a&ion. Ainfi dans la poulie
, par exemple, la puiflance doit être égale au
poids ; cependant la poulie aide la puiflance, parce
que la maniéré dont la puiflance y eft appliquée facilite
fon a&ion, 8c la met en état d’agir commodément
8c fans gêne. Foye^ Poulie, & c. A ces cinq
forces mouvantes oü machines fimples, M. Varignon
dans fon projet de Méchanique, en ajoûte une fixie-
me qu’il appelle la machine funiculaire, 8c qui n’eft
qu’un affemblagé de cordes par le moyen defquelles
différentes puiffances tirent un poids. Poye^ Funiculaire
.' Pour cônnoître l’effet de ces différentes
machines, i l faut le calculer dans le cas de l’équilibre
; car dès qu’on a la puiflance capable de foûte-
nir un poids, alors en augmentant tant-foit-peu cette
puiflance, on fera mouvoir le poids. Or pour calculer
le cas de l’équilibre, il fuffit d’employer le principe
de la compofition 8c de la décompofition des
forces. Il faut pour cela prolonger d’abord, s’ i*l eft
néceflaire, les directions de deux forces quelconques,
8c chercher celle qui en réfulte ; enfuite chercher
la réfultante de cette derniere 8c d’une troifieme forc
e , 8c ainfi de fuite, jufqu’à ce qu’oii foit arrivé à
«ne derniere force , qui doit ou être = o , ou au-
moins paffer par un point-fixe, pour qu’il y ait équilibre.
En effet, fi cette derniere force qui réfulte de la
réunion de toutes les autres, n’étoit pas égale à zér
o , ou ne pafloit pas par un point fixp dont la réfif-
tance anéantît fon aftion, il n’y auroit pas d’équilibre
, comme on le fuppofe, puifque cette force
produiroit alors quelque mouvement. Ce principe
de la rédu&ionde toutes les forces à une feule, renferme
toute la Statique, 8r on peut en voir l’application
aux articles des différentes machines.
Force résultante. C’eft ainfi que quelques
auteurs ont nommé la force unique qui réfulte de
l’aûion de plufieurs autres. Cette force réfultante fe
trouve par le principe de la diagonale du parallélogramme.
Voye^ Composition. Quand deux ou
plufieurs forces font parallèles, on fuppofe que leurs
oireûions concourent à l’infini, & par ce moyen on
trouve toûjours la réfultante ; car deux parallèles
peuvent être cenfées concourir à l’infini, Foye{ PARALLELE.
(O)
Force des Eaux, ( Hydraul. ) Sans entrer ïcï
dans le détail des forces mouvantes, que l’on renvoyé
à la Méchanique ou à la Géômétrie , nous ne
parlerons que de la force des eaux.
La force, la dépenfe 8c la vîtefle des eaux font fou-
vent confondues chez les auteurs ; c’eft l’effort quê
fait l’eau pour lortir 8c s’élancer contre la colonne
d’air qui réfifte 8c pefe deflits ; elle dépend donc de
deux chofes, de la colonne d’eau, 8c de la colonne
d’air. Foyeç Colonne.-
Les vîteffes font entre elles cômme les racines
quarrées des hauteurs, ou en raifon foudoublée des
hauteurs. Soit la hauteur d’un réfervoir fuppoféede
16 p ies, 8c une autre de 25 , les vîteffes de ces deux
réfervoirs font entr’elles comme 4 eft à 5 , parce que
4 eft racine de 16, 8c 5 eft racine de 25»
On évalue la force d’un homme qui fert de moteur
à une pompe à bras, environ à 25 liv. quand il
fait marcher cette pompe fans effort ; celle d’un cheval
qui fait tourner la manivelle, fuivant l’expérien-
*ce qu’on en a faite, eft eftimée valoir la force de fept
hommes: ainfi elle vaut fept fois 25 livres, qui font
175 livres. Foye%_ l'article fuivant.
On fait de plus que 10 livres de force foûtiennent
en équilibre 10 livres d’eau, 8c qu’il faut un degré
de force de plus pour l’entraîner 8c la faire monter.
Sur ce principe, un homme qui eft la force motrice
d’une pompe à bras, 8c qui en fait aller la manivelle;
s’il employé 11 livres de force, enlèvera 10 liv.
d’eau en l’air , en fuppofant qu’il n’y a point de fro-
temens, pour lefquels on ajoûte toûjours un tiers
en fus dans le calcul.
Si, par exemple, la pefanteur du corps que l’on
veut élever pefe 90 livres, il faut ajoûter à cette
fomme fon tiers , qui eft 30, pour l’élever 8c fur-
monter-la réfiftance des frotemens; ce qui fait en
tout 120 livres de force, pour faire monter une colonne
d’eau de 90 livres pefant.
On évalue la force ou la vîtefle d’un courant, d’u - :
ne riviere, d’un ruifleau, d’un aqueduc, en déterminant
fur fon bord une bafe à diferétion, 8c par le
moyen d’une boule de cire mife fur l’eau, & d’une
pendule à fécondés, on fait combien de tems la
boule entraînée par le courant, a été à parcourir
l’efpace de la bafe fuppofée de 20 toifes. Si la boule
a été 30 fécondés, moitié d’une minute,dans fa cour-
fe,ce feroit 20 toifes ou 120 piés en 30 fécondés,8c
4 piés par fécondé ; vous multiplierez cette vîtefle
de 4 piés par la largeur du ruifleau, qu’on fuppofe
ici de 12 piés, ce qui donnera 48 pies quarrés par
fécondé pour la fuperficie du canal. Prenez la profondeur
de ce canal ou ruifleau, par exemple de 2
piés, qui en multipliant les 48 piés de la fuperficie,
vous donneront 96 piés pour la folidité de l’eau qui
s’écoulera dans l’efpace d’une fécondé : ces 96 piés
cubes multipliés par 3 5 pintes valeur du pié cube ,
font 3360 pintes, qui s*écouleront par fécondé. Il y
a une autre méthode que la boule de cire, pour
connoître la vîtefle d’une riviere ; on la trouvera
dans les mémoires de l’académie dès Sciences, année
1733 , p aë e 3 63 • V oyez aufli le mot Fleuv e, (/£)
Force des Animaux. Le premier auteur qui
ait examiné la force de l’homme avec quelque préci-
fion, 8c qui l’ait comparée avec celle des autres animaux
, c’eft fans doute M. de la Hire, dont l’écrit fur
ce fujet eft imprimé parmi les mémoires de l’académie
des Sciences, année iG g g . M. Defaguliers a
traduit 8c critiqué plufieurs endroits de ce mémoire,
dans les notes lur la quatrième leçon de la phyfique
expérimentale, pag. 2.46" 6-fu iv . de l 'original anglois.
Je vais donner un réfitltat des obfervations de ces
deux célébrés méchaniciens.
M. de la Hire fuppofe qu’un homme ordinaire,
mais fort, pefe 140 livres. Çet homme ayant les
jarrets
jarrets un peu pliés , peut fe redrefferquoique
chargé d’un poids de 152 livrejs. Les mufcles des
jambes 8c des cuiffes élevent donc un poids de 290
liv. mais feulement de deux ou trois pouces. M>
Defaguliers trouve cette eftimation fautive 8c trop
médiocre, puifqu’il eft ordinaire de voir des porter
faix monter un efcalier-, ayant un fardeau de 250
livres. Ils ne peuvent le defeendre à la vérité étant
chargés d’un aufli grand poids. La livre averdupois
des Anglois eft entre un onzième 8c un douzième
moindre que la nôtre. Dans un homme chargé qui
marche, le centre de gravité de fon corps 8t du fardeau
réunis, décrit un arc de cercle, qui a pour centre
le pié immobile ; 8c la jambe mobile qui pouffe en
avant ce centre de gravité, décrit aufli un arc de
cercle de même étendue. M. de Fontenelle (Hifi. de
la même année, pag. ÿyf), a très-bien remarqué, que
plus cet arc eft grand par rapport au finus verfe de
la moitié, plus la force mouvante a d’avantage à
caufè de fa vîtefle 8c du peu d’élévation du poids.
C ’eft ce qui a fait penfer à M. de la Hire, qu’un homme
chargé de 150 liv. ne pourroit monter un efcalier
dont les marches feroient de cinq pouces, comme
elles font ordinairement; ce qu’on a déjà vû être
contraire à l’obfervation de M. Defaguliers.
Si un homme qui pefe 140 livres faifit un point
fixe placé fur fa tête, il peut par l’effort des mufcles
des bras 8c des épaules, élever tout fon corps , 8c
même un poids de 20 livres, dont il feroit chargé..
Sufpendu alors à une corde, qui paffant fur une.
poulie foûtient par fon autre extrémité un poids der
ié o livres, il fait équilibre avec ce poids, 8c le fur-
monte, fi l’on augmente un peu fon fardeau de 20
livres.
Ce même homme prenant avec les mains un poids
de, 100 livres, placé entre fes jambes, l’éleve en fe
redreffant. Comme les mufcles des lombes foûtiennent
la moitié fupérieure de fon corps, on peut évaluer
leur effort à 170 liv. Mais M. Defaguliers affû-
re que les travailleurs en général élevent avec leurs
mains un poids de 15 o , 8c quelquefois de 200 liv.
Un homme, le corps panché 8c les genoux p liés,
ne pourra lever de terre un poids de 160 liv. que fes
bras foûtiennent d’ailleurs ; les mufcles des jambes
8c des cuiffes devroient alors foûtenir le poids de
160 liv. 8c celui de tout le corps. O r ils ne le peuvent
pas, fuivant M. de la H ire, parce que dans cette dif-
pofition de tout le corps, la force fe diftribue par la
diftribution des efprits dans toutes les parties. Cette
raifon n’éclaire pas l’efprit ; il femble que pour fe:
former une idée plus nette des réfiftances immenfes
que la nature auroit à furmonter dans cette fitua-
tion, il faut rappeller les propofitions de Borelli.
fur une fuite d’articulations fléchies. Je me contenterai
de citer la propofition 5 4 , 1 .part. du traité de
motu animal, oii Borelli prouve que dans un portefaix
panché en-avant, qui auroit les jarrets pliés 8c
qui s’appuyeroit fur la pointe d’un pié (ce qui eft
leur attitude ordinaire en marchant) ; l’effort combiné
de tous les mufcles qui concourent à foûtenir
fon fardeau, feroit cinquante fois plus grand que ce
fardeau. Voye^ l'article Mouvement des Animaux.
M. de la Hire avoit vû à Venife un homme jeune
& foible, qui foûtenoit un âne en l’air par un moyen
fingulier. Ses cheveux étoient liés de côté 8c d’autre
par des cordelettes, auxquelles on attachoitpar des
crochets les deux extrémités d’une fangle large qui
paffoit par - deffous le ventre de cet âne. Monté lur
une petite table , il fe baiffoit pendant qu’on atta-
les crochets à la fangle ; il fe redrefloit enfuite
8c elevoit l’âne en,appuyant fes mains fur fes genoux.
II elevoit de même des fardeaux qui parcif-
foientqflus pefans, 8c il difoit qu’il y trouyoit moins
Tome F I J.
de peiné, à eau f s que l’âne fe débàttoit en perdant
terre. ,;
. M. de la Hire a confidéré dans ce jeune hortime là
grande/orcc des mufcles des- épaules 8c des Iombesi
M. Defaguliers prétend,: avec beaucoup de vraif-
lemblance.,queles mufcles des lombes font incapables
d un pareil effort; il aime mieux avoir recours à
là force des extenfeurs des jambes, qu’il dit être fix
rois plus;confiderable. Il affûre que ce jeune homme
avoit le corps droit 8c les, genoux pliés; de forte
qu il mettent les treffes de fes:cheveux.dans le même
plan que les;têtes des os des cuiffes, 8c les chevilles.
La ligne de direâïon du corps 8c de tout le poMs
paffoit ainfi entre les plus fortes parties des piés
qui fupportoient la machine ; alors il ferelevoit fans
changer la ligne,de dire&ion. La raifoh pour laquelle
l’âne en fe débattant, rendôit le fardeau plus incommode,
c ’èft qu’jl faifoit vaciller la ligne de direûion.
Quand elle étoit portée en - avant ou en - arriéré ,-les
mufcles dés lombes fe mettoient en jeu pour la rétablir
dans fa première fituation. ;
M. Defaguliers raconté des tours d’adreffe-, qu’un
allemand monttoit à Londres polir dès tours deyôr-
ce, 8c dont il fut fperiatetir avec MM. Stuart Prin-
gle, 8c milordTullibardin. Cet homme alfis fur une
planche horifontale (inclinée en-arriere elle l’auroit
fitué plus avantageufement), 8c appuyant fes .pié»
contre un ais vertical immobile ; avoit un peu*au-
deffousdes hanches une forte ceinture ».terminée par
des anneaux de fer ; à ces anneaux étoit attachée:par
un crochet une corde, qui paffant entre fes jambes,
fortoit par une ouverture pratiquée dansl’appui ver?
tical. Plufieurs hommes, ou deux chevauxmêriie i
en tirant cette corde.,: ne pouvoient l’ébranler.: :II fe
plaçoit encore dans une elpece dechaflis de bois, préparé
pour cet effet, & prétendôit élever, quoiqu’il ne
fît réellement que foûtenir,:un canon de deux ou
trois mille liv. pefant, porté fur le plat d’une balance,
dont les cordes étoient attachées à la chaîne qui
pendoit de fa ceinture. Les cordes étant bien tendues
8c fes jambes bien affermies, on pouffoit les
rouleaux qui fupportoient le plat de balance, 8c le
canon rëftoit fiifpendu. M. Defaguliers fit une fem-
blable expérience devant le roi Georges I. 8c plufieurs
la répétèrent après lui.
Tout cela s’explique aifément par la réfiftance des
ç$ du bafluyqui font areboutés contre un appui vertical
ou horifontal ; par la preflïon de la ceinture qui
affermit les grands trochanters dans leurs articulations
; par la force des jambes 8c des cuiffes, qui,
lorfqu’elles font parfaitement droites , préfentent
deux fortes colonnes capables de foûtenir au-moins
quatre ou cinq mille livres. On fait qu’une puiffan-
ce eft inefficace, quand fon aéfion fe dirige par le-
centre du mouvement; 8c M. Defaguliers fait une application
ingénieufe de la ceinture dont nous avons
parlé plus haut, dont un ou plufieurs hommes pour-
roient fe fervir pour hauffer ou abaiffer le grand:
perroquet d’un navire, en s’appuyant contre les
échelons d’une forte échelle couchée fur le tillac.
Les autres détails du doéteur Defaguliers fiir les
tours d’adreffe, qui paffeht pour des tours de force
extraordinaires, font affez curieux ; mais je les fup-
prime, de crainte d’être trop long.
Pour donner une idée de la force des extenfeurs
des jambes, M. Defaguliers dit qu’on voit à Londres
les fiacres s’élancer hors de leurs fiéges dans un
embarras, 8c foule ver leur voiture aveG leur dos
fans le fecours de qui que ce foit ', quoiqu’ils ayent
quatre perfonnes dans leur carroffe, 8c le train char-’
gé de trois ou quatre coffres. Nos fiacres font de
même à Paris, 8c appellent cela porter leur derrière.'
Les porte-faix en Turquie portent fep t , huit, 8c1
jufqu’à néuf cents livres pefant. Ils s’appuient fur
Q