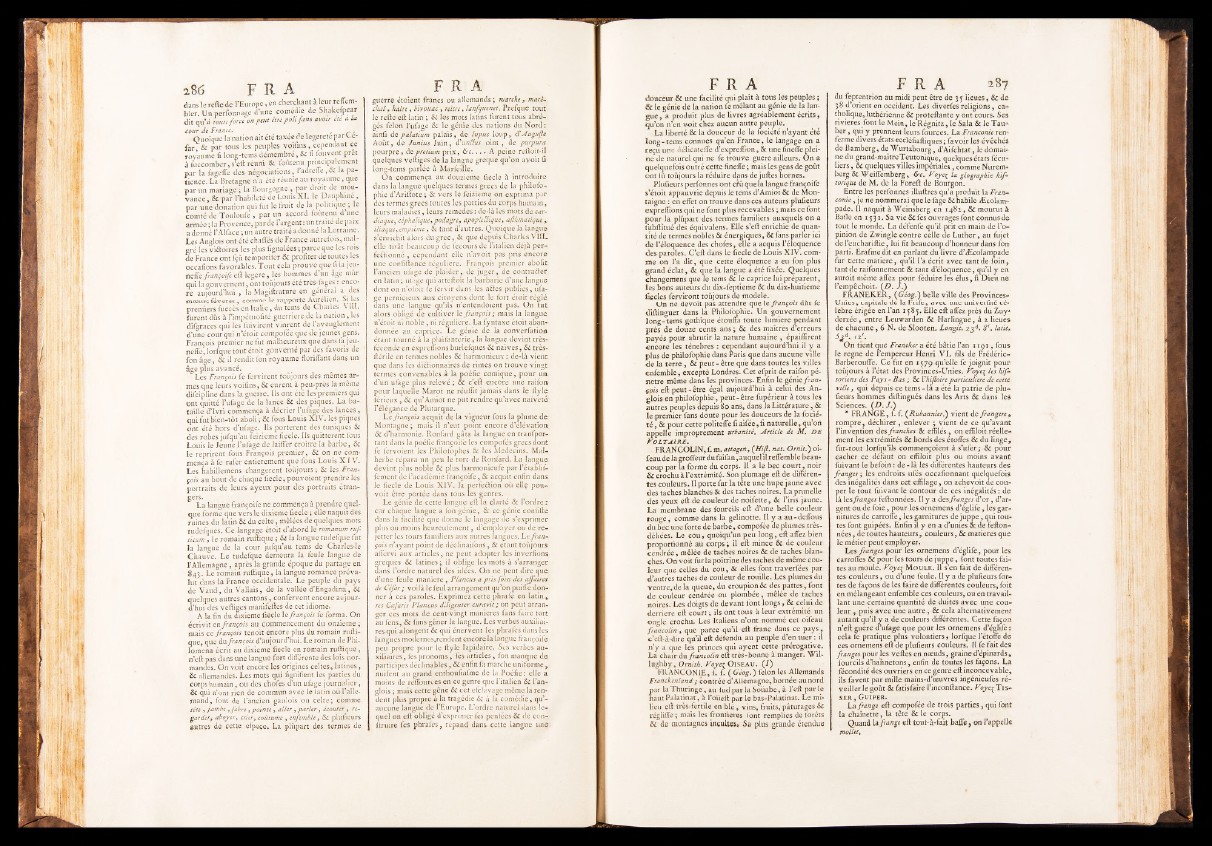
dansle refte de l’Europe, en chevctont à leur reffem-
bler. Un perfonnage .d’une -comeche de Shakeipear
dit qu’à toute force on f tut à n jpoh fans avoir .eu a La
cour de France. , , r ,
Quoique la nation ait été taxee de legerete pa r t_e-
far & par tous les peuples voifins, cependant ce
royaume fi long-tems démembré, & fi fouvent prêt
à Succomber, s’eft réuni & foûtenu principalement
par la fageffe des négociations, l’adreffe, 8c la patience,
l a Bretagne n’a été réunie au royaume, que
par un mariage-; la Bourgogne , par droit de mouvance,
& par l’habileté de Louis XI. le Dauphine,
par une donation qui fut le fruit de la politique ; le
comté de Touloufe , par un accord foûtenu d’une
armée ; la Provence, par de l’argent : un traité de paix
a donné PAlface ; un autre traité a donné la Lorraine,
t e s Anglois ont été chafles de France autrefois, malgré
les vi&oires les plus fignalées ; parce que les rois
de France ont fçû temporifer & profiter de toutes les
occafions favorables. Tout cela prouve que^fi la jeu-
neffz françoife eft legere, les hommes d’un âge mur
qui la gouvernent, ont toujours ete tres-fages : encore
aujourd’hui , la Magiftrature en général a des
moeurs féveres, comme le rapporte Aurélien. Si les
premiers fuccès en Italie, du tems de Charles VIII.
furent dûs à l’impétuofité guerriere de la nation, les
difgraces qui les fuivirent vinrent de 1 aveuglement
d’une cour qui n’étoit compofée que de jeunes gens.
François premier ne fut malheureux que dans fa jeu-
neffe, lorfque tout étoit gouverné par des favoris de
fon âge, 8c il rendit fon royaume floriffant dans un
âge plus avancé.
Les François fe fervirent toujours des mêmes armes
que leurs voifins, 8c eurent à-peu-près la même
difcipline dans la guerre. Ils ont été les premiers qui
ont quitté l’ufage de la lance 8c des piques. La bataille
d’Ivri commença à décrier l’ufage des lances,
qui fut bien-tôt aboli ; 8c fous Louis X IV . les piques
ont été hors d’ufage. Ils portèrent des tuniques 8c
des robes jufqu’au feizieme fiecle. Ils quittèrent fous
Louis le Jeune l’ufage de laifler croître la barbe, 8c
le reprirent fous François premier, 8c on ne commença
à.fe rafer entièrement que fous Louis X IV .
Les habillemens changèrent toujours ; 8c les François
au bout de chaque fiecle, pouvoient prendre les
portraits de leurs ayeux pour des portraits étrangers.
La langue françoife ne commença à prendre quelque
forme que vers le dixième fiecle ; elle naquit des
ruines du latin 8c du celte, mêlées de quelques mots
tudefques. Ce langage étoit d’abord le romanum ruf-
tieum, le romain ruftique ; 8c la langue tudefque fut
la langue de la cour jufqu’au tems de Charles-le
Chauve. Le tudefque demeura la feule langue de
l’Allemagne, après la grande époque du partage en
843. Le romain ruftique, la langue romance prévalut
dans la France occidentale. Le peuple du pays
de Vaud, du Vallais, de la vallée d’Engadina, 8c
quelques autres cantons, confervent encore aujourd’hui
des veftiges manifeftes de cet idiome.
A la fin du dixième fiecle 1 e/rançois fe forma. On
écrivit tu françois au commencement du onzième ;
mais ce françois tenoit encore plus du romain ruftique,
que du françois d’aujourd’hui. Le roman de Phi-
lomena écrit au dixième fiecle en romain ruftique,
n’eft pas dans une langue fort différente des lois normandes.
On voit encore les origines celtes, latines,
8c allemandes. Les mots qui fignifient les parties du
corps humain, ou des chofes d’un ufage journalier,
ôc qui n’ont rien de commun avec le latin oü l’allemand,
font de l’ancien gaulois ou celte; comme
tête , jambe , faire , pointe , aller , parler , écouter, regarder,
aboyer, crier, coutume , enfemble , 8c plufieurs
autres de cette efpece. La plupart des termes de
guerre étoient francs ou allemands ; marche , maréchal,
halte, bivouac ,reitre, lanfquenet. Prefque tout
le refte eft latin ; 8c les mots latins furent tous abrégés
félon l’ufage 8c le génie des nations du Nord:
ainfi de palatium palais, de lupus loup, d'Augufie.
Août, de Junius Juin, àéunctus oint , de purpura
pourpre, de pretium prix, &c. . . . A peine reftoit-il
quelques veftiges de la langue greque qu’on avoit û
long-tems parlée à Marfeille.
On commença au douzième fiecle à introduire
dans la langue quelques termes grecs de la philofo-
phie d’Ariftote ; 8c vers le feizieme on exprima par
des termes grecs toutes les parties du corps humain,
leurs maladies, leurs remedes : de-là les mots de cardiaque,
céphalique, podagre, apoplectique, aflhmatique ,
iliaque, ernpième, 8c tant d’autres. Quoique la langue
s’enrichît alors du grec, 8c que depuis Charles VIII.
elle tirât beaucoup de fecours de l’italien déjà per-
feftionné , cependant elle n’avoit pas pris encore
une confiftance régulière. François premier abolit
l’ancien ufage de plaider, de juger, de contra&er
en latin; utage qui atteftoit la barbarie d’une langue
dont on n’oioit fe fervir dans les aftes publics, ufage
pernicieux aux citoyens dont le fort étoit réglé
dans une langue qu’ils n’entendoient pas. On fut
alors obligé de cultiver le françois ; mais la langue
n’étoit ni noble , ni régulière. La fyntaxe étoit abandonnée
au caprice. Le génie de la converfation
étant tourné à la plaifanterie, la langue devint très-
féconde en expreffions burlefques 8c naïves, 8c très-
ftérile en termes nobles 8c harmonieux : de-là vient
que dans les diâionnaires de rimes on trouve vingt
termes convenables à la poéfie comique, pour un
d’un ufage plus relevé;.8c c’eft encore une raifon
pour laquelle Marot ne réuflit jamais dans le ftyle
férieux, 8c qu’Amiot ne put rendre qu’avec naïveté
l’élégance de Plutarque.
Le français acquit de la vigueur fous la plume de
Montagne ; mais il n’eut point encore d’élévation.
8c d’harmonie. Ronfard gâta la langue en tranfpor-
tant dans la poéfie françoife les compofés grecs dont
fe fervoient les Philofophes 8c les Médecins. Malherbe
répara un peu le tort de Ronfard. La langue
devint plus noble 8c plus harmonieufe par l’établif-
fement de l’académie françoife, 8c acquit enfin dans
le fiecle de Louis XIV. la perfeÛion où ellç pou-
voit être portée dans tous les genres.
Le génie de cette langue eft la clarté 8c l’ordre :
car chaque langue a fon génie, 8c ce génie confifte
dans la facilité que donne le langage de s’exprimer
plus ou moins heureufement, d’employer ou de re-
jetter les tours familiers aux autres langues. Le françois
n’ayant point de déclinaifons, 8c étant toujours
affervi aux articles, ne peut adopter les inverfions
greques 8c latines ; il oblige les mots à s’arranger
dans l’ordre naturel des idées. On ne peut dire que
d’une feule maniéré, Plancus a pris foin des affaires
de Céfar ; voilà le feul arrangement qu’on puifle donner
à ces paroles. Exprimez cette phrafe en latin,
res Ccefaris Plancus diligenter curavit; on peut arranger
ces mots de cent-vingt maniérés fans faire tort
au fens, 8c fans gêner la langue. Les verbes auxiliaires
qui alongent 8c qui énervent les phrafes dans les
langues modernes,rendent encore la langue françoife
peu propre pour le ftyle lapidaire. Ses verbes auxiliaires
, fes pronoms , fes articles, fon manque de
participes déclinables, 8c enfin fa marche uniforme,
nüifent au grand enthoufiafme de la Poéfie : elle a
moins de reffources en ce genre que l’italien 8c l’an-
glois ; mais cette gêne 8c cet efcla vage même la rendent
plus propre à la tragédie 8c à la comédie, qu’aucune
langue de l’Europe. L’ordre naturel dans lequel
on eft obligé d’exprimer fes penfées 8c de con-,
ftruire fes phrafes, répand dans cette langue une :
doucéür 8c une facilité qui plaît à tous les peuplés ;
& le génie de la nation fe mêlant au génie de la langue
, a produit plus de livres agréablement écrits,
qu’on n’en voit chez aucun autre peuple.
La liberté 8c la douceur de la focieté n’ayant été
long-tems connues qu’en France, le langage en a
reçu une délicateffe d’expreflion, 8c une finefle pleine
de naturel qui ne fe trouve guere ailleurs* On a
quelquefois outré cette finefle ; mais les gens de goût
ont fû toûjours la réduire dans de juftes bornes.
Plufieurs perfonnes Ont crû que la langue françoife
s’étoit appauvrie depuis le tems d’Amiot 8c de Montaigne
: en effet on trouve dans ces auteurs plufieurs
expreflions qui ne font plus recevables ; mais ce font
pour la plûpart des termes familiers auxquels on a
fubftitué des équivalens. Elle s’eft enrichie de quantité
de termes nobles 8c énergiques, 8c fans parler ici
de l’éloquence des chofes, elle a acquis l’éloquence
des paroles. C’eft dans le fiecle de Louis X IV. comme
on l’à dit, que cette éloquence a eu fon plus
grand éclat, 8c que la langue a été fixée. Quelques
changemens que le tems 8c le caprice lui préparent ,
les bons auteurs du dix-feptieme 8c du dix-huitieme
liecles ferviront toûjours de modèle.
On ne devoit pas attendre que le françois dût fe
diftinguer dans la Philofophie. Un gouvernement
long-tems gothique étouffa toute lumière pendant
près de douze cents ans ; 8c des maîtrés d’erreurs
payés pour abrutir la nature humaine , épaiflïrent
encore les ténèbres : cependant aujourd’hui il y a
plus de philofophie dans Paris que dans aucune ville
de la terre, 8c peut - être que dans toutes les villes
enfemble, excepté Londres. Cet efprit de raifon pénétré
même dans les provinces. Enfin le génie fran*
çois eft peut-être égal aujourd’hui à celui des Anglois
en philofophie, peut-être fupérieur à tous les
autres peuples depuis 80 ans, dans la Littérature, 8c
le premier fans doute pour les douceurs de la focié-
t é , 8c pour cette politeffe fi aifée, fi naturelle, qu’on
appelle improprement urbanité. Article de M. DE
V o l t a i r e .
FRANCOLIN,f. m. attagen, fHift. nat. Omit.) ob
feau de la groffeur du faifan, auquel il reffemble beaucoup
par la forme du corps. Il a le bec court, noir
& crochu à l’extrémité. Son plumage eft de différentes
couleurs. Il porte fur la tête une hupe jaune avec
des taches blanches 8c des taches noires. La prunelle
des yeux eft de couleur de noifette, 8c l’iris jaune.
La membrane des fourcils eft d’une belle couleur
rouge, comme dans la gelinotte. Il y a au-deflous
du bec une forte de barbe, compofée de plumes très-
déliées. Le cou , quoiqu’un peu long, eft affez bien
proportionné au corps ; il eft mince & de couleur
cendrée, mêlée de taches noires 8c de taches blanches.
On voit fur la poitrine des taches de même couleur
que celles du cou, 8c elles font traverfées par
d’autres taches de couleur de rouille. Les plumes du
ventre,de la queue, du croupion 8c des pattes, font
de couleur cendrée ou plombée, mêlée de taches
noires. Les doigts de devant font longs, 8c celui de
derrière eft court ; ils ont tous à leur extrémité un
ongle crochu. Les Italiens n’ont nommé cet oifeau
francolin, que parce qu’il eft franc dans ce pays ,
c ’ eft-à-dire qu’il eft détendu au peuple d’en tuer : il
n’y a que les princes qui ayent cette prérogative.
La chair du francolin eft très-bonne à manger. ‘Wil-
lughby, Ornith. Voye{OlSTLA\J. (/)
FRANCON1E , f. f. ( Géog.) félon les Allemands
Franckenland ; contrée d’Allemagne, bornée au nord
par la Thuringe, au lud par la Soiiabe, à l’eft par le
haut Palatinat, à l’oiieft par le bas-Palatinat. Le milieu
eft très-fertile en blé, vins, fruits, pâturages 8c
réglifle ; mais les frontières font remplies de forêts
8c de montagnes incultes, Sa plus grande étendue
du feptehtrion au midi peut être de 3 5 lieues, 8c de
3 8 d’orient en occident. Les diverfes religions, catholique,
luthérienne 8c proteftante y ont cours. Ses
rivières font le Mein, le R égnitz, le Sala 8t le Tau*
b e r , qui y prennent leurs fources. La Franconie rém
ferme divers états eccléfiaftiques ; fa voir les évêchés
de Bamberg, de'Wurtzbourg, d’Aifchtat, le domaine
du grand-maître Teutonique, quelques états fécu-
liers, 8c quelques villes impériales, comme Nurem*
berg 8c Weiffemberg, &c. Voyeç la géographie hiff
torique de M. de la Foreft de Bourgon.
Entre les perfonnes illuftres qu’a produit la Franconie
, je ne nommerai que le fage 8c habile Æcolant-
pade. Il naquit à Weinsberg en 14 8 2 ,8c mourut à
Balle en 15 31. Sa vie 8c fes ouvrages font connus de
tout le monde. La défenfe qu’il prit en main de l’opinion
de Zwingle contre celle de Luther, au fujet
de l’euchariftie, lui fit beaucoup d’honneur dans fon
parti. Erafmedit en parlant du livre d’Æcolampade
fur Cette matière, qu’il l ’a écrit avec tant de foin,
tant de raifonnement & tant d’éloquence, qu’il y en
auroit même allez pour féduire les élus, fi Dieu ne
l’empêchoit. (D . ƒ.)
FRANEKER, {Géog.) belle ville des Provinces-»
Unies, capitale de la F rife, avec une univerfité cé-»
lebre érigée en l’an 1585. Elle eft allez près du Zuy*
derzée, entre Leuvarden 8c Harlingue, à 2 lieues
de chacune, 6 N. de Slooten. Longit. 23 d» 8'. laiit.
i^ d. 12'.
On tient que Frartéker a été bâtie l’an 1 19 1 , fous
le régné de l’empereur Henri V I . fils de Frédéric-
Barberoufle. Ce fut en 1579 qu’elle fe joignit pour
toûjours à l’état des Provinces-Unies. Voye[ les hiff
toriens des Pays- Bas ; Sc Yhijloire particulière de cette
ville , qui depuis ce tems - là a été la patrie de plufieurs
hommes diftingués dans les Arts 8c dans les
Sciences. (D . ƒ.)
* FRANGE, 1. f. (Rubannier.) vient de frangere ,
rompre, déchirer, enlever ; vient de ce qu’avant
l’inveption des franches 5c effilés, on effiloit réelle-»
ment les extrémités 8c bords des étoffes 8c du linge,
fur-tout lorfqu’ils commençoient à s’ufer ; 8c pour
cacher ce défaut on effiloit plus ou moins avant
fuivant le befoin : de - là les différentes hauteurs des
franges ; les endroits ufés occafionnant quelquefois
des inégalités dans cet effilage, on achevoit de couper
le tout fuivant le contour de ces inégalités : de
là les franges feftonnées. Il y a des franges d’o r , d’ar*
gent ou de foie, pour les ornemens d’églife, les garnitures
de carroffe, les garnitures de juppe, qui toutes
font guipées. Enfin il y en a d’unies & de feftonnées,
de toutes hauteurs, couleurs, 8c matières que
le métier peut employer.
Les franges pour les ornemens d’églife, pour les
carrofles 8c pour les tours de juppe, font toutes faites
au moule. Voye^ Moule. Il s’en fait de différentes
couleurs, ou d’une feule. Il y a de plufieurs fortes
de façons de les faire de différentes couleurs, foit
en mélangeant enfemble ces couleurs, ou en travaillant
une certaine quantité de duites avec une couleur
, puis avec une autre, 8c cela alternativement
autant qu’il y a de couleurs différentes. Cette façon
n’eft guere d’ufage que pour les ornemens d’églife :
cela 1e pratique plus volontiers, lorfque l’étoffe de
ces ornemens eft de plufieurs couleurs. Il fe fait des
franges pour les veftes en noeuds, graine d’épinards,
fourcils d’hannetons, enfin de toutes les façons. Là
fécondité des ouvriers en ce genre eft inconcevable,
ils favent par mille mains-d’oeuvres ingénieufes réveiller
le goût & fatisfaire l’inconftance. Voye^ Tisser,
Guiper.
La frange eft compofée de trois parties, qui font
la chaînette, la tête 8c le corps.
Quand la frange eft tout-à-fait baffe, on l’appelle
mollet,