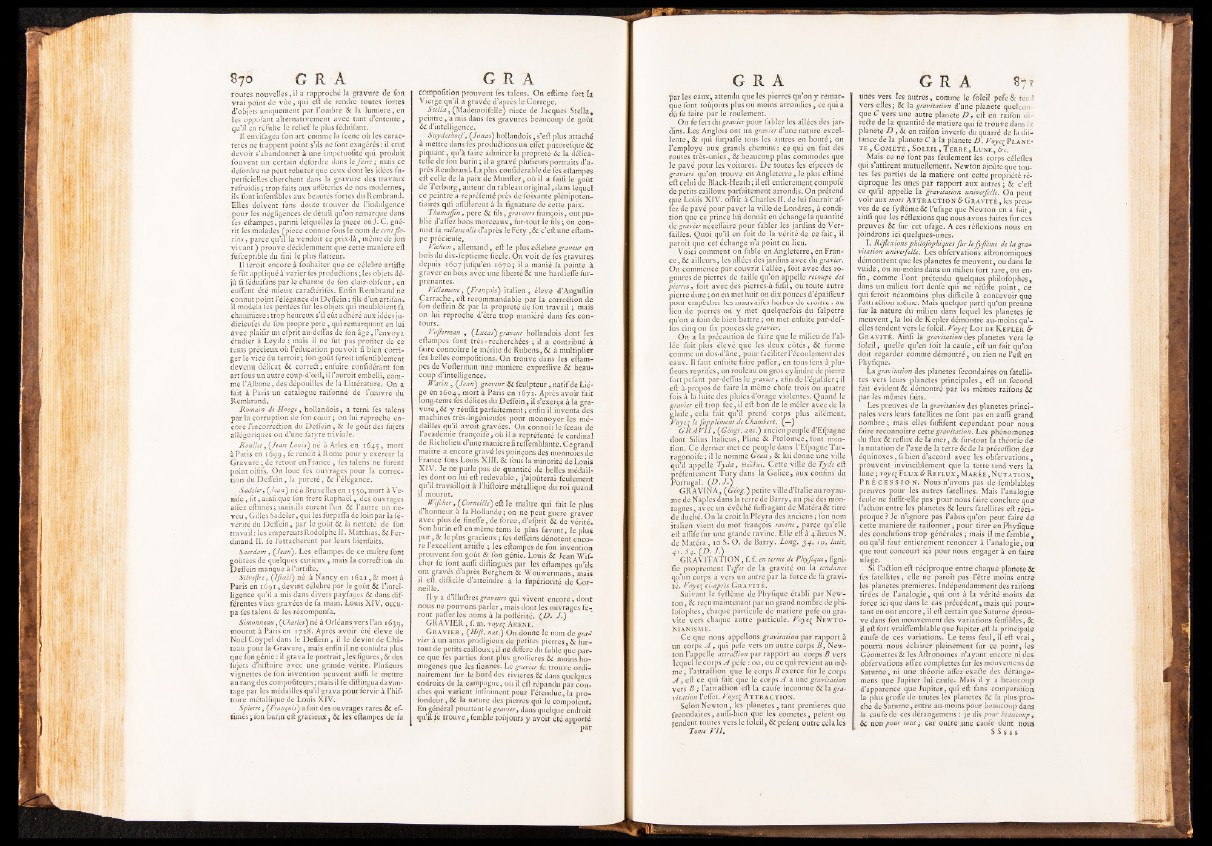
routes nouvelles, il a rapproché la gravure de fon
vrai point de vu e, qui elt de rendre toutes fortes
d’objets uniquement par l’ombre & la lumière, en
les oppofant alternativement avec tant d’entente,
qu’il en -réfuite le relief le plus féduifant.
Il envifagea fon art comme la fcene où les caractères
ne frappent point s’ils ne font exagérés : il crut
devoir s’abandonner à une impétuofité qui produit
fouvent un certain defordre dans le faire; mais ce
defordre ne peut rebuter que ceux dont les idées fu-
perfkielles cherchent dans la gravure des travaux
refroidis; trop faits aux afféteries de nos modernes,
ils font infenfîbles aux beautés fortes du Rembrand.
Elles doivent fans doute trouver de l’indulgence
pour les négligences de détail qu’on remarque dans
les eftampes, parmi lefquelles la piece où J. C . guérit
les malades (piece connue fous le nom de centflorins
> parce qu’il la vendoit ce prix-là, même de fon
vivant) prouve décidemment que cette maniéré eft
fufceptible du fini le plus flatteur.
Il feroit encore à fouhaiter que ce célébré artifte
fe fut appliqué à varier fes productions ; les objets déjà
fi féduifans par le charme de fon clair-obfcur, en
enflent été mieux caraCtérifés. Enfin Rembrand ne
connut point l’élégance du Deflein ; fils d’un artifan,
il modela fes penlées fur les objets qui meubloient fa
chaumière : trop heureux s’il eût adhéré aux idées ju-
dicieufes de fon propre pere, qui remarquant en lui
avec plaifir un efprit au-defliis de fon âge, l’envoya
étudier à Leyde ; mais il ne fut pas profiter de ce
tems précieux où l’éducation pouvoit fi bien corriger
le vice du terroir; fon goût feroit infenfiblement
devenu délicat 6c çorreCt ; enfuite confidérant fon
art fous un autre coup-d’oeil, ill’auroit embelli, comme
l’Albane, des dépouilles de la Littérature. On a
fait à Paris un catalogue raifonné de l’oeuvre du
Rembrand.
Romain de Hooge , hollandois, a terni fes talens
par la corruption de fon coeur ; on lui reproche encore
l’incorreCtion du Deflein, & le goût des fujets
allégoriques ou d’une fatyre triviale.
Roullet, ( Jean Louis) né à Arles en 1645 , mort
à Paris en 1699, fe rendit à Rome pour y exercer la
Gravure ; de retour en France , fes talens ne furent
point oififs. On loue fés ouvrages pour la correction
du D eflein, la pureté, 6c l’élégance.
Sadeler, (Jean) né à Bruxelles en 15 50, mort à Ve-
nife, fit, ainfi que fon ffere Raphaël, des ouvrages
allez eftimés; mais,ils eurent l’un 6c l’autre un neveu
, Gilles Sadeler, qui les furpaffa de loin par la fé-
vérité du Deflein, par le goût & la netteté de fon
travail : les empereurs Rodolphe II. Matthias, 6c Ferdinand
II. fe l’attachèrent par leurs bienfaits.
Saerdam, (Jean). Les eftampes de ce maître font
goûtées de quelques curieux, mais la correction du
Deflein manque à l’artifte.
SUvejlre, (Ifraël) né à Nancy en 16 2 1 ,& mort à
Paris en 1691, devint célébré par le goût 6c l’intelligence
qu’il a mis dans divers payfages 6c dans différentes
vûes gravées de fa main. Louis XIV, occupa
fes talens & les récompenfa.
Simonneau, ('Charles) né à Orléans vers l’an 1639,
mourut à Paris en 1718. Après avoir été éleve de
NoëlCoypel dans le Deflein , il le devint de Château
pour la Gravure, mais enfin il ne confulta plus
que fon génie : il grava le portrait, les figures, & des
ïujets d’hiftoire avec une grande vérité. Plufieurs
vignettes de fon invention peuvent aufli le mettre
au rang des compofite^irs ; mais il fe diflingua davantage
par les médailles qu’il grava pour fervir à l’hif-
toire métallique de Louis XIV.
S pierre, (François) a fait des ouvrages rares & ef-
timés ; fon burin eft gracieux, 6c les eftampes de fa
compofition prouvent fes talens. On eftime fort la
Vierge qu’il a gravée d’après le Correge.
Stella, (Mademoifelle) niece de Jacques Stella,
peintre, a mis dans fes gravures beaucoup de goût
6c d’intelligence.
Suyderhoef, (Jonas) hollandois, s’ eft plus attaché
à mettre dans fes productions un effet pittorefque 6c
piquant, qu’à faire admirer la propreté 6c la délica-
tefle de fon burin ; il a gravé plufieurs portraits d’après
Rembrand. La plus confidérable de fes eftampes
eft celle de la paix de Munfter, où il a faifi le goût
de Terburg, auteur du tableau original, dans lequel
ce peintre a repréfenté près de foixante plénipotentiaires
qiti affifterent à la fignature de cette paix.
ThomaJJîn, pere 6c fils, graveurs françois, ont publié
.d’affez bons morceaux, fur-tout le fils ; on con-
noit fa mélancolie d’après le Féty ,& c’eft une eftam-
pe précieufe,
Vichem, allemand, eft le plus célébré graveur en
bois du dix-feptieme fiecle. On voit de fes gravures
depuis léoyjufqu’en 1670; il a manié la pointe à
graver en bois avec une liberté 6c une hardiefle fur-
prenantes.
Fillamene, (françois) italien , éleve d’Auguftin
Carrache, eft recommandable par la correction de
fon deflein & par la propreté de fon travail ; mais
on lui reproche d’être trop maniéré dans fes con-,
tours.
Vofterman , (Lucas) graveur hollandois dont les
eftampes font très-recherchées ; il a contribué à
faire connoître le mérite de Rubens, 6c à multiplier
fes belles compofitions. On trouve dans les eftampes
de Vofterman une maniéré expreflive 6c beaucoup
d’intelligence.
TVarin , (Jean) graveur 6c fculpteur, natif de Liège
en 1604 , mort à Paris en 1672. Après avoir fait
long-tems fès délices du Deflein, il s’exerça à la gravure
, & y réufîit parfaitement ; enfin il inventa des
machines très-ingénieufes pour monnoyer les médailles
qu’il avoit gravées. On connoît le fceau de
l’académie françoile, où il a repréfenté le cardinal
de Richelieu d’une maniéré fi reflemblante. Ce grand
maître a encore gravé les poinçons des monnoies de
France fous Louis XIII. & fous la minorité de Louis
XIV. Je ne parle pas de quantité de belles médailles
dont on lui eft redevable, j’ajoûterai feulement
qu’il travailloit à l’hiftoire métallique du roi quand
il mourut.
Wifcher, (Corneille) eft le maître qui fait le plus
d’honneur à la Hollande ; on ne peut guere graver
avec plus de fineffe , de force ,.d’efprit 6c de vérité.
Son burin eft en même tems le plus favant, le plus
pur, & le plus gracieux ; fes defleins dénotent encore
l’excellent artifte ; les eftampes de fon invention
prouvent fon goût & fon génie. Louis 6c Jean Wifcher
fe font aufli diftingués par les eftampes qu’ils
ont gravés d’après Berghem & Woiiwermans, mais
il eft difficile d’atteindre à la fupériorité de Corneille.
Il y a d’illuftres graveurs qui vivent encore, dont
nous ne pouvons parler, mais dont les ouvrages feront
pafîer les noms à la poftérité. (D . J.)
GRAVIER, f. m. voye[ ARENE.
G ravier , (Hifl. nat.) On donne le nom de gra~
vier à un amas prodigieux de petites pierres, & fur-
tout de petits cailloux ; il ne différé du fable que parce
que fes parties font plus groflïeres & moins homogènes
que les fiennes. Le gravier fe trouve ordinairement
fur le bord des rivières 6c dans quelques
endroits de la campagne, oit il eft répandu par couches
qui varient infiniment pour l’étendue, la profondeur
, 6c la nature des pierres qui le compofent.
En général pourtant le gravier, dans quelque endroit
qu’il fe trouve, femble toujours y avoir été apporté
par
par les eaux, attendu que les pierres qu’on ÿ remarque
font toûjours plus ou moins arrondies, ce qui a
dû fe faire par le roulement.
On fe fert du gravier pour fablér les allées des jardins.
Les Anglois ont un gravier d’une nature excellente,
& qui furpafle tous les autres en bônté; on
l’employe aux grands chemins: ce qui en'fait des
routes très-unies, 6c beaucoup plus commodes que
le pavé pour les voitures. De toutes les efpeces de
graviers qu’on trouve en Angleterre, le plus eftimé
eft celui de Black-Heath; il eft entièrement compofé
de petits cailloux parfaitement arrondis. On prétend
que Louis XIV. offrit à Charles IL de lui fournir af-
iez de pavé pour paver la ville de Londres, à condition
que ce prince lui donnât en échange la quantité
de gravier néceffaire pour fabler les jardins de Ver-
failles. Quoi qu’il en foit de la vérité de ce fait, il
paroît que cet échange n’a point eu lieu.
Voici comment on fable en Angleterre, en Franc
e , & ailleurs, les allées des jardins avec du gravier.
On commence par couvrir l’allée, foit avec des rognures
de pierres de taille qu’on appelle recoupe des
pierres, foit avec des pierres-à-fufil, ou toute autre
pierre dure ; on en met huit ou dix pouces d’épaifleur
pour empêcher les mauvaifes herbes de croître : au
lieu de pierres on y met quelquefois du falpetre
qu’on a foin de bien battre ; on met enfuite par-def-
fus cinq ou fix pouces de gravier.
On a la précaution de faire que le milieu de l’allée
foit plus élevé que les deux côtés, 6c forme
comme un dos-d’âne, pour faciliter l’écoulement des
eaux. Il faut enfuite faire palier, en tous fens à plufieurs
reprifes, un rouleau ou gros cylindre de pierre
fort pefant par-deffus le gravier, afin de l’égalifer ; il
eft à-propos de faire la même chofe trois ou quatre
fois à la fuite des pluies d’orage violentes. Quand le
gravier eft trop fec, il eft bon de le mêler avec de la
glaife, cela fait qu’il prend corps plus aifément,
Foyer le fupplément de Chambers. (—)
G R A V I I y (Géogr. anc.) ancien peuple d’Elpagne
dont Silius Italicus, Pline & Ptolomée, font mention.
Ce dernier met ce peuple dans l’EfpagneTar-
ragonoife ; il le nomme Graii, & lui donne une ville
qu’il appelle Tydtz, QovS'ai. Cette ville de Tyde eft
préfentement Tury dans la Galice, aux confins du
Portugal. (D .J .)
GRAVINA, (Géog.) petite ville d’Italie au royaume
de Naples dans la terre de Barry, au pie dès montagnes,
avec un évêché fuffragant de Matéra & titre
de duché. On la croit la Pleyra des anciens ; fon nom
italien vient du mot françois ravine, parce qu’elle
eft aflife fur une grande ravine. Elle eft à 4 lieues N.
de Matéra, 10 S. O. de Barry. Long. 34 . 10. latit.
41.64- (D . J.)
G RAVITATION, f. f. en terme de Phyfque, figni-
fie proprement Y effet de la gravité ou la tendance
qu’un corps a vers un autre par la force de fa gravité.
Foye^ ci-après GRAVITÉ.
Suivant le fyftème de Phyfique établi par N ewton
, 6c reçu maintenant par un grand nombre de phi-
lofophes, chaque particule de matière pefe ou gravite
vers chaque autre particule. Foyc^ Newto-
n ian ism e .
Ce que nous appelions gravitation par rapport à
un corps A , qui pefe vers un autre corps B , Newton
l’appelle attraction par rapport aii corps B vers
lequel le corps A pefe : ou , ou ce qui revient au mè:
me, l’attraCtion que le corps B exerce fùr le corps
A y eft ce qui fait que le corps A a une gravitation
vers B ; l’attraCtion eft la caufe inconnue 6c la gravitation
l’effet. Foye% A t t r a c t io n .
Selon Newton, les planètes , tant premières que
fecondaires, auffi-bien que les cometes, pefent ou.
tendent toutes vers le foleil, 6c pefent outre cela les
Tome F IL
uhès vèrs les autres, comme le foleiî pefe & tend
vers elles; 6c la gravitation d’une planète quelconque
C vers une autre planete J j y eft en raifon directe
de la quantité de matière qui fé trouvé dans la
planète D , & en raifon inverfe du quarrë de la dif-
tance de la plahete C à la planete D . Foye{ Pl a n è t
e , C o m e t e , S o l e i l , T e r r e , L u n e , & c .
Mais ce né font pas feulement les corps céleftes
qüi s’attirent mutuellement. Newton ajoûieque toutes
les parties de la matière ont cette propriété réciproque
les unes par rapport aux autres ; & c’eft
ce qit’il apjpellè la "gravitation univerfeUe. On peut
voir aux mots A t t r a c t io n & G r a v it é , les preu-*
ves de ce fyftème 6c l’ufage que Newton en a fait,
ainfi que les réflexions que nous avons faites fur ces
preuves 6c fur cet ufage. A ces réflexions nous en
joindrons ici quelques-unes.
I. Réflexions philofophiques fur le fyftème de la gra»
vitation univerfelle. Les obfervations aftronomiques
démontrent que les planètes fe meuvent, ou dans le
vuide, ou au-moins dans un milieu fort rare, oii en*
fin, Comme l’ont prétendu quelques philofophes,
dans un milieu fort denfe qui ne rèfifte point, ce
qui feroit néanmoins plus difficile à concevoir que
l’attraâion même. Mais quelque parti qu’on prenne
fur la nature du milieu dans lequel les planètes fe
meuvent, la loi de Kepler démontre au-moins qu’elles
tendent vers le foleil. F o y e ^ L o i de K e p le r &
G r a v i t é . Ainfi la gravitation des planètes vers le
foleil, quelle qu’en foit la caufe, eft un fait qu’on
doit regarder comme démontré, ou rien ne l’eft en
Phyfique.
La gravitation des planètes fecondaires ou f a i l li tes
vers leurs planètes principales, eft un fécond
fait évident & démontré par les mêmes raifons 6c
pâr les mêmes faits-.
Les preuves de la gravitation des planètes principales
vers leurs fatellites ne font pas en aufli grand
nombre ; mais elles fuffifent Cependant pour nous
faire recortnoître cette gravitation. Les phénomènes
du flux 6c reflux de la mer, & fur-tout la théorie de
la nutation de l’axe de la terre & d e la préceflïon des
équinôxes, fi bien d’accord avec les obfervations ,
prouvent invinciblement que la terre tend vers la
lune ; voyeçF l u x # R e f l u x , Ma r é e ,N u t a t io n
P r é c e s s i o n . Nous n’avons pas de femblableâ
preuves pour les autres fatellites. Mais l’analogie
feule-ne luffit-èlle pas pour nous faire conclure que
Faûion entre les planètes 6c leurs fatellites eft réciproque
} Je n’ignore pas l’abus qu’on peut faire de
Cette maniéré de raifonner, pour tirer en Phyfique
des conclufions trop générales ; mais il me femble ,
ou qu’il faut entièrement renoncer à l’analogie, ou
que tout concourt ici pour nous engager à en faire
ufage.
. Si l’aôion eft réciproque entre chaque planete &
fes fatellites , elle ne paroît pas l’être moins entre
les planètes premières. Indépendamment des raifons
tirées de l’analogie, qui ont à la vérité moins de
force ici que dans le cas précédent, mais qui pourtant
en ont encore, il eft certain que Saturne éprouve
dans fon mouvement des variations fenfibles, &
il eft fort vraiflemblable que Jupiter eft la principale
caufe de ces variations. Le tems feul, il eft v rai,
pourra nous éclairer pleinement fur ce point, les
Géomètres & les Àftronomes n’ayant encore ni des
obfervations allez complettes fur les mouvemens de
Saturne , ni une théorie àflez exafte des dérange-
mens que Jupiter lui caufe. Mais il y a beaucoup
d’apparence que Jupiter, qui eft fans comparàifon
la plus groffe de toutes les planètes 6c la plus proche
de Saturne, entre au-moins pour beaucoup dans
la caufe de ces dérangemens : je dis pour beaucoup ,
6c non pour tout; car outre .une caufe dont nous
S S s s s