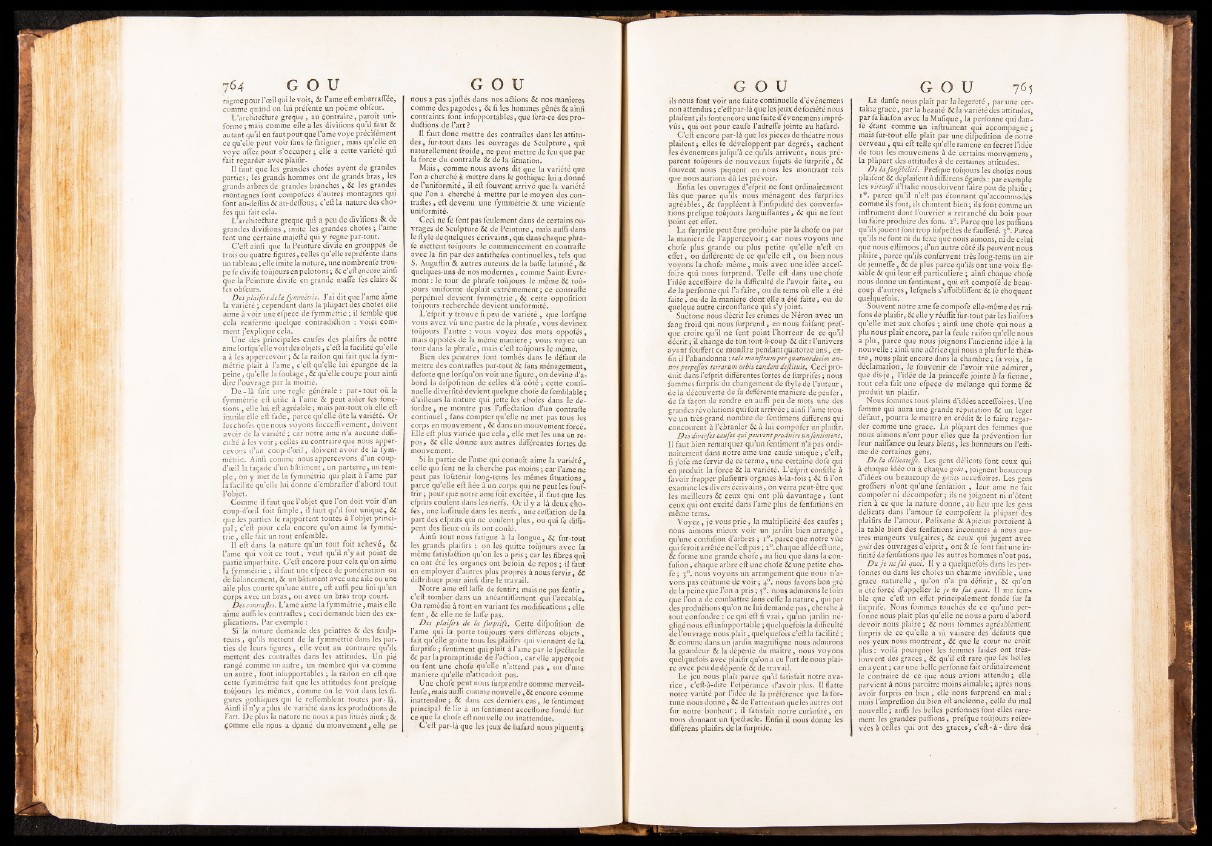
nigme pour l’oeil qui le voit, & l’ame eft embarraffée,'
«m m e quand on lui préfente un poëme obfcur.
L ’architeéhire greque, au contraire, paroît uniforme
; mais comme elle a les divifions qu’il faut &
autant qu’il en faut pour que l’ame voye précifément
ce qu’elle peut voir fans lé fatiguer, mais qu’elle en
voye allez pour s’occuper ; elle a cette variété qui
-fait regarder avec plaifir.
II faut que les grandes chofes ayent de grandes
parties ; les grands hommes ont de grands bras, les
grands arbres de grandes branches , ôc les grandes
montagnes font compofées d’autres montagnes qui
font au-deffus ôc au-deffous; c’eftla nature des chofes
qui fait cela.
L’archite&ure greque qui a peu de divifions & de
grandes divifions , imite les grandes chofes ; l’ame
fent une certaine majefté qui y régné par-tout.
C’eft ainfi que la Peinture divil'e en grouppes de
trois ou quatre figures, celles qu’elle repréfente dans
un tableau ; elle imite la nature, une nombreufe troupe
fe divife toujours en pelotons ; ôc c’eft encore ainfi
que la Peinture divife en grande maffe fes clairs ôc
les obfcurs.
De s plaijîrs de la fymmètrie. J’ai dit que l’ame aime
la variété ; cependant dans la plupart des chofes elle
aime à voir une efpece de fymmètrie ; il femble que
cela renferme quelque contradiction : voici comment
j’explique cela.
Une des principales caufes des plaifirs de notre
ame lorfqu’elle voit des objets, c’eft la facilité qu’elle
a à les appercevoir ; Ôc la raifon qui fait que la fym-
métrie plaît à l’ame, c’eft qu’elle lui épargne de la
peine, qu’elle la foulage, ôc qu’elle coupe pour ainfi
dire l’ouvrage par la moitié.
D e - là fuit une réglé générale : par-tout otila
fymmètrie eft utile à l’ame & peut aider fes fonctions
, elle lui eft agréable ; mais par-tout où elle eft
inutile elle eft fade, parce qu’elle ôte la variété. Or
les chofes que nous voyons fucceflivement, doivent
avoir de la variété ; car notre ame n’a aucune difficulté
à les voir ; celles au contraire que nous apper-
cevons d’un coup-d’oe il, doivent avoir de la fym-
métrie. Ainfi comme nous appercevons d’un coup-
d’oeil la façade d’un bâtiment, un parterre, un temple
, on y met de la fymmètrie qui plaît à l’ame par
la facilité qu’elle lui donne d’embraffer d’abord tout
l’objet.
Comme il faut que l’objet que l’on doit voir d’un
coup-d’oeil foit fimple, il faut qu’il foit unique, ÔC
que les parties fe rapportent toutes à l’objet principal
; c’eft pour cela encore qu’on aime la fymmé-
trie, elle fait un tout enfemble.
Il eft dans la nature qu’un tout foit achevé, ôc
l’ame qui voit ce tou t, veut qu’il n’y ait point de
partie imparfaite. C ’eft encore pour cela qu’on aime
la fymmètrie ; il faut une efpece de pondération ou
de bàlancement, & un bâtiment avec une aile ou une
aile plus courte qu’une autre, eft auffi peu fini qu’un
corps avec un bras, ou avec un bras trop court.
Descontrafles. L’ame aime la fymmètrie, mais elle
aime aufli les contraftes ; ceci demande bien des explications.
Par exemple :
Si la nature demande des peintres & des fculp-
teurs, qu’ils mettent de la fymmètrie dans les parties
de leurs figures, elle veut au contraire qu’ils
mettent des contraftes dans les attitudes. Un pié
rangé comme un autre, ùn membre qui va comme
un autre, font infupportables ; la raifon en eft que
cette fymmètrie fait que les attitudes font prefque
toujours les mêmes, comme on le voit dans les figures
gothiques qui fe reffemblent toutes par-là.
Ainfi il n’y a plus de variété dans les productions de
l’art. De plus la nature ne nous a pas fitués ainfi ; &
çomme elle nous a dpnnc du mouvement, elle ne
nous a pas ajuftés dans nos actions ôc nos maniérés
comme des pagodes ; & fi les hommes gênés ôc ainfi
contraints font infupportables , que fera-ce des productions
de l’art ?
Il faut donc mettre des contraftes dans les attitudes
, fur-tout dans les ouvrages de Sculpture, qui
naturellement froide, ne peut mettre de feu que par
la force du contrafte ôc de la fituation.
Mais, comme nous avons dit que la variété que
l’on a cherché à mettre dans le gothique lui a donné
de l’uniformité, il eft fouvent arrivé que la variété
que l’on a cherché à mettre par le moyen des contraftes
, eft devenu une fymmètrie & une vicieufe
uniformité.
Ceci ne fe fent pas feulement dans de certains ouvrages
de Sculpture ôc de Peinture, mais auffi dans
le ftyle de quelques écrivains, qui dans chaque phra-
fe mettent toujours le commencement en contrafte
avec la fin par des antithefes continuelles, tels que
S. Auguftin & autres auteurs de la baffe latinité, &
quelques-uns de nos modernes, comme Saint-Evre-
mont : le tour de phrafe toujours le même ôc toujours
uniforme déplaît extrêmement ; ce contrafte
perpétuel devient fymmètrie, & cette oppolitio'n
toujours recherchée devient uniformité.
L ’efprit y trouve fi peu de variété , que lorfque
vous avez vu une partie de la phrafe, vous devinez
toujours l’autre : vous voyez des mots oppofés,
mais oppofés de la même maniéré ; vous voyez un
tour dans la phrafe, mais c’eft toujours le même.
Bien des peintres font tombés dans le défaut de
mettre des contraftes par-tout ôc fans ménagement ,
deforte que lorfqu’on voit une figure, on devine d’abord
la difpofition de celles d’à côté ; cette continuelle
diverfitd devient quelque chofe defemblable;
d’ailleurs la nature qui jette les chofes dans le de-
fordre, ne montre pas l’affeûation d’un contrafte
continuel, fams compter qu’elle ne met pas tous les
corps en mouvement, ôc dans un mouvement forcé.
Elle eft plus variée que ce la , elle met les uns en repos,
ôc elle donne aux autres différentes fortes de
mouvement.
Si la partie de l’ame qui connoît aime la variété ,
celle qui fent ne la cherche pas moins ; car l’ame ne
peut pas foûtenir long-tems les mêmes fituations ,
parce qu’elle eft liée à un corps qui ne peut les fouf-
frir ; pour que notre ame foit excitée, il faut que les
efprits coulent dans les nerfs. Or il y a là deux chofes
, une laffitude dans les nerfs, une ceffation de la
part des efprits qui ne coulent plus, ou qui fe diffi-
pent des lieux où ils ont coulé.
Ainfi tout nous, fatigue à la longue, & fur-tout
les grands plaifirs : on les quitte toujours avec la
même fatisfaâion qu’on les a pris ; car les fibres qui
en ont été les organes ont bel'oin de repos ; il faut
en employer d’autres plus propres à nous fervir, ÔC
diftribuer pour ainfi dire le travail.
Notre ame eftlaffe de fentir; mais ne pas fentir,
c’eft tomber dans un anéantiffement qui l’accable.
On remédie à tout en variant fes modifications ; elle
fent, ôc elle ne fe laffe pas.
De s plaijîrs de la furprife. Cette difpofition de
l’ame qui la porte toujours vers différens objets,
fait qu’elle goûte tous les plaifirs qui viennent de la
furprife ; fentiment qui plaît à l’ame par le fpe&acle
ÔC par la promptitude de Faction, car elle apperçoit
ou fent une chofe qu’elle n’attend pas , ou d’une
maniéré qu’elle n’attcndoit pas.
Une chofe peut nous furprendre comme merveil-
leufe, mais auffi comme nouvelle, ôc encore comme
inattendue ; ôc dans ces derniers cas, le fentiment
principal fe lie à un fentiment acceffoire fondé fur
ce que la chofe eft nouvelle ou inattendue.
C ’eft par-là que les jeux de hafard nous piquent $
ils nous font voir une fuite continuelle d’événemens
non attendus ; c’eft par-là que les jeux de fociété nous
plaifent ; ils font encore une fuite d’évenemens impré-
vûs, qui ont pour caufe l’adreffe jointe au hafard.
C ’eft encore par-là que les pièces de théâtre nous
plaifent; elles fe développent par degrés, cachent
les évenemens jufqu’à ce qu’ils arrivent, nous préparent
toujours de nouveaux fujets de furprife, ôc
fouvent nous piquent en nous les montrant tels
que nous aurions dû les prévoir.
Enfin les ouvrages d’efprit ne font ordinairement
lûs que parce qu’ils ' nous ménagent des furprifes
agréables, ôc fuppléent à l’infipidité des converfa-
tions prefque toujours languiffantes, ôc qui ne font
point cet effet.
La furprife peut être produite par la chofe ou par
la maniéré de l’appercevoir ; car nous voyons une
chofe plus grande ou plus petite qu’elle n’eft en
effet, ou différente de ce qu’elle e ft , ou bien nous
voyons la chofe même, mais avec une idée acceffoire
qui nous furprend. Telle eft dans une chofe
l ’idée acceffoire de la difficulté de l’avoir faite, ou
de la perfonne qui l’a faite, ou du tems où elle a été
faite, ou de la maniéré dont elle a été faite, ou de
quelque autre circonftance qui s’y joint.
Suétone nous décrit les crimes de Néron avec un
fang froid qui nous furprend , en nous faifant prefque
croire qu'il ne fent point l’horreur de ce qu’il
décrit ; il change de ton tout-à-coup ôc dit : l’univers
ayant fouffert ce monftre pendant quatorze ans , enfin
il l’abandonna : taie monjlrumper quatuordecim an-
nos perpejfus terrarum orbis tandem dejlituit. Ceci produit
dans l’efprit différentes fortes de furprifes ; nous
fommes furpris du changement de ftyle de l’ auteur,
delà découverte de fa différente maniéré depenfer,
de fa façon de rendre en auffi peu de mots une des
grandes révolutions quifoit arrivée ; ainfi l’ame trouv
e un très-grand nombre de fentimens différens qui
concourent à l’ébranler ôc à lui compofer un plaifir.
D e s diverjes caufes qui peuvent produire unfentiment.
Il faut bien remarquer qu’un fentiment n’a pas ordinairement
dans notre ame une caufe unique ; c’eft,
fi j’ofe me fervir de ce terme, une certaine dofe qui
en produit la force ôc la variété. L’efprit confifte à
favoir frapper plufieurs organes à-la-fois ; ôc fi l’on
examine les divers écrivains, on verra peut-être que
lés meilleurs ôc ceux qui ont plû davantage, font
ceux qui ont excité dans l’ame plus de fenfations en
même tems.
V o y e z , je vous p rie, la multiplicité des caufes ;
nous aimons mieux voir un jardin bien arrangé,
qu’une confufion d’arbres ; i° . parce que notre vûe
qui feroit arrêtée ne l’eft pas ; i ° . chaque allée eft une,
ôc forme une grande chofe, au lieu que dans la confufion
, chaque arbre eft une chofe ôc une petite chofe
; 30. nous voyons un arrangement que nous n’avons
pas coûtume de voir ; 40. nous favons bon gré
de la peine que l’on a pris ; 50. nous admirons le foin
que l’on a de combattre fans ceffe la nature, qui par
des productions qu’on ne lui demande pas, cherche à
tout confondre : ce qui eft fi v ra i, qu’un jardin négligé
nous eft infupportable ; quelquefois la difficulté
de l’ouvrage nous plaît, quelquefois c ’eftla facilité ;
& comme dans un jardin magnifique nous admirons
la grandeur & la dépenfe du maître, nous voyons
quelquefois avec plaifir qu’on a eu l’art de nous plaire
avec peu de dépenfe ôc de travail.
Le jeu nous plaît parce qu’il fatisfait notre avarice
, c’eft-à-dire l’efpérance d’avoir plus. Il flatte
notre vanité par l’idée de la préférence que la fortune
nous donne, Ôc de l’attention que les autres ont
fur notre bonheur ; il fatisfait notre curiofité, en
nous donnant un fpeûacle. Enfin il nous donne les
différens plaifirs de la furprife.
La danfe nous plaît par la legereté , par une certaine
grâce, par la beauté ôc la variété des attitudes,
par fa liaifon avec la Mufique, la perfonne qui danfe
étant comme un inftrument qui accompagne ;
mais fur-tout elle plaît par une difpofition de notre
cerveau, qui eft telle qu’elle ramene en fecret l’idée
de tous les mouvemens à de certains mouvemens,
la plûpart des attitudes à de certaines attitudes.
D e la fenfibilité. Prefque toûjours les chofes nous
plaifent ôc déplaifent à différens égards : par exemple
les virtuojî d’Italie nous doivent faire peu de plaifir ;
i ° . parce qu’il n’eft pas étonnant qu’accommodés
comme ils font, ils chantent bien ; ils font comme un
inftrument dont l’ouvrier a retranché du bois pour
lui faire produire des fons. z°. Parce que les pallions
qu’ils jouent font trop fufpeétés de fauffeté. 30. Parce
qu’ils ne font ni du fexe que nous aimons, ni de celui
que nous eftimons ; d’un autre côté ils peuvent nous
plaire, parce qu’ils confervent très long-tems un air
de jeuneffe, ôc de plus parce qu’ils ont une voix flexible
& qui leur eft particulière ; ainfi chaque chofe
nous donne un fentiment, qui eft compofé de beaucoup
d’autres, lefquels s’ affoibliffent ôc fe choquent
quelquefois.
Souvent notre ame fe compofe elle-même des rai-
fons de plaifir, ôc elle y réuffit fur-tout par les liaifons
qu’elle met aux chofes ; ainfi une chofe qui nous a
plu nous plaît encore, par la feule raifon qu’elle nous
a plu, parce que nous joignons l’ancienne idée à la
nouvelle : ainfi une aftrice qui nous a plu fur le théâtre
, nous plaît encore dans la chambre ; fa v o ix , fa
déclamation, le fouvenir de l’avoir vûe admirer,
que dis-je, l’idée de la princeffe jointe à la tienne,
tout cela fait une efpece de mélange qui forme ôc
produit un plaifir.
Nous fommes tous pleins d’idées acceffoires. Une
femme qui aura une grande réputation ôc un léger
défaut, pourra le mettre en crédit & le faire regarder
comme une grâce. La plûpart des femmes que
nous aimons n’ont pour elles que la prévention fur
leur naiffance ou leurs biens, les honneurs ou l’efti-
me de certaines gens.
De la délicatejfe. Les gens délicats font ceux qui
à chaque idée ou à chaque goût, joignent beaucoup
d’idées ou beaucoup de goûts acceffoires. Les gens'
groffiers n’ont qu’une fenfation , leur ame ne fait
compofer ni décompofer ; ils ne joignent ni n’ôtent
rien à ce que la nature donne, au lieu que les gens
délicats dans l’amour fe compofent la plûpart des
plaifirs de l ’amour. Polixene & Apicius portoient à
la table bien des fenfations inconnues à nous autres
mangeurs vulgaires ; & ceux qui jugent avec
goût des ouvrages d’efprit, ont & fe font fait une infinité
de fenfations que les autres hommes n’ont pas.
D u j e ne fa i quoi. Il y a quelquefois dans les per-
fonnes ou dans les choies un charme invifible, une
grâce naturelle , qu’on n’a pu définir, 6c qu’on
a été forcé d’appeller le je ne fa i quoi. Il me fem*
ble que c’eft un effet principalement fondé fur la
furprife. Nous fommes touchés de ce qu’une perfonne
nous plaît plus qu’elle ne nous a paru d’abord
devoir nous plaire ; ôc nous fommes agréablement
furpris de ce qu’elle a sû vaincre des défauts que
nos yeux nous montrent, 6c que le coeur ne croit
plus : voilà pourquoi les femmes laides ont très-
fouvent des grâces, ôc qu’il eft rare que les belles
en ayent ; car une belle perfonne fait ordinairement
le contraire de ce que nous avions attendu ; elle
parvient à nous paroître moins aimable ; après nous
avoir furpris en bien, elle nous furprend en mal :
mais l’impreffion du bien eft ancienne, celle du mal
nouvelle; auffi les belles perfonnesfont-elles rarement
les grandes paffions, prefque toûjours refer-
vées à celle.s qui ont des grâces, c’eft - à - dire des