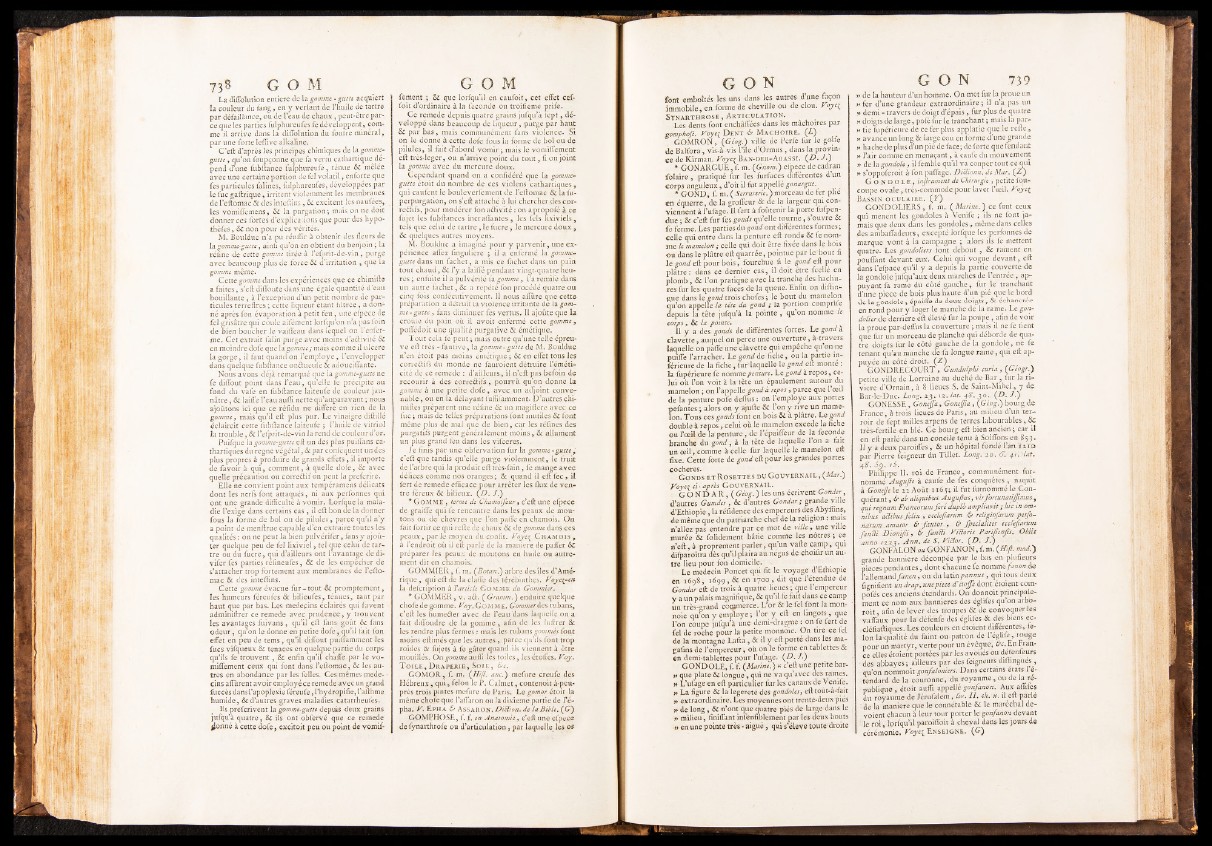
La diffolution entière de la gomme - gutte acquiert
la couleur du fang, en y verfant de l’huile de tartre
par défaillance, ou de l’eau de chaux, peut-être parce
que les parties fulphureufes fie développent, comme
il arrive dans la diffolution du fouir e minerai,
par une forte leflive alkaline.
C ’eft d’après les principes chimiques de la gomme-
gutte , qu’on foupçonne que fa vertu cathartique dépend
d’une fubftance fulphureufe, ténue 8c mêlée
avec une certaine portion de fel volatil, enforte que
fes particules falines, fulphureufes, développées par
le fuc gaftrique, irritent violemment les membranes
de l’eftomac & des intellins , 8c excitent les naufees,
les vomiffemens, 8c la purgation; mais on ne doit
donner ces fortes d’explications que pour des hypo-
thèfes, 8c non pour des vérités..
M. Boulduc n’a pu réuffir à obtenir des fleurs de
la gomme-gutte, ainfi qu’on en obtient du benjoin ; la
réfine de cette gomme tirée à l’elprit-de-vin, purge
avec beaucoup plus de force 8c d’irritation , que la
gomme même.
Cette gomme dans les expériences que ce chimifte
a faites, s’eft diffoute dans une égale quantité d’eau
bouillante, à l’exception d’un petit nombre de particules
terreftres ; cette liqueur étant filtrée, a donné
après fon évaporation à petit feu , une efpece de
fel grisâtre qui coule aifément lorfqu’on n’a pas foin
de bien boucher le vaifl'eau dans lequel on l’enferme.
Cet extrait falin purge avec moins d’a&ivité 8c
en moindre dofe que la gomme ; mais comme il ulcéré
la gorge, il faut quand on l’employe, l’envelopper
dans quelque fubflance on&ueufe & adouciffante.
Nous avons déjà remarqué que la gomme-gutte ne
fe diffout point dans l’eau, qu’elle le précipite au
fond du vafe en fubftance laiteufe de couleur jaunâtre
, 8c laiffe l’eau aufîi nette qu’auparavant ; nous
ajoutons ici que ce réfidu ne différé en rien de la
gomme, mais qu’il eft plus pur. Le vinaigre diftillé
éclaircit cette fubftance laiteufe ; l’huile de vitriol
la trouble, & l’efprit-de-vin la rend de couleur d’or.
Puifque la gomme-gutte eft un des plus puiffans cathartiques
du régné végétal, & par conféquent un des
plus propres à produire de grands effets, il importe
de favoir à qui, comment, à quelle dofe, 8c avec
quelle précaution ou correftif on peut la preferire.
Elle ne convient point aux tempéramens délicats
dont les nerfs font attaqués, ni aux perfonnes qui
ont une grande difficulté à vomir. Lorfque la maladie
l’exige dans certains cas , il eft bon de la donner
fous la forme de bol ou de pilules, parce qu’il n’y
a point de menftrue capable d’en extraire toutes les
qualités : on ne peut la bien pulvérifer, fans y ajoû-
ter quelque peu de fel lixiviel, tel que celui de tartre
ou du fucre, cjui d’ailleurs ont l’avantage de di-
vifer fes parties refineufes, & de les empêcher de
s’attacher trop fortement aux membranes de l’efto-
mac & des inteftins.
Cette'gomme évacue fur-tout 8c promptement,
les humeurs féreufes & bilieufes, ténues, tant par
haut que par bas. Les médecins éclairés qui lavent
adminiftrer ce remede avec prudence, y trouvent
les avantages fuivans, qu’il eft fans goût 8c fans
odeur, qu’on le donne en petite dofe $ qu’il fait fon
effet en peu de tems, qu’il diffout puiffamment les
fucs vifqueux 8c tenaces en quelque partie du corps
qu’ils fe trouvent, 8c enfin qu’il chaffe par le vo-
miffement ceux qui font dans.l’eftomac, 8c les autres
en abondance par les felles. Ces mêmes mede- -
cins affûrent avoir employé ce remede avec un grand
fuccès dans l’apoplexie féreufe, l’hydropifie, l’afthme
humide, & d’autres graves maladies catarrheufes.
Ils preferivent la gomme-gutte depuis deux grains
jufqu’à quatre, 8c ils ont obfervé que ce remede
jjonné à cette dofe, excitoit peu ou point de vomiffement
; 8c que lorfqu’il en caufoit, cet effet ce t
foit d’ordinaire à la fécondé ou troifieme prife.
Ce remede depuis quatre grains jufqu’à lep t , développé
dans beaucoup de liqueur, purge par haut
8c par bas, mais communément fans violence. Si
on le donne à cette dofe fous la forme de bol ou de
pilules, il fait d’abord vomir ; mais le vomiffement
eft très-leger, ou n’arrive point du tout, fi on joint
la gomme avec du mercure doux.
Cependant quand on a confidéré que la gomme-
gutte étoit du nombre de ces violens cathartiques,
qui caufent le bouleverfement de l’eftomac 8c la fu-
perpurgation, on s’eft attaché à lui chercher des correctifs,
pour modérer fon activité : on apropofé à ce
fujet les fubftances incrafl'antes , les fels lixiviels,
tels que celui de tartre, le fucre, le mercure d ou x,
ôc quelques autres moyens.
M. Boulduc a imaginé pour y parvenir, une expérience
allez finguliere ; il a enfermé la gomme-
gutte dans un fachet, a mis ce fachet dans un pain
tout chaud, & l’y a laiffé pendant vingt-quatre heures
; enfuite il a pulvériié 1a gomme, l’a remife dans
un autre fachet, 8c a répété fon procédé quatre ou
cinq fois confécutivement. U nous aflîire que cette
préparation a détruit la violence irritante de la gomme
gutte , fans diminuer fes vertus. Il ajoute que la
croûte du pain où il avoit enfermé cette gomme,
poffédoit une qualité purgative & émétique.
Tout cela fe peut ; mais outre qu’une telle épreuve
eft très - fautive, la gomme-gutte de M. Boulduc
n’en étoit pas moins émétique ; 8c en effet tous les
correûifs du monde ne fauroient détruire l’éméti-
cité de ce remede : d’ailleurs, il n’eft pas befoin de
recourir à des correctifs, pourvu qu’on donne la
gomme à une petite dofe, avec un adjoint convenable
, ou en la délayant fuffifamment. D ’autres chi-
miftes préparent une réfine 8c un magiftere avec ce
fuc ; mais de telles préparations font inutiles ôc font
même plus de mal que de bien, car les réfines des
purgatifs purgent généralement moins, & allument
un plus grand feu dans les vifeeres.
Je finis par une obfervation fur la gomme-gutte
c’eft que tandis qu’elle purge violemment, le fruit
de l’arbre qui la produit eft très-fain, fe mange avec
délices comme nos oranges ; & quand il eft fe c , il
fert de remede efficace pour arrêter les flux de ventre
féreux 8c bilieux. (D . /.)
* Gomme , terme de Chamoifcur , c’eft une efpece
de graiffe qui fe rencontre dans les peaux de moutons
ou de chevres que l’on paffe en chamois. On
fait fortir ce qui refte de chaux 8c de gomme dans ces
peaux, par le moyen du confit. Voye^ C hamois ,
à l’endroit où il eft parlé de la maniéré de paffer 6c
préparer Jes peaux de moutons en huile ou autrement
dit en chamois.
GOMMIER, f. m. (Botan.) arbre des îles d’Amérique
, qui eft de la claffe des térébinthes. Voye^-en
la defeription à l'article Gomme du Gommier.
* GOMMER, v . ad. ( Gramm. ) enduire quelque
chofe de gomme. Voy. Gomme. Gommer des rubans,
c’eft les humeéter avec de l’eau dans laquelle on a
fait diffoudre de la gomme, afin de les luftrer 8c
les rendre plus fermes : mais les rubans gommés font
moins eftimés que les autres, parce qu’ils font trop
roides 8c fujets à fe gâter quand ils viennent.à être
mouillés. On gomme aufll les toiles, les étoffes. Voy.
T o il e , D raperie, Soie , &c.
G OM OR, f. m. (Hijl. anc.') mefure creufe des
Hébreux, qui, félon le P. Calmet, contenoit à-peu-
près trois pintes mefure de Paris. Le gomor étoit la
même choie que l’affaron ou la dixième partie de l’é-
pha. V. EpH A 6* A SSA RO N. Diction, de la Bible. ( G )
GOMPHOSE, f. f. en Anatomie, c’eft une efpece
de fynarthrofe ou d’articulation, par laquelle les os
font emboîtés ïes uns dans les auttes d’une façon
immobile, en forme de cheville ou de claul V o y t
Synarthrose, Articulation.
Les dents font enchâffées dans les mâchoires par
■ gomphofe. Voye{ Dent & MACHOIRE. (L )
GOMRON, (Géog.) ville de Perfe fur le golfe
de Balfora, vis-à-vis l’île d’Ormus, dans la province
de Kirman. Voye^ Ban-der-Abassi. ( D . / .)
* GONARGUE, f. m. (Gnom.) efpece de cadran
fola ire, pratiqué fur les furfaces differentes d un
corps anguleux, d’où il fut appelle gonargue. ^
* GOND, f. m. ( Serrurerie.) morceau de fer plie
en équerre, de la groffeur 8c de la largeur qui conviennent
à l’ufage. Il fert à foutenir la porte fufpen-
due ; 6c c’eft fur fes gonds qii’elle tourne, s’ouvre ôc
fe ferme. Les parties du gond ont différentes formes;
celle qui entre dans la penture eft ronde 6c fe nomme
le mamelon y celle qui doit être fixee dans le bois
ou dans le plâtre eft quarrée, pointue par le' bout fi
le gond eft pour bois, fourchue fi le gond eft pour
plâtre: dans ce dernier cas, il doit etre fcelle en
plomb , 6c l’on pratique avec la tranche des hachures
fur les quatre faces de la queue. Enfin on diftin-
gue dans le gond trois chofes ; le bout du mamelon
qu’on appelle la tête du gond ; la portion comprife
depuis la tête jufqu’à la pointe , qu’on nomme le
corps, 6c la pointe.
Il y a des gonds de différentes fortes. Le gond à
clavette, auquel on perce une ouverture, à-travers
laquelle on paffe une clavette qui empeche qu on rie
puiffe l’arracher. Le gond de fiche, ou la partie inférieure
de la fiche, furs laquelle le gond eft monte :
la fupérieure fe nomme penture. Le gond à repos, celui
où l’on voit à la tête un épaulement autour du
mamelon ; on l’appelle gond a repos, parce que 1 oeil
de la penture pofe deffus : on l’employe aux portes
pefantes ; alors on y ajufte 6c l’on y rive un mamelon.
Tous ces gonds font en bois 6c à plâtre. Le gond
double à repos, celui où le mamelon excede la fiche
ou l’oeil de la penture, de lepaiffeur de la fécondé
branche du gond, à la tête de laquelle l’on a fait
un oeil, comme à celle fur laquelle le mamelon eft
fixe. Cette forte de gond eft pour les grandes portes
cocheres. .
Gonds et Rosettes du Gouvernail , (Mar.)
yoye^ ci - après GOUVERNAIL. I
G O N D A R , ( Géog. ) les uns écrivent Gonder,
d’autres Gumder, ôc d’autres Gondar ; grande ville
d’Ethiopie, la réfidence des empereurs des Abyffms,
de même que du patriarche chef de la religion : mais
n’allez pas entendre par ce mot de v ille , ^une ville
murée 6c folidement bâtie comme les nôtres ; ce
n’e ft , à proprement parler, qu’un vafte camp, qui
difparoîtra dès qu’il plaira au négus de choifir un autre
lieu pour fon domicile, y
Le médecin Poncet qui fit le voyage d’Ethiopie
en 1698, 1 6 9 9 ,6c en 1700, dit que l’étendue de
Gondar eft de trois à quatre lieues ; que l’empereur
y a un palais magnifique, 6c qu’il fe fait dans ce camp
un très-grand commerce. L’or 8c le fel font la mon-
noie qu’on y employé ; l’or y eft en lingots , que
l ’on coupe jùfqu’à une demi-dragme : on fe fert de
fel de roche pour la petite monnoie. On tire ce fel
de la montagne Lafta, 6c il y eft porte dans les ma-
gafins de l’empereur, où on le forme en tablettes 6c
en demi-tablettes pour l’ufage. (D . J .)
GONDOLE, f. f. (Marine.) « c’eft une petite bar-
» que plate 6c longue, qui ne va qu’avec des rames.
» L’ufage en eft particulier fur les canaux de Venife.
» La figure 6c la legereté des gondoles, eft toût-a-fait
» extraordinaire. Les moyennes ont trente-deux piés
» de long , 6c n’ont que quatre piés de large dans le
>> milieu, finiffant infenfiblement par les deux bouts
» en une pointe très - aiguë, qui s’élève toute droite
» de la hauteur d’un homme. On met fut la proue un
» fer d’une grandeur extraordinaire ; il n’a pas un
j> demi - travers de doigt d’épais , fur plus de quatre
» doigts de large, pofé fur le tranchant ; mais la par-
» tie fupérieure de ce fer plus applatie que. le refte.,
» avance un long ôc large cou en forme d’une grande
» hache de plus d’un pié de face; de forte que fendant
» l’air comme en menaçant, à caufe du mouvement
» de la gondole, il femble qu’il va couper tout ce qui
» s’oppoferoit à fon paffage. Diclionn. de Mar. (Z )
G O N D O L E , injlrument de Chirurgie , petite fcp*
coupe o v a le , très-commode pour laver l’oeil. Voye{
Bassin oculaire. (T )
GONDOLIERS, f. m. ( Marine. ) ce font ceux
qui mènent les gondoles à Venife ; ils ne font jamais
que deux dans les gondoles , même dans celles
des ambaffadeurs, excepté lorfque les perfonnes de
marque vont à la campagne ; alors ils fe mettent
quatre. Les gondoliers font debout , 6c rament en
pouffant devant eux. Celui qui vogue devant, eft
dans l’efpace qu’il y a depuis la partie couverte de
la gondole jufqu’aux deux marches de l’entrée , appuyant
fa rame du côté gauche, fur le tranchant
d’une piece de bois plus haute d’un pié que le bord
de la gondole, épaiffe de deux doigts, 8c échancrée
en rond pour y loger le manche de la rame. Le gondolier
de derrière eft élevé fur la poupe, afin de voir
la proue par-deffus la couverture ; mais il ne fe tient
que fur un morceau de planche qui déborde de quatre
doigts fur le côté gauche de la gondole , ne fe
tenant qu’au manche de fa longue rame, qui eft appuyée
au côté droit. (Z )
GONDRECOURT , Gundulphi curia , ([Géogr.)
petite ville de Lorraine au duché de Bar , fur la rivière
d’Ornain, à 8 lieues S. de Saint-Mihel, 7 de
Bar-le-Duc. Long. 2.3. 12. lat. 48. 30.. ( D , J .)
GONESSE , Gonejfa, GoneJJia, (Géog.) bourg de
France, à trois lieues de Paris, au milieu d’un terroir
de fept milles arpens de terres labourables, 6C
très-fertile en blé. Ce bourg eft bien ancien ; car il
en eft parlé dans un concile tenu à Soiflbns en $5.3.
Il y a deux paroiffes, 8c un hôpital fonde L’an. 1110
par Pierre feigneur du Tillet. Long. 20 . G. 4 1 . -lot.
48. 55). iS. . ■■ ■ . I -
Philippe II. roi de France, communément fur-
nommé Augufte à caufe de fes conquêtes , naquit
à GoneJJe le z i Août 1165; il fut furnommé le Conquérant
y&ab aliquibus Augufhis, virfortunatiffîmus ,
qui regnum Francorum feré duplb ampliavit ; hic in omnibus
aelibus f e lix , ecclejîarum & religiofarum perfo-
narum.amator & fautor. , & fpecialiter ecclejîarum
fancli D io n ijii, & fancti Victoris Parijîenjis. Obiit
anno 122g. A n n . de S . Victor. (D . J .)
GONFALON ou GONFANON, f. m. mod.)
grande bannière découpée par le ba$ en plufieurs
pièces pendantes, dont chacune fe nommefanon de
l’allemand fanen, ou du latin pannus, qui tous, deux
fignifient un drap, une piece d ’étoffe dont étoient com-
j pofés ces anciens étendards. On donnoit principalement
ce nom aux bannières des églifes qu’on arbo-
ro it , afin de lever des troupes 6c de convoquer les
vaffaux pour la défenfe des églifes 8c des biens ec-
rcléfiaftiques. Les couleurs en étoient différentes,.félon
la qualité du faint ou patron de l’églife, rouge
pour un martyr, verte pour un évêque, 6c. En France
elles étoient portées par les avoués ou defenleurs
• des abbayes ; ailleurs par des feigneurs diftingués f
qu’on nommoit gonfaloniers. Dans certains états 1 é-
tendard de la couronne, du royaume, ou de la république
, étoit aufli appellé gonfanon. Aux affifes
du royaume de Jérufalem I I . ch. x . il eft parle
de la manière que le connétable 6c le maréchal dévoient
chacun à leur tour porter le gonfanon devant
le roi lorfqu’il paroiffoit à cheval dans les jours de
cérémonie. Voyeç, Enseigne. (G)