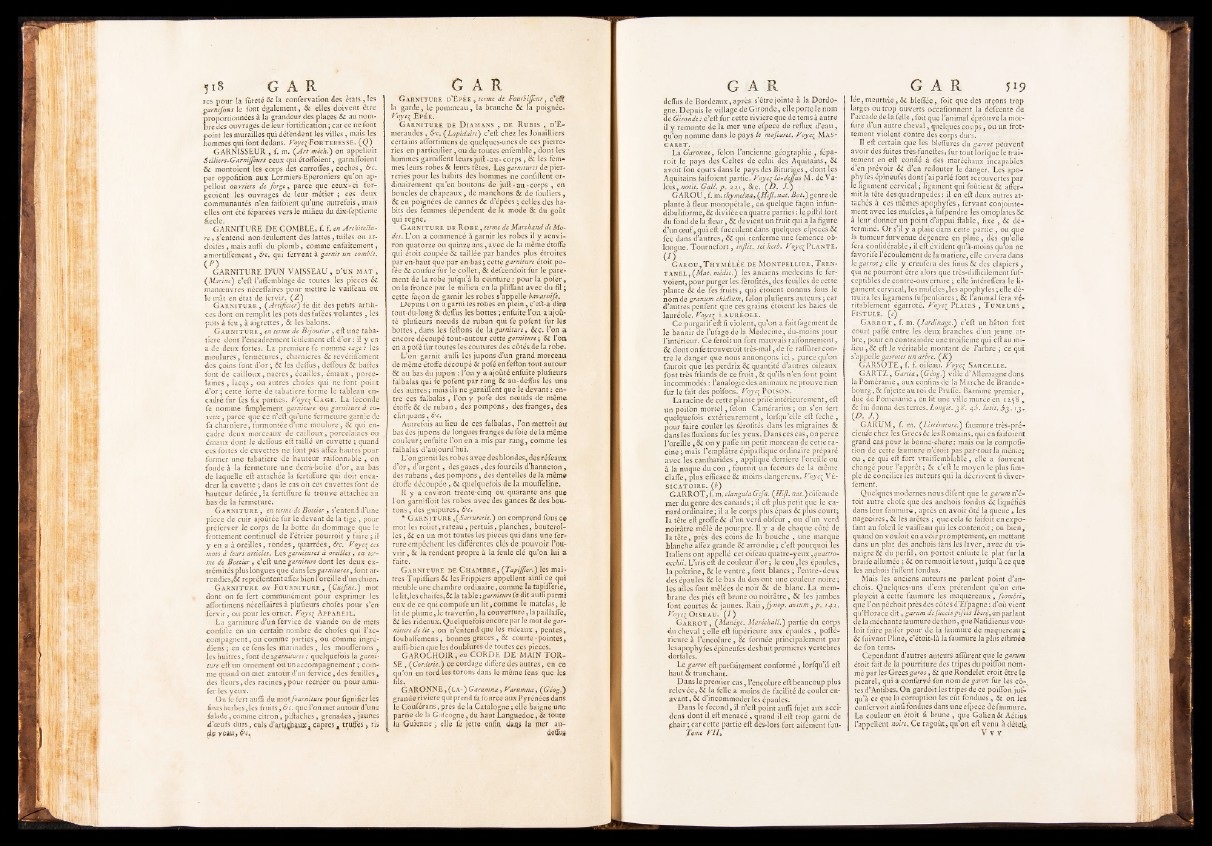
ïe s pour la fureté & la confervation des états ,les
g a r n i foH s le font éga lement, & elles doivent être
proportionnées à la grandeur des places 8c au nombre
des ouvrages de leur fortification ; car ce ne font
point les murailles qui défendent les v i l le s , mais les
hommes qui font dedans. V -Fo r t e r e s s e . (Q )
GARNISSEUR , f. m, {Art méch!) on appelloit
Selliers-Garnijfeurs ceux qui étoffoient, garniffoient
3c montoient les corps des carroffes, coches, &c.
par oppolition aux Lormiers-Eperoniers qu’on appelloit
ouvriers de forge, parce que ceux-ci for-
geoient les ouvrages de leur métier ; ces deux
communautés n’en faifoient qu’une autrefois, mais
■ elles ont été féparées vers le milieu du dix-feptieme
fiecle.
GARNITURE DE COMBLE, f. f. en Architecture
, s’entend non-feulement des lattes, tuiles ou ar-
doifes, mais aulîi du plomb, comme enfaîtement,
amortiffement, &c. qui fervent à garnir un comble..
PUG
ARNITURE D’UN VAISSEAU, d ’u n m a t ,
{Marine) c’eft l’affemblage de toutes les pièces 8c
manoeuvres néceffaires pour mettre le vaiffeau ou
le mât en état de fervir. (Z )
G a r n it u r e , f Artificier) fe dit des petits artifices
dont on remplit les pots des fufées volantes , les
pots à feu, à aigrettes , & les balons.
G a r n it u r e , en terme de Bijoutier > eft une tabatière
dont l’encadrement feulement eft d’or : il y en
a de deux fortes. La première fe nomme cage : les
moulures, fermetures, charnières 8c revétiffement
des coins font d’or ; 8c les defliis, deflous 8c baltes
font de cailloux, nacres, écailles, émaux , porcelaines
, lacqs, ou autres chofes qui ne font point
d’or ; cette forte de tabatière forme le tableau encadré
fur fes fix parties. Voye^ C a g e . La fécondé
fe nomme Amplement garniture ou garniture à cuvette
, parce que ce n’ eft qu’une fermeture garnie de
fa charnière, furmontée d’une moulure, 8c qui encadre
deux morceaux de cailloux, porcelaines ou
émaux dont le deflous eft taillé en cuvette ; quand
ces fortes de cuvettes ne font pas affez hautes pour
former une tabatière de hauteur raifonnable , on
foude à la fermeture une demi-boîte d’o r , au bas
de laquelle eft attachée la fertifîùre qui doit encadrer
la cuvette ; dans le cas où ces cuvettes font de
hauteur defirée, la fertiflùre fe trouve attachée au
bas de la fermeture.
G a r n it u r e , en terme de Bottier , s’entend d’une
piece de cuir ajoutée fur le devant de la tige , pour
préferver le corps de la botte du dommage que le
frottement continuel de l’étrier pourroit y faire ; il
y en a à oreilles, rondes, quarrées, &c. Voyeç ces
mots à leurs articles. Les garnitures à oreilles, en terme
de Bottier, c’eft une garniture dont les deux extrémités
plus longues que dans les garnitures, font arrondies,&
reprélentent aflez bien l’oreille d’un chien.
G a r n it u r e ou F o u r n itu r e , ( Cuijîne.) mot
dont on fe fert communément pour exprimer les
affortimens néceffaires à plufieurs chofes pour s’en
fervir, ou pour les orner. Voye^ A p p a r e i l .
La garniture d’un fervice de viande ou de mets
confifte en tin certain nombre de chofes qui l’accompagnent
, ou comme parties, ou comme ingré-
diens ; en ce fens les marinades , les moufferons ,
les huîtres, font de s garnitures : quelquefois la garniture
eft un ornement ou un accompagnement ; comme
quand on met autour d’un fervice, des feuilles,
des fleurs, des racines, pour recréer ou pour amu-
fer les yeux.
On fe fert aufli du mot fourniture pour lignifier les
fines herbes, les fruits, &c. que l’on met autour d’une
falade, comme citron, piftaches, grenades, jaunes
d’oeufs durs, culs d’ajtkbaux 4 câpres t truffes, ris
j& Y eau ,fo .,
G arniture d’épée , terme de Fourbijfeur, c’ef?
la garde, le pommeau, la branche 8c la poignée.
Voye{ .Épée. -
Ga rniture -de D iamans , de Rubis , D’Émeraudes
, &c. { Lapidaire) c’eft chez les Jouailliers
certains aflortimens de quelques-unes de ces pierreries
en particulier, ou de toutes enfemble, dont les
hommes garniflent leurs juft-au - corps , & les femmes
leurs robes & leurs têtes. Les garnitures de pierreries
pour les habits des hommes ne confiftent ordinairement
qu’en boutons de juft-au-corps , en
boucles de chapeaux, de manchons & de fouliers ,
8c en poignées de cannes 8c d’épées ; celles des habits
des femmes dépendent de la mode & du goût
qui régné.
Ga rniture de R obe , terme de Marchand de Modes.
L’on a commencé à garnir les robes il y aenvi-
ron quatorze ou quinze ans, avec de la même étoffe
qui étoit coupée 8c taillée par bandes plus étroites
par en-haut que par en-bas ; cette garniture étoit po-
fée 8c coufue fur le collet, & defcendoit fur le parement
de la robe jufqu’à la ceinture : pour la. pofer ,
on la fronce par le milieu en la pliffant avec du fil ;
cette façon de garnir les robes s’appellçrbavaroifc.
Depuis l’on a garni les robes en plein, c’eft-àdir^
tout-du-long & deflùs les bottes ; enfuite l’on a ajoû-
té plufieurs noeuds de ruban qui fe pofent fur les
bottes , dans les feftons de la garniture, 8cc. l’on a
encore découpé tout-autour cette garniture ; 8c l’on
en a pofé fur toutes les coutures des côtés de la robe.
L’on garnit aulîi les jupons d’un grand morceau
de même étoffe découpé & pofé en fefton tout-autour
8c au bas du jupon : l’on y a ajoûté enfuite plufieurs
falbalas qui fe pofent par rang 8c au-defliis les uns
des autres ; mais ils ne garniflent que le devant : entre
ces. falbalas , l’on y pofe des noeuds de même
étoffe 8c de ruban, des pompons, des franges, des
clinquans, &c.
Autrefois au lieu de ces falbalas, l’on mettoit au
bas des jupons de longues franges de foie de la même
couleur; enfuite l’on en a mis par rang, comme les
falbalas d’aujourd’hui.
L’on garnit les robes avec des blondes, des réfeaux
d’o r , d’argent, des gazes , des fourcils d’hanneton ,
des rubans , des pompons, des dentelles de la même
étoffe découpée , 8c quelquefois de la mouffeline.
Il y a environ trente-cinq ou quarante ans que
l'on garniflbit les robes avee des gances 8c des bou^
tons , des guipures, &c.
* G arniture , {Serrurerie.} on comprend fous ce
mot les.roiiet,rateau, pertuis, planches, bouterol-
les , 8c en un mot toutes les pièces qui dans une ferrure
empêchent les differentes clés de pouvoir l’ouvrir
, & la rendent propre à la feule clé qu’on lui a
faite.
G arniture de C hambre, {Tapifjier.) les maîtres
Tapifliers 8c les Frippiers appellent ainfi ce qui
meuble une chambre ordinaire, comme la tapiflerie,
le lit,les chaifes,8c la table -.garniture fe dit aufli parmi
eux de ce qui compofe un lit, comme le matelas, le
lit de plume, le traverfin, la couverture, la paillaffe,
8c les rideaux. Quelquefois encore par le motdegw-
niture de l i t , on n’entend que les rideaux , pentes,
foubaffemens , bonnes grâces, & courte-pointes,
auflx-bien que les doublures de toutes ces pièces.
GAROCHOIR, ou CORDE DE MAIN TO R SE
, ( Corderie.) ce cordage différé des autres, en ce
qu’on en tord les torons dans le même fens que les
fils.G
ARONNE, (LA-) Garumna, Varumna, (Géog.j
grande riviere qui prend fa fource aux Pyrénées dans
le Couférans, près de la Catalogne ; elle baigne une
partie de la Gafcogne, du haut Languedoc, & toute
la Guienne ; elle fe jette enfin daqs la mer au-
deffitf
deflùs de Bordeaux, après: s’être jointe à la Dordogne.
Depuis le village de Gironde, elle porte le nom
de Gironde : c’eft fur cette riviere que de tems à autre
il y remonte de la mer une efpece de reflux d’eau,
qu’on nomme dans le pays le mafcaret. Voye£ M a s c
a r e t .
La Garonne, félon l’ancienne géographie , fépa-
roit le pays des Celtes de celui des Aquitains, 8c
a voit fon cours dans le pays des Bituriges, dont les
Aquitains fajfoient partie. Voye^là-dcffus M. de Valois
, notit. G ail. p. 2.21, &c. ,{D . J !) : „
G ARÔÜ , f. m. tk ym e loe a y{ H i f i . n a t . B o t ! ) genre de
plante à fleur monopétale, en quelque façon infun-
dibuliforme, 8c divifée en quatre parties : le piftil fort
du fond de la fleur, 8c devient un fruit qui a la figure
d’un oe uf, qui eft fucculent dans qùelques efpeçes 8c
fec dans d’autres, 8c qui renferme une femence ç>b-
longue. Tournefort, in f i i t . r e i h e rb . V o y e^ P l a n t e .
( / )
G a r o u , T h y m é l é e d e Mo n t p e l l ie r , T r en-
t a n e l , {Mat. médic!) les anciens médecins fe fer-
voient, pour purger les férofités, des feuilles de cette
plante 8c de fes fruits, qui étoient connus fous le
nom de granum chidium, félon plufieurs auteurs ; car
d’autres penfent que ces grains étoient les baies de
lauréole. Voye%_ La u r x o l e .
Ce purgatif eft fi violent, qu’on a fait fagement de
le bannir de l’ufage de la Medecine, du-moins pour
l’intérieur. Ce feroit un fort mauvais raifonnement,
& dont onfe trou ver oit très-mal, de fe raflùrer contre
le danger que nous annonçons ic i, parce qu’on
fauroit que les perdrix 8c quantité d’autres oifeaux
font très friands de ce fruit, & qu’ils n’en font point
incommodés : l’analogie des animaux ne prouve rien
fur le fait des poifons. Voye{ P o i s o n .
La racine de cette plante prife intérieurement, eft
un poifon mortel, félon Camérarius ; on..s’en fert
quelquefois extérieurement , lorfqu’elle eft feche ,
pour faire couler les férofités dans les migraines &
dans les fluxions fur les yeux. Dans ces cas, on perce
l ’oreille, & on y paffe un petit morceau de cette racine
; mais l’emplâtre épipaftique ordinaire préparé
avec les cantharides , appliqué derrière l’oreille ou
à la nuque du cou , fournit un fecours de la même
claffe, plus efficace & moins dangereux. Voyei V é s
i c a t o i r e . ( b )
GARROT,f. m. clangula Gefn. {Hijl. nat!)oifeau de
mer du genre des canards ; il eft plus petit que le canard
ordinaire ; il a le corps plus épais 8c plus court;
la tête eft groffe 8c d’un verd obfcur , ou d’un verd
noirâtre mêlé de pourpre. Il y a de chaque côté de
la tête, près des coins de la bouche , une marque
blanche aflez grande 8c arrondie ; c’eft pourquoi les
Italiens ont appellé cet oifeau quatre-yeux, quattro-
occhii. L’iris eft de couleur d’or ; le cou, les épaules,
la poitrine, 8c le ventre , font blancs ; l’entre-deux
des épaules 8c le bas du dos ont une couleur noire ;
les aîles font mêlées de noir & de blanc. La membrane
despiés eft brune ou noirâtre, & les jambes
font courtes & jaunes. Raii >fynop. avium ,p . 142.
Voyei O iseau , (ƒ )
G a r r o t , (Manège. Maréchall.) partie du corps
du cheval ; elle eft fupérieure aux épaules , pofté-
rieure à l’encolure, & formée principalement par
lesapophyfes épineufes des huit premières yertebres
dorfales.
Le garrot eft parfaitement conformé , lorfqu’il eft
haut & tranchant.
Dans le premier cas, l’encolure eft beaucoup plus
relevée, & la felle a moins de facilité de couler en-
avant, & d’incommoder les épaules.
Dans le fécond, il n’eft point aufli fujet aux acci-
dens dont il eft menacé , quand il eft trop garni de
chair ; car cette partie eft dès-lors fort aifément fou-
Tomc VU .
lée , meurtrie;, & bleflee, foit que des arçons trop
larges ou trop ouverts occàfionnent la defeente de
l’arcade de la felle, foit que l’animal éprouve la mor-
fùre d’un autre.cheval, quelques coups, ou un frottement
violent contre des eprps durs.
Il eft certain que les bleflùres du garrot peuvent
avoir des fuites très-funeftes, fur-tout lorfque le traitement
en eft confié à des maréchaux incapables
d’en prévoir & d’en redouter le danger. Les apo-
phyfes épineufes dont j’aiparlé font recouvertes par
le ligament cervical ; ligament qui foûtient & affermit
la tête des quadrupèdes; il en eft deux autres attachés
à ces mêmes apophyfes, fervant conjointement
avec les mufcles, à fufpendre les omoplates 8c
à leur donner un point d’appui ftable, fixe , & déterminé.
Or s’il y a plaie dans cette partie , ou que
la tumeur furvenue dégénéré en plaie , dès qu’elle
fera confidérable, il eft évident qu’à-moins qu’on ne
favorife l’écoulement de la matière, elle cavera dans
\q garrot; elle y creufera des finus & des clapiers ,
qui ne pourront être alors que très-difficilement fuf-
ceptibles de contre-ouverture ; elle intérefîera le ligament
cervical, les mufcles,les apophyfes ; elle détruira
les ligamens fufpenfoires ; & l’animal fera véritablement
égàrroté. Voye^ P l a ie s , T um e u r s ,
F is t u l e , (e)
G a r r o t , f. m. {Jardinage!) c’eft un bâton fort
court paffé entre les deux branches d’un jeune arbre
, pour en contraindre une troifieme qui eft au milieu
, & eft le véritable montant de l’arbre ; ce qui
s’appelle garroter un arbre. ( A )
GARSOTE, f. f. oifeau. Voye^ Sa r c e l l e .
GARTZ , Garda, {Géog!) ville d’Allemagne dans
la Poméranie, aux confins de la Marche de Brandebourg,
8r fujette auroi.de Pruflè. Barnime premier,
duc de Poméranie, e n f i t une ville murée en 1158 ,
& lui donna des terres. Longit. 38. 45. ladt. 5$. 13 + (d. n mm mm
GARUM, f. m. {Littérature.') faumure très-pré-
cieuie chez les Grecs & les Romains, qui en faifoient
grand cas pour la bonne-chere: mais ou la compofi-
tion de cette faumure n’étoit pas par-tout la même;
ou , ce qui eft fort vraifleinblable , elle a fouvent
change pour l’apprêt ; & c’eft lç moyen le plus Ample
de concilier les auteurs qui la décrivent fi diver-,
fement.
Quelques modernes nous difent que le garum n’étoit
autre chofe que des anchois fondus 6c liquéfiés
dans leur faumure, après en avoir ôté la queue , les
nageoires, & les arêtes ; que cela fe faifoit en expo-
fant au foleil le vaiffeau qui les contenoit ; ou bien
quand on vouloit en avoir promptement, en mettant
dans un plat des anchois fans les laver, avec du vinaigre
& du perfil, on portoit enfuite le plat fur la
braife allumée ; & on remuoit le tout, jufqu’à ce que
les anchois fuffent fondus.
Mais les anciens auteurs ne parlent point d’anchois.
Quelques-uns d’eux prétendent qu’on em-
ployoit à cette faumure les maquereaux, feombri,
que l’on pêchoit près des côtes'd’Efpagne : d’où vient
qu’Horace dit, garum de fuccispifeis Iberü, en parlant
de la méchante Jaumure de thon, que Naficlienus vouloit
faire paffer pour de la faumure de maquereau j
8c fuivant Pline, c’étoit-là la faumure la plus eftimée
de fon tems..
Cependant d’autres auteurs affûrent que le garum
étoit fait de la pourriture des tripes du poiffon nommé
par les Grecs garos, 8c que Rondelet croit être le
picarel, qui a confervé fon nom degaron fur les cô-
l tes d’Antibes. On gardoit les tripes de ce poiflon jufqu’à
ce que la corruption les eût fondues, & on les
confervoit ainfi fondues dans une efpece de faumure*
La couleur en étoit fi brune , que Galien 8t Aétius.
Rappellent noire. C e ragoût, qu’on eft venu à déte£