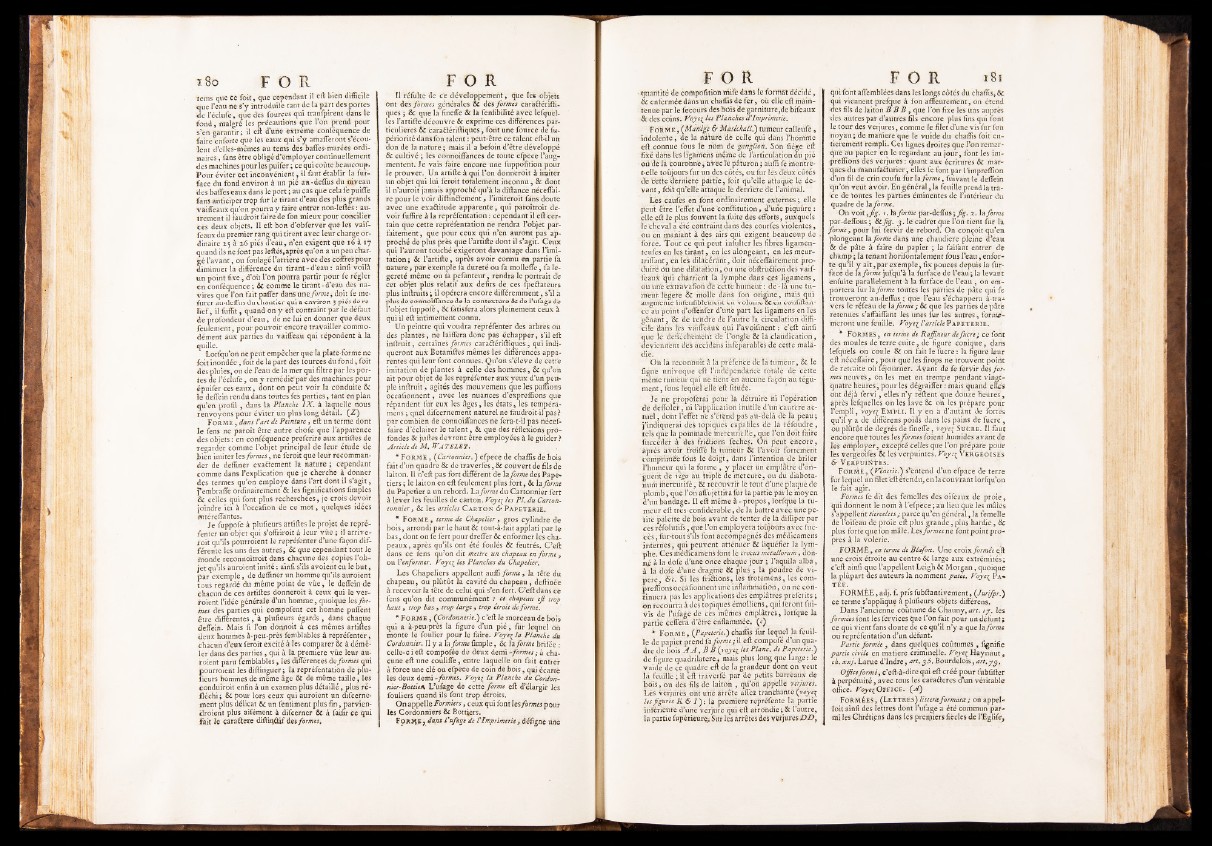
iBo F O R
tems que ce foit, que cependant il eft bien difficile J
que l’eau ne s’y introduife tant de la part des portes
de l’éclufe, que des fources qui trânfpirent dans le
fon d, maigre lès précautions que l’on prend pour
s’en garantir; il eu d’une extrême cbnféquehce de
faire enforte que lès eaux qui s’y amafferôrit s’écoit-
lent d’elles-mêmes au tems dés baffes-marées ordinaires
, fans être obligé d’ëmployer continuellement
des machines pour les puifer ; ce qui coûte beaucoup.
Pour éviter cet inconvénient, il faut établir la fur-
face du fond environ à un pié aù-deffus du piveau
des baffes eaux dans le port ; au cas que cela fe puiffe
fans anticiper trop fur le tirant d’eau des plus grands
vaiffeaux qu’on pourra y faire entrer non-leftes : autrement
il faudroit faire de fon mieux pour concilier
ces deux objets. Il eft bon d’obferver què les vàif-
feaux du premier rang qui tirent avec leur charge ordinaire
15 à 26 piés d’eau, n’en exigent que 16 à 17
quand ils ne font pas leftés,après qu’on a un peu chargé
l’avant, ou foulagé l’arriéré avec des coffres pour
diminuer la différence du tirant-d’eau : àinfi Voilà
un point fixe, d’où l’on pourra partir pour fe régler
en conféquence ; & comme le tirant-d’eau dès navires
que l’on fait paffer dans une forme, doit fe me-
furer au-deflus du chantier qui a environ 3 piés de relie
f, il fuffit, quand on y eft contraint par le défaut
de profondeur d’eau, de ne lui en donner que deux
feulement, pour pouvoir encore travailler commodément
aux parties du vaiffeau qui répondent à la
quille.
Lorfqu’on ne peut empêcher que la plate-forme ne
foit inondée, foit de la part des lources du fond, foit
des pluies, ou de l’eau dè la mer qui filtre par les portes
de l’éclufe, on y remédié-par des machines pour
épuifer ces eaux, dont on peut voir la conduite &
le deffein rendu dans toutes fes parties, tant en plan
qu’en profil , dans la Planche IX . à laquelle nous
renvoyons pour éviter un plus long détail. (Z )
F o rm e , dans Part de Peinture, eft un terme dont
le fens ne paroît être autre chofe que l'apparence
des objets : en conféquence prefcrire aux artiftes de
regarder comme l’objet principal de leur étude de
bien imiter les formes, ne feroit que leur recommander
de deffiner exa&ement la nature ; cependant
comme dans l’explication que je cherche à donner
des termes qu’on employé dans l’art dont il s’àgit,
f embraffe ordinairement & les fignificâtions Amples
& celles qui font plus recherchées, je crois devoir
joindre ici à l’occafion de ce mot, quelques idées
ftrtéreffantes.
Je fuppofe à plufieurs artiftes le projet de repré-
fenter un objet qui s’offriroit à leur vue ; il arrive-
roit qu’ils pourroient le repréfenter d’une façon différente
les uns des autres, 6c que cependant tout le
inonde reconnoîtroit dans chacune des copies l ’objet
qu’ils auroient imité : ainfi s’ils avoient eu le but,
par exemple, de deffiner un homme qu’ils auroient
tous regardé du même point de v u e , le deffein de
chacun de ces artiftes donneroit à ceux qui le verdoient
l’idée générale d’un homme, quoique lès for-
hus des parties qui compofent cet homme puffent
être différentes , à plufieurs égards , dâns chaque
deffein. Mais fi l’on doiyioit à ces mêmes artiftes
deux hommes à-peu-près femblables à repréfenter,
chacun d’eux feroit excité à les comparer 6c à démêler
dans des parties, qui à là première vûe leur au-
foient paru femblables, les différences de formes qui
pourroient les diftinguer ; la repréfentation de plu-
lieurs hommes de meme âge 6c de même taille ; les
conduiroit enfin à un examen plus détaillé, plus réfléchi;
ôc pour lors ceux qui auroient un difcernc-
merit plus délicat 6c un fentiment plus fin, parvien-
droient plus aîfément à difcerner ôc à faifir ce qui
fait le cara&ere diftinâûf des formes.
Il réfultè de cè développement, qtie les objets
ont dès formes générales ôc dès formes e&ràâériftU
ques ; & que la fineffe & là fenfibilité avec lelqucl-
les l’artifte découvre & exprime ces différences particulières
ôc caraftériftiques, font une fôurcè de fu-
périorité dans fon talent : peut-être ce talent eft-il un
don dë la nature ; mais il a befoin d’être développé
ôc cultivé ; les connoiffances de toute efpece l’aug-
mente'nt. Je vais faire encore une fuppofition pour
le prouver. Un artifte à qui l’on donneroit à imiter
un objet qui lui feroit totalement inconnu, & dont
il n’auroit jamais approché qu’à la diftance néceffai-
re pour le voir diftin&ement, l’imiteroit fans doute
avec une exaûitude apparente, qui pàroîtroit devoir
fuffire à la repréfentation : cependant il eft certain
qüe cette repréfentation ne rendra l’objet parfaitement
, que pour ceux qui n’en auroht pas approché
de plus près que l’artifte dont il s’agit. Ceux
qui l’auront tôüché exigeront davantage dans l’imitation;
& l’artifte, après avoir connu en partie fa
nature > par èxemple là dureté ou fa molleffe, fa Ie-
gereté même ou là pefanteur, rendra le portrait dë
cet objet plus relatif aux defirs de ces lpe&àteurs
plus inftruits ; il opérera encore différemment, s’il a
plus de corihoiffànce de la contexture ôc de l’ufage de
l’objet fuppofé, Ôc fàtisfera alors pleinement ceux à
qui il eft intimement connu.
Un peintre qui voudra repréfenter des arbres ou
des plantes, ne laiffera donc pas échapper, s’il eft
inftruit, certaines formes caraéteriftiques, qui indiqueront
aux Botaniftès mêmes les différences apparentes
qui leur font connues. Qu’on s’élève de cettë
imitation de plantes à celle des hommes, & qu’on
ait pour objet de les repréfenter aux yeux d’un peu*
pie inftruit, agités des mouvemens que les pallions
occafionnent, avec les nuances d’expreffiorts que
répandent fur eux les âges, les états % les tempérâ-
mens ; quel difcernement naturel ne faudroit-il pas?
par combien de connoiffances ne fera-t-il pas nécef-
faire d’éclairer le talent, & que deS réflexions profondes
& juftes devront être employées à le guider?
Article de M. Wa t e l e t .
* Fo r m é , ( Canonnier. ) efpece de chaffis de bois
fait d’un quâdre ôc de traverfes, & couvert de fils de
laiton. Il n’eft pas fort différent de la forme des Pape*
tiers ; le laiton en eft feulement plus for t, & Xa forme
du Papetier à un rebord. La forme du Gartonnier fert
à lever les feuilles de càrton. Voye{ les PI. du Carton-
tonnier y ÔC les articles C a r t o n & PAPETERIE.
* F o rm e , terme de Chapelier, gros cylindre de
bois, arrondi par le haut ôc tout-à-fait applati par le
bas, dont on fe fert pour dreffer ôc enfermer les chapeaux
, après qu’ils ont été foulés & feutrés. C ’eft
dans ce fens qu’on dit mettre un chapeau en forme ,
ou l’enfermer. Foyer les Planches du Chapelier.
Les Chapeliers appellent auffi forme , la tête du
chapeau, ou plutôt la cavité du chapeau, deftinéè
à recevoir la tête de celui qui s’en fert. C’eft dans ce
fens qu’on dit communément .• ce chapeau eft 'trop
haut y trop bas , trop large , trop étroit dé formé.
* Fo r m e , (Côfdonnerie.) c ’eft le morceau de bois
qui a à-peu-près la figure d’un pié, für lequel on
monte le foulier pour le faire. Foÿe^ la Planche dit
Cordonnier. Il y a la forme fimple, Ôc la forme brifée :
celle-c i eft compofée de deux demi -formes; à chacune
eft une coulifie, entre laquelle on fait entier
à force une clé ou efpece de coin de bois, qui écawé
les deux demi -formes. Foyï[ la Planche du Cordoh-
nier-BottieiK L’ufage de cette forme eft d’élargir les
fouliers quand ils font trop étroits.
On appelle Forrhiers, ceux qui font les formes pour
les Cordonniers Ôc Bottiers.
Forme r dans l ’ufage de l ’Imprimerie , désigne une
quantité de compofitibh tnife dans le formât décidé,
& enfermée dans Un chaffis de fer, où elle eft maintenue
par le fecdUrS dès bois de garniture,dë bifeaux
6c des coins. Voye,[ les Plàh'ckes d’Imprimerie.
PdhiùE, {Matière & Màféchdll.) fu'ffieür calléùfé,
indolente, de la iVâfürè joe celle qui 'dans l’homme
éft.. connue fous le nbm de ‘ganglion. Sbn fiége eft
fiié dàtis les ligàmëns même de l’articulation du pié
od dé là tourohhè, àVëc lë jiâtüron ; àiiïfi fé hïontrè-
t-elle toujours fur un des côtés, ou fur lés deux côtés
dè fc'ette 'd'erhiere jpartie, foit qu’elle attaque le devant
, fôit qû’ëllé attaque lè d’èrriefe ‘dë l’animal.
Lès caufes en font ordinairement e xte rn es ; elle
peut être l’effet d’une conftitution , d’une piquûre :
elle eft le plus fouvent la fuite’ des efforts, auxquels
le che va l a été contraint dans des courfes v io len te s ,
o u en maniant à des airs qui exigent beaucoup de .
fo rcé. T o u t ce qui peut infulter les fibres ligamen-
teufes en les t ir a n t , en les alongeàn t, en les meur-
triffant-, en les dilà'cerahf, ‘doit héceffâirëmerit produira
Ou fine dilâtâlipH, o u une bbftruûion des vaif-
fe au Je 'qüi charrient la lymphe dans cçS ligamens,
oti ii'rië ëxtf'àvaiïon d‘é cette humeur : d e - là Une tû-
HVetth lègete t e rtiollë dans fori o rig in e , mais qüi
aughtëhte infenfible'mënt en v olümé 6c en confiftân-
c ë aü poiùt d’offehier d’ tiiie part les ligamens en les
gênà’n t , 6c 'de i-èndfë dë l ’a tiife l'a circulation diffic
ile défis lës ya iffeâü x qüi l’avoifinent : c’ëft ainfi
que lé defféchëniënt Ü'e i’bngle & là claudication,
deviefiiifent dës àCCidéfiS infépârâblës de cèite mâlâ-
diè.O
h là recbnrioît à là prelenCë de la tumeur, 6c le
figrië uriivoqne eft l’inclépèndâricë totale d'e cette
même tüittëür qui nè tient 'èrt âüëühe façbn au tégument
, foiiS iêqüèl ‘elle eft Athée.
le ne propofèrai pour là dé'tririrë ili l’operation
de deifolef, ni 1’âpplicatiôn ifiütile d ’un càutere actuel
, doht l’effet ne s’étënd pas ait-'délà dë la peàü ;
j’indiquerai dé à topiqüéè C'apâBlës de là féfOudre,
tels qüe la pommade mei curiÇli'è, que l’on doit faite
fuccédër à de S friéiibtls fecheS. On peut ëhebre,
àprès àvbir frbiffé là tunieiir oc L’âvbir fortement
cbrfipHm'é'e fbùè le d'bi^t, dans l’intention de brilër
l’humeur qui la forme , y placer tin êrtiplâirè d’dri-
guënt dè Xigo àu triplé de merctirè, ou du diàbota-
jrtum ftièrburifé, 6c rètouvrir le tout d’une plaque de
plomb, que l’bn àftujettira fur là partie par le moyen
d’tln bandage. Il eft même à - ptopoS, loffqiié là tumeur
eft très- confidérable, de la battre avec une petite
palette de bbis avant de tenter de la diffiper par
ces rëfolutifs, que l’on employèra tbûjoürs avec luc-
c'ès, für-tout s’ils font accompagnés des médicamëns
intërnes, qui peuvent atténuer 6c liquéfier là lymphe.
Ces médicâtiiehs Iônt le crocus metalldr'um, donné
à la dofe d’une once chaqüe jour ; l’aqüilà albà,
à là dole d’une dragifie 6c plus ; là poudre dè v ipère,
&c. Si les friêtions, lés ffbtemênS, les cbm-
preffionsbccàfiohhenttineinnadîmatibn, on ne continuera
pas les àppiicatibttS d‘es emplâtres prefeiits ;
On recourra à des topiques ériiolliens, qui iëront fui-
vis de i’iifâgè de cès mêmes emplâtres, lorfqüë la
partie cefferâ d’être enflammée, (e)
* F o r m e , {Papeterie.) chaiiis fur lequel la feuille
de papier prend fa forme ; x\ eft compofé d’un qua-
dre de bois À À , B B {voyez les Plane, de Papeterie.)
de figure quadrilatère^ ma^is plus long que large : le
vuide de ce quadi e en de la grandeur dont on veut
la feuille ; il éft traverfé par dè petits barreaux de
bois, ou des fils de laiton , qu’on appellè vïrjures.
Lès vérjürès ont uné arrête allez tranchante {voye^
les figures K & I ) : là première réprèfente là partie
infëriëùré d’iihè VerjUrè qui èft atrondie ; & l’autre,
la partie fupérieurèÿ Sitr les arrêtes des vëfjures D D ,
qui font àffemblëes dans les longs côtés du chaffis, ôc
qui viennent prefque à fon affleurement , on étend
des fils de laiton B B B , que l ’on fixe les uns auprès
'des. autres pat d’autres fils encore plus fins qui font
le tour des verjures, comme le filet d’une vis fur fon
noyau; de manière qûe le vuide du chaffis foit entièrement
rempli. Ces lignes droites que l’on remarqué
aii papier en le regardant au jour, font les im-
-prëffions des verjures : quant aux écritures 6c mâr-
■ queS-du manufadurier, elles fe font par l’impreffion
d’iin fil de crin coiifu fur la forme, fuivant le deffein
qu’on veüt àvoir. En général, la feuille prend la trace
de toutes lès parties éminentes de l’intérieur du
quadre de la forme.
On voit , f i g . 1 . h f o rm e par-deffüs ; f i g . 2 . la fo rm e
pâr-deffoüs ; 6cf i g . 3. le cadret que fôn tient für la
f o r m e , pour lui fervir de rebord. On conçoit qu’en
plongeant là forrrie daiis Une chaudière pleine d’eau
& de pâte à fairè du papier ; là fàifant entrer de
champ ; là tenant horifdntalement fous l’eâu, enforte
qu’il y a it,par exemple, fix pouces depuis la fur-
face de la fo rm e jufqu’ à la furface de l’eàu ; la levant
èhfuite parallèlement à la furface de l’eau ; on emportera
fur Xa fo rm e foütès les parties de pâte qui fe
trouveront au-dèflus ; que l’eau s’échappera à-tra-*
vers le rëfeau de là fo rm e ; 6c que les parties de pâte
rètenüës s’affâiffant les unes (tir les autres, formé-
rneront une feuille. V o y e ^ l'a r t ic le Pa p e t e r ie . f
* FORMES, en terme de 'Raffineiir defilcre; cè fortt
des moules de terre cuite, de figure Conique, dans
lefqtiels on coule 6c on fait le lucre : la figure leur
eft néceffaire, pouf que les ilrops ne trouvent poifit
de retraité où féjoiirner. Avant de fe fervir des formes
neuves, on les met en trempe pendant vingt-
quàtre heures, pour les dëgrâiffer : mais quand ellés
ont déjà fervi, elles n’y réftent que dolize heures,
après lëfquelles on les lavé 6c on les prépare pour
l’empli, voyeç EMhLl. Il y en à d’autânt cVe fortès
qu’il y a de différens poids dans les pains de fucre ,
ou plûtôt de degrés de fineffe, voye^ SuCre. Il faut
encore qüè toutes les formes fdierit humides avant de
les employ er , excepté celles que l’on prépare pour
les vergeoifës 6c les verpuintes. Voyz^ Verg e o i s es
& VERPUlNf fes.
FdRfiife, {Vénerie.) s’entend d’un efpàcë de terre
fur lequel un filet ëft étendu, en la couvrant ldrfqu’on
l'e fait agir.
Formes fe dit des femelles des oifèaux de proie,
qui donnent le nom à l’efpece ; au lieu que les mâles
s’appellent tiercelets j parce qu’en général, la femelle
dè l’oifeau dë prbiè eft plus grande, plus hardie, 6c
plus forte que ion mâle. Les formes ne font point propres
à la volerie.
FORMÉ, en terme de Blafon. Une croix formée ejft
une croix étroite au centre 6c large aux extrémités ;
c’eft ainfi que l’appellent Leigh 6c Morgan, quoique
la plupart des auteurs la nomment patee. Voyt{ P a«»
t e è .
FORMÉE, adj. f. pris fubftantivement, (Jurifpr.)
ce terme s’applique à plufieurs pbjets différens.
Dans l’ancienne coutume de Çhauny, art. iy. les
formées l'ont les fer vices bue l’on fait pour un défunt;
ce qui vient fans doute ae ce qu’il n’y a que la forme
où repréfentation d’un défunt.
Partie formée , dans quelques coutumes , lignifie
partie civile en matière criminelle. Foye{ H aynàut,
ch. xx j. Larue d’Indre, art. 36, Bourdelois, art, y g .
Office formé, c’eft-à-dire qüi eft créé pour fubfifter
à perpétuité, avec tous les caraûeres d’un véritable
office. VoyeiO f f ic e . {A)
FORMÉES, (L e t t r e s ) ÏÏtterce-formattz; on appela
i t ainfi des lettres dont l’ufage a été commun parmi
les Chrétiens dans les premiers fièçles de l’Eglife,