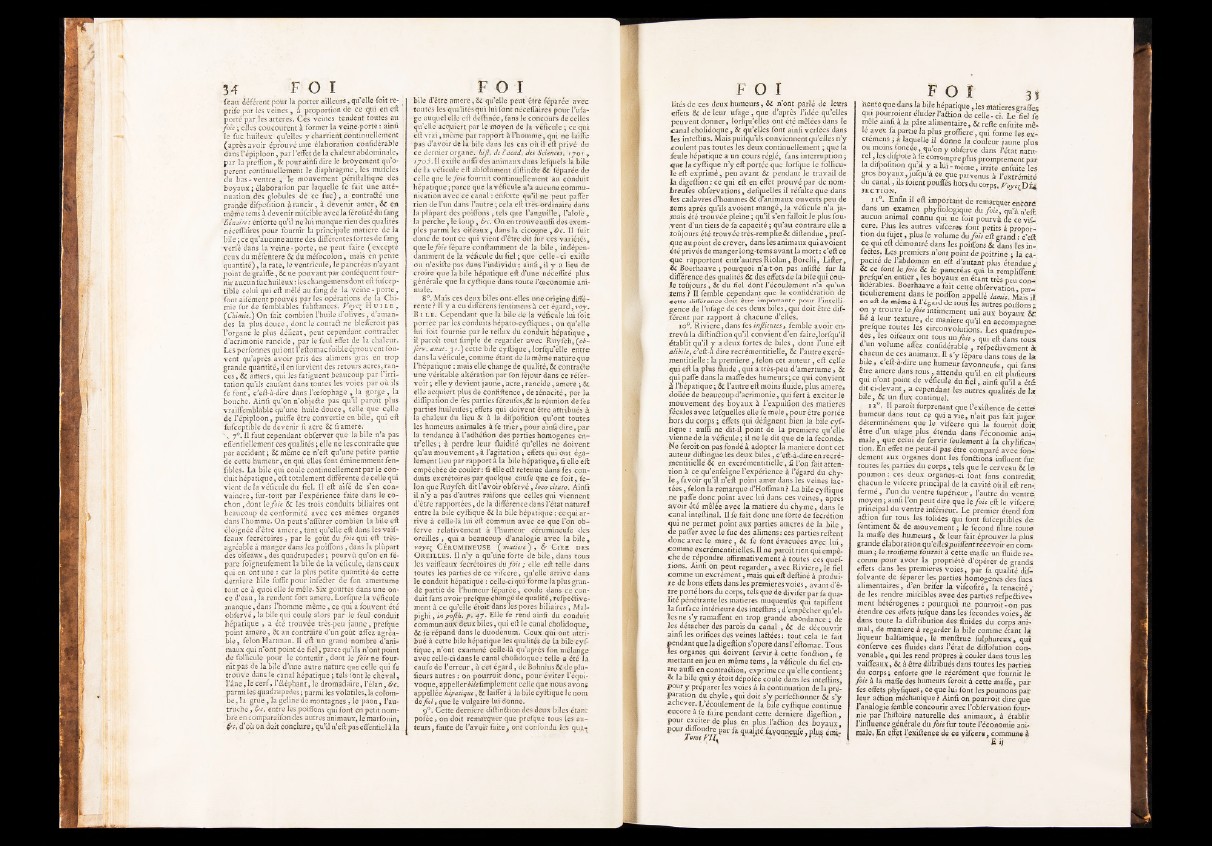
le au déférent pour la porter ailleurs j qii’elle foit re-
.prife par les veines, à proportion de ee qui en eft
porté par,les arteres. Ces veines tendent toutes au
foie ; elles concourent à former la veine-porte : ainli
le fu’c huileux qu’elles, y charrient continuellement
(après avoir éprouvé une élaboration confiderable
dans l’épiploon, par l ’effet de la chaleur abdominale,
par la preffion, & pour aïîifi dire le broyement qu’o-
perent continuellement le diaphragme, les mulcles
clu bas-ventre , le mouvement périftaltique des
boyaux ; élaboration par laquelle le fait une atténuation
des globules de ce fu c ) , a contrarié une
grande difpofition à rancir, à devenir amer, & en
même tems à devenir mifcible avec la férofité du fang
lunaire : enforte qu’il ne lui manque rieti dés qualités
néceffaires pour fournir la principale matière de la
"bile ; ce qu’aucune autre des différentes fortes de fang
verl'é dans la veine - porte, ne peut faire (excepté
ceux duméfentere & du méfocolon, mais en petite
quantité), la rate, le ventricule, le pancréas n’ayant
point de graille, ôc ne pouvant par conféquent fournir
aucun fuc huileux : les changemens dont eft fufcep-
tible celui qui eft mêlé au fang de la veine - porte,
font aifémenr prouvés par les opérations de la Chimie
fur de femblables fubftances. Voye£ H u i l e ,
(Chimie.) On fait combien l’huile d’olives, d’amandes
la plus douce, dont le contari ne blefferoit pas
l’organe le plus délicat, peut cependant contracter
d’acrimonie rancide, par le feul effet de la chaleur.
Les perfonnes qui ont l’eftomac foible éprouvent fou-
vent qu’après avoir pris des alimens gras en trop
grande quantité, il enfurvient des retours acres, rances
, & amers, qui les fatiguent beaucoup par l’irritation
qu’ils caufent dans toutes les voies par où ils
fe font, c’eft-à-dire dans l’oefophage , la gorge , la
bouche. Ainfi qu’on n’objefte pas qu’il paroît plus
vraiffemblable qu’une huile douce, telle que celle
de l’épiploon, püiffe être convertie en bile, qui eft
fufceptible de devenir fi acre & fi amere.
X 7°. Il faut cependant obferver que la bile n’a pas
effentiellemenr ces qualités ; elle ne les contracte que
par accident ; & même ce n’eft qu’une petite partie
de cette humeur, en qui elles font éminemment fen-
fibles. La bile qui coule continuellement par le conduit
hépatique, eft totalement différente de celle qui
vient de la véficule du fiel. Il eft aifé de s’en convaincre
, fur-tout par l’expérience faite dans le cochon
, dont le foie & les trois conduits biliaires ont
beaucoup de conformité avec ces mêmes organes
dans l’homme. On peut s’aflùrer combien la bile eft
éloignée d’être amere, tant qu’elle eft dans les vaif-
feaux feçrétoires, par le goût du foie qui eft très-
agréable à manger dans les poiffons, dans la plûpart
des oifeaux, des quadrupèdes ; pourvu qu’on en fépare
foigrieufement la bile de la véficule, dans ceux
qui-en ont une : car la plus petite quantité de cette
dernière bile fuffit pour inferier de fon amertume
tout ce à quoi elle fe mêle. Six gouttes dans une once
d’eau, la rendent fort amere. Lorfque la véficule
manque,dans l’homme même, ce qui a fouvent été
obfèrvé, la bile qui coule alors par le feul conduit
hépatique , â été trouvée très-peu jaune, prefqüe
point amere, & au contraire d’un goût affez agréable
, félon Hartman. Il eft un grand nombre d’animaux
qui n’ont point de fiel, parce qu’ils n’ont point
de follicule pour le contenir, dont le foie ne fournit
pas de la bile d’une autre nature que celle qui fe
trouve dans le canal hépatique ; tels font le cheval,
l’âné, lé cerf, l’éléphant, le dromadaire, l’élan, &c.
parmi lès quadrupèdes ; parmi les volatiles, la colombe
, la grue, la geline de montagnes, le paon, l’autruche
, &c. entre les poiffons qui font en petit nombre
en comparaifon des autres animaux, le marfouin,
d’où on doit conclure, qu’il n’eft pas effentiel à la
bile d’être amere, & qu’elle peut être féparée avec
toutês les qualités qui lui font néceffairès pour l’ufà-
ge auquel elle eft deftinée, fans le concours de celles
qu’elle acquiert par lé moyen de la vëficûle ; ce qui
eft vrai, même par rapport à l’hoiiimè, qui ne laiffe
pas d’avoir de la bile dans les cas où il eft privé de
ce dernier organe, hiß. de Vacad. des Sciences. i ÿ o t 9
/yoJ.Il exifte àufli des animaux dans lëfquels la bile
de la véficule eft abfolumcnt diftinrie & féparée de
celle que le foie fournit continuellement au conduit
hépatique; parce que la véficule n’a aucune communication
avec ce canal : enforte qu’il riè peut paffer
rien de l’un dans l’autre ; cela eft très-ordinaire dans
la plupart des poiffons , tels que l’anguille, l’alofe,
la perche, le loup, &c. On en trouve aufli des exemples
parmi les oiïèaux, dans la cicôgne -, &c. Il fuit
donc de tout ce qui vient d’être dit fur ces variétés,
que 1 efoie fépare conftarfunent de la bile -, indépendamment
de la véficule du fiel ; que celle-ci exifte
ou n’exifte pas dans l’individu : ainfi, il y a liçu de
croire que la bile hépatique eft d’une nécefïité plus
générale que la cyftique dans toute l’oeconomie animale.
8°. Mais ces deux biles ont-elles une origine différente
? Il y a eu différens fentimens à cet égard, voy.
B i l e . Cependant que la bile de la véficule lui foit
portée par les conduits hépato-eyftiques ; ou qu’elle
lui foit fournie par le reflux du conduit hépatique,
il paroît tout fimple de regarder avec Ruyfch, (ob-
ferv. anat. j i.) cette bile cyftique, lorfqu’élle entre
dans la véficule, comme étant de la même nature que
l ’hépatique : mais elle change de qualité, & contrarie
une véritable altération par fon féjour dans ce réfer-
voir ; elle y devient jaune, acre, rancide, amere ; &
elle acquiert plus de confiftence, de ténacité, par la
diffipation de fes parties féreufes,& la réunion de fes
parties huileufes ; effets qui doivent être attribués à
la chaleur du lieu & à la difpofition qu’ont toutes
les humeurs animales à fe trier, pour ainfi dire, par
la tendance à l’adhéfion des parties homogenes en-
tr’elles ; à perdre leur fluidité qu’elles ne doivent
qu’au mouvement, à l’agitation ; effets qui ont également'
lieu par rapport à la bile hépatique, fi elle eft
empêchée de couler : fi elle eft retenue dans fes Conduits
excrétoires par quelque caufe que ce fo i t , félon
que Ruyfch dit l’avoir obfervé, loco citato. Ainfi
il n’y a pas d’autres raifons que celles qui viennent
d’être rapportées, de la différence dans l’état naturel
entre la bile cyftique ■ & la bile hépatique : ce qui arrive
à celle-là lui eft commun avec ce que l’on ob-
ferve relativement à l’humeür cérumineufe des
oreilles , qui a beaucoup d’analogie avec la bile,
voye{ CÉRUMINEUSE (fnatiere ) , & Cire DES
Oreilles. Il n’y a qu’iine forte de bile, dans tous
les vaiffeaux feçrétoires du foie ; elle eft telle dans
toutes les parties de ce vifeere, qu’elle arrive dans
le conduit hépatique : celle-ci qui forme la plus grande
partie de l’humeur féparée, coule dans ce conduit
fans avoir prefque changé de qualité, refpèriive-
ment à ce qu’elle ëtoit dans les pores biliaires , Mal-
pighi, in poßh. p. 47- Elle fe rènd -ainfi du conduit
commun aux deux biles, qui éft le canal cholidoque,
& fe répand dans le duodénum. Ceux qui ont attribué
à cette bile hépatique les qualités de la bilëcyf-
tique, n’ont examiné celle-là qu’après fon mélange
avec celle-ci dans le canal cholidoque : telle a été la
caufe de l’erreur, à cet égard, de Bohnîus & de plu-
fieurs autres : on pourroit donc, pour éviter l’équivoque,
appellerai/« Amplement celle que nous avons
appellée hépatique, & laiffer à la bile cyftique le nom
de fiel, que le vulgaire lui donne.
9°. Cette derniere diftinriion des deux biles étant
polée, on doit remarquer que prefque tous les auteurs
, faute de l’avoir faite, ont confondu les qualités
de ces deux humeurs, & n’ont parle de leurs
effets & de leur ufage, que d’après l’idée qu’elles
peuvent donner, lorfqu’elles ont été mêlées dans le
canal cholidoque, & qu’elles font ainfi verfées dans
les inteftins. Mais puifqu’ils conviennent qu’elles n’y
coulent pas toutes les deux continuellement ; que la
feule hépatique a un cours réglé, fans interruption ;
que la cyftique n’y eft portée que lorfque le follicule
eft exprimé, peu avant & pendant le travail de
la digeftion : ce qui eft en effet prouvé par de nom-
fcreufes obfervations, defquelles il réfulte que dans
les cadavres d’hommes & d’animaux ouverts peu de
lems après qu’ils avoient mangé, la véficule n’a jamais
été trouvée pleine ; qu’il s’en falloir le plus fou-
,vent d’un tiers de fa capacité ; qu’au contraire elle a
toujours été trouvée très-remplie & diftendue, prefque
au point de crever, dans les animaux qui avoient
été privés de manger long-tems avant la mort : c’eft ce
<jue rapportent entr’autres Riolan, Borelli, Lifter,
& Boerhaave ; pourquoi n’a-t-on pas infifté fur la
différence des qualités & des effets de la bile qui coule
toûjours, & du fiel dont l’écoulement n’a qu’un
tems ? Il femble cependant que la confidération de
cette différence doit être importante pour l’intelligence
de l’ufage de ces deux biles, qui doit être différent
par rapport à chacune d’elles.
io°. Rivière, dans fes inflitutes, femble avoir en-
trevûla diftinriion qu’il convient d’en faire,lorfqu’il
établit qu’il y a deux fortes de biles, dont l’une eft
alibile, c’eft-à dire recrémentitielle, & l’autre excré-
anentitielle : la première, félon cet auteur, eft celle
qui eft la plus fluide, qui a très-peu d ’amertume, &
qui paffe dans la maffe des humeurs ; ce qui convient
à l’hépatique ; & l’autre eft moins fluide, plus amere,
douée de beaucoup d’acrimonie, qui fert à exciter le
mouvement des boyaux à l ’expulfion des matières
fécales avec lefquellès elle fe mêle, pour être portée
hors du corps ; effets qui défignent bien la bile cyf-
îique : aufli ne dit-il point de la première qu’elle
vienne de la véficule ; il ne le dit que de la fécondé*
Ne feroit-on pas fondé à adopter la maniéré dont cet
auteur diftingue les deux biles, c ’eft-à-dire en recré-
mentitiellé & en excrémentitielle, fi l’on fait attention
à ce qu’enfeigne l’expérience à l’égard du chyle
, favoir qu’il n’eft point amer dans les veines lactées
, félon la remarque d’Hoffman ? La bile cyftique
ne paffe donc point avec lui dans ces veines, après
avoir été mêlée avec la matière du chyme, dans le
canal inteftinal. Il fe fait donc une forte de fecrétion
qui ne permet point aux parties ameres de la b ile,
de paffer avec le fuc des alimens : ces parties reftent
donc avec le marc, & fe font évacuées avec lu i,
.comme excrémentitielles. Il ne paroît rien qui empêche
de répondre affirmativement à toutes ces quef-
iions. Ainfi on peut regarder, avec Riviere, le fiel
comme un excrement, mais qui eft deftiné à produire
de bons effets dans les premières voies, avant d’être
porté hors du corps, tels que de divifer par fa qualité
pénétrante les matières muqueufes qui tapiffent
la furface intérieure des inteftins ; d’empêcher qu’elles
ne s’y ramaffent en trop grande abondance • de
les détacher des parois du canal , & de découvrir
ainfi les orifices des veines lariées: tout cela le fait
pendant que la digeftion s’opère dans l’eftomac. Tous
les organes qui doivent fervir à cette fonriion, fe
mettant en jeu en même tems, la véficule du fiel en»
tre aufli en contrariion, exprime ce qu’elle contient •
& la bile qui y étoit dépofée couîe dans les inteftins,
pour y préparer les voies à la continuation de la préparation
du ch y le, qui doit s’y perferiionner & s’y
achever. L ’écoulement de la bile cyftique continue
eocore à fe faire pendant cette derniere digeftion,
pour exciter de plus en plus l’ariion des boyaux
pour diffoudre par fa qualité fayonneufe, plus émihente
que dans la bile hépatique, les matières graffes
quipourroient eluderl’ariion de celle-ci; Le fiel fe
mêle ainfi à la pâte alimentaire, & refte enfuite me*
le avec la partie la plus groffiere, qui forme les ex*
cremenâ ; a laquelle il donne la Couleur jaune plus
ou morns foncée , qu’on y obferve dans l’état natu-
, ’.J.es JHFfo16 à corrompre plus promptement par
la diQjofiüon <ju il y a Mi - même, irrite enfuite des
gros boyaux, ,ufqu à ce que parvenus à l’extrémité
du canal, ils fotent pouffes hors du corps FayerDéa
SECTION. * V —*
u ° . Enfin il eft important de remarhuei éntorê
dans un examen phyfiologique, du foie, qii’iln’eff
aucun animal connu qui ne .foit? pourvu de ee vifeere.
Plus les autres vifçeres font, petits à propoir-'
tion du fujet, plus le volume du foie eft grand : e’eft
ce qui eft démontré dans les poiffons & dans les iii-
feûes. Les premiers n’ont point de poitrine ; là cà-
pacité de l’abdomen en eft d’autant plus ii'enipeJ
& ce font le foie & le pancréas qui la rempliffenr
prefqu’en entier, les boyaux en.étant très-peu con-
liderables. Boerhaave a fait celle obfervation nar-
tteuherement dans le poiffon appelle lomU. Mais iï
en eft de. même à l ’egard de tous les autres poiffons ;
on y trouve le fou intimement uni aux boyaux &
lie à leur texture, de maniéré qu’il en accompagne
prefque toutes les circonvolutions. Les quadrupèdes
, les oifeaux ont tous xmfoif , qui eft dans t in s
d un volume affqz. confiderabie , refpeaiyement k
chacun de ces animaux. U s ’y fépare dans tous de l s
bile, c elt-à-dire une humeur favonneufe, qui fans
etre amere dans tous, attendu qu’il en eft plulieurs
qui n ont point de véficule du fiel, ainfi qu’il a été
dit ci-devant, a cependant les autres qualités de la
bile, & un flux continuel.
12 . Il paroît furprenant que Fexiftence de cettè
humeur dans tout ce qui a v ie , n’ait pas fait juger,
déterminément que le vifeere qui la fournit doit.
être d’un ufage plus étendu dans l’économie ani-;
male, que celui de fervir feulement à la chylifica-j
tion. En effet ne peut-il pas être comparé avec fbn-!
dement aux organes dont les fonriions influent fur,
toutes lçs. parties du corps, tels que le cerveau & le
poumon : ces deux orgaries-ci font fans contredit,
chacun le vifeere principal de la cavité où il eft ren-;
fermé, l’un du ventre fupérieur, l’autre du ventre
moyen ; ainfi l’on peut dire que le foie eft le vifeeré'
principal du ventre inférieur. Le premier étend fon
ariion fur tous les lolides qui font fufceptibles de
fentiment & de mouvement ; le fécond filtre toute
la maffe des humeurs, & leur fait éprouver la plus
grande élaboration qu’ellespuiffentrecevoir en côm-*
mun ; le.troifieme fournit à cette maffe un fluide reconnu
pouf avoir la propriété d’opérer de grands:
effets dans les premières voies, par fa qualité dif-
folvante de féparer les parties homogènes des fucs
alimentaires, d’en brifer la vifeolité, la ténacité
de les rendre miicibles avec des parties refperiive-
ment hétérogènes : pourquoi ne pourroit-on pas
étendre ces effets jufque dans les fécondés voies, &
dans toute la diftribution des fluides du corps animal
, de maniéré à regarder la bile comme étant la
liqueur balfamique, le menftrue fulphureux, qui
conferve ces fluides dans l’état de diffolution convenable
, qui les rend propres à couler dans tous les
.vaiffeaux, &c à être diftribués dans toutes les parties
du corps ; enforte que le récrément que fournit le
foie à la maffe des humeurs feroit à cette maffe, par
fes effets phyfiques, ce que lui font les poumons par
leur ariion méchanique ? Ainfi on pourroit dire que
l’analogie femble concourir avec l’obfervation fournie
par l’hiftoire naturelle des animaux, à établir
j ’influence générale du foie fur toute l’économie animale.
En effet l’exiftençe de ce yifeere, commune à
E ÿ