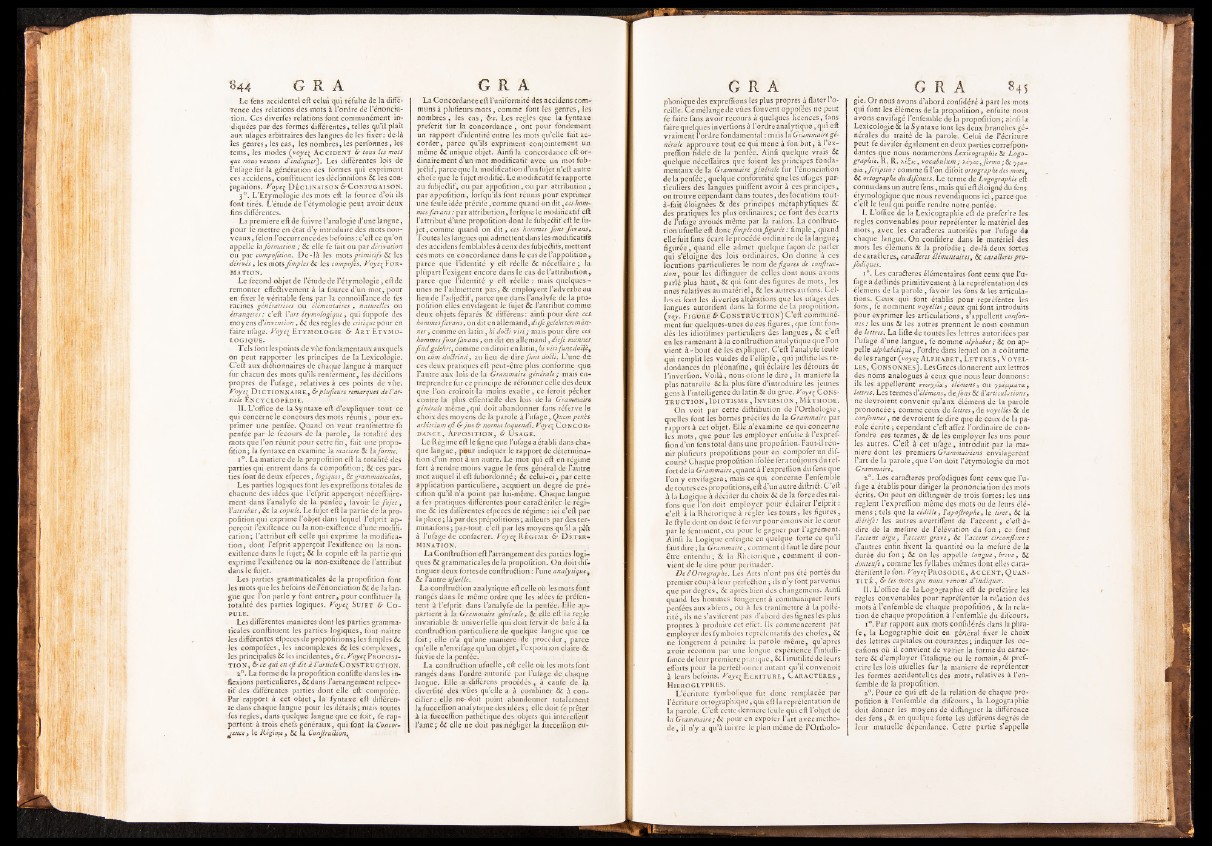
Le fens accidentel eft celui -qui refaite de la différence
des relations des mots à l’ordre de dénonciation.
Ces diverfes relations font communément indiquées
par des formes différentes, telles qu’il plaît
•aux ufages arbitraires des langues de les fixer: de-là
les genres, les cas, les nombres, les perfonnes, les
teins, les modes (yoyc^ A-c c id e n t & tous les mots
que nous venons d’indiquer). Les différentes lois de
l ’ufage fur la génération des formes qui expriment
ces accidens, conftituent les déclinaifons & les con-
•jugaifons. Voye{ DÉCLINAISON 6*CONJUGAISON.
3°. L ’Etymologie des mots eft la fource d’où ils
'font tirés. L’étude de l’étymologie peut avoir deux
fins différentes.
La première eft de fuivre l’analogie d’une langue,
pour le mettre en état d’y introduire des mots nouveaux,
félon l ’occurrence des befoins : c’eft ce qu’on
appelle la formation ; & elle fe fait ou par dérivation
ou -par compojition. D e - là les mots primitifs & les
dérivés , les motsJimples & les compofés. Voye^ F o r m
a t io n .
Le fécond objet de l’étude de l’étymologie, eft de
remonter effectivement à la fource d’un mot, pour
en fixer le véritable fens par la connoiffance de fes
racines génératrices ou élémentaires , -naturelles ou
étrangères : c’eft Y art étymologique, qui fuppole des
moyens d'invention, & des regies de critique pour en
faire ufage. Voye^ Et y m o l o g i e & A r t E t y m o l
o g iq u e .
Tels font les points de vue fondamentaux auxquels
on peut rapporter les principes de la Lexicologie.
C ’eft aux dictionnaires de chaque langue à marquer
fur chacun des mots qu’ils renferment, les décifions
propres de l’ufage, relatives à ces points de vue-.
Voyt{ DICTIONNAIRE, & plufieurs remarques de l'article
En c y c l o p é d i e .
II. L’office de la Syntaxe eft d’expliquer tout ce
qui concerne le concours des mots reunis, pour exprimer
une penfée. Quand on veut tranfmettre fa
penfée par le fecours de la parole, la totalité des
mots que l’on réunit pour cette fin, fait une propo-
fition ; la fyntaxe en examine la matière & la forme.
i° . La matière de la propofition eft la totalité des
parties qui entrent dans fa compofition ; & ces parties
font de deux efpeces, logiques, & grammaticales.
Les parties logiques font les expreffions totales de
chacune des idées que l’efprit apperçoit néceflaire-
ment dans l’analyfa de la penfée, favoir l e fuje t,
l’attribut ,S z la copule. Le fujet eft la partie de la propofition
qui exprime l’objet dans lequel l’efprit apperçoit
Pexiftence ou la non-exiftence d’une modification;
l’attribut eft celle qui exprime la modifica-
tion, dont l’efprit apperçoit l’exiftence ou la non-
exiftence dans le fujet; & la copule eft la partie qui
exprime l’exiftence ou la non-exiftence de l’attribut
dans le fujet.
Les parties grammaticales de la propofition font
les mots que les befoins de l’énonciation ôc de la langue
que l’on parle y font entrer, pour conftituer la
totalité des parties logiques. Voye^ Sujet & C opule.
Les différentes maniérés dont les parties grammaticales
conftituent les parties logiques, font naître
les différentes efpeces de propofitions ; les fimples &
les compofées, les incomplexes & les complexes,
les principales àc les incidentes, &c. Voye[ Pr o p o s i t
i o n , & ce qui en ejl dit à l'article CONSTRUCTION.
a°. La forme de la propofition confifte dans les inflexions
particulières, & dans l’arrangement refpec-
tif des différentes parties dont elle eft compofée.
Par rapport à cet objet, la fyntaxe eft différen- ;
te dans chaque langue pour les détails; mais toutes
fes regies, dans quelque langue que ce fait, fe rap- ;
portent à. trois chefs généraux , qui font la Concor-
fptnçe y le Régime , ÔC la Confiruclion,
La Concordance eft l’uniformité des accidens corn*-
muns à plufieurs mots, comme font les genres, les-
nombres, les cas, &c. Les réglés que la fyntaxe
preferit far la concordance, ont pour fondement
un rapport d’identité entre les mots qu’elle fait accorder,
parce qu’ils expriment conjointement un
même & unique objet. Ainfi la concordance eft ordinairement
d’un mot modificatif avec un mot fub-
je âif, parce que la modification d’un fujet n’eft autre
chofe que le fujet modifié. Le modificatif fe rapporte
au fubjeûif, ou par appofition, ou par attribution ;
par appofition, lorfqu’ils font réunis pour exprimer
une feule idée précife,'comme quand on d it, ces hommes
favans ; par attribution, lorlque le modificatif eft
l’attribut d’une propofition dont le fubje&if eft le fujet
, comme quand on d it , ces hommes font favans.
Toutes les langues qui admettent dans les modificatifs
des accidens femblables à ceux des fubje&ifs, mettent
ces mots en concordance dans le cas de l’appofition ,
parce que l’identité y eft réelle & néceffaire ; la
plupart l’exigent encore dans le cas de l’attribution,
parce que l’identité y eft réelle : mais quelques -
unes ne l’admettent pas, & employent l’adverbe au
lieu de l’adjeéHf, parce que dans l’analyfe de la propofition
elles envifagent le fujet & l’attribut comme
deux objets féparés & différens: ainfi pour dire ces
hommes favans, on dit en allemand, diefe gelehrten,m'àn-
ner, comme en latin, hi doctiviri; mais pour dire ces
hommes fontfavans, on dit en allemand, diefe mànnet.
findgelehn, comme on diroit en latin, hiviri funtdocfè,
ou cùm doclrind, au lieu de dire funt docti. L’une de
ces deux pratiques eft peut-être plus conforme que
l’autre aux lois de la Grammaire générale; mais entreprendre
fur ce principe de réformer celle des deux
que l’on croiroit la moins exafte , ce feroit pécher.
Contre la plus effentielle des lois de la Grammaire
générale même, qui doit abandonner fans réferve le
choix des moyens de la parole à l’ufage, Qiiem penès
arbitrium ejl & jus & norma loquendi. Voye%_ C O N C O R D
A N C E , A p p o s i t i o n , & U s a g e .
Le Régime eft le figne que l’ufage a établi dans char
que langue, peur indiquer le rapport de détermination
d’un mot à un autre. Le mot qui eft en régime
fart à rendre moins vague le fens général de l’autre
mot auquel il eft fabordonné; & celui-ci, par cette
application particulière, acquiert un degré de pré-
cifion qu’il n’a point par lui-même. Chaque langue
a fes pratiques différentes pour caraftérifar le régime
& les différentes efpeces de régime : ici c’eft par
la place ; là par des prépofitions ; ailleurs par des ter-
minaifons ; par-tout c’eft par les moyens qu’il a p^u
à l’ufage de confacrer. Voye^ R é g im e & D é t e r m
in a t io n .
La Conftruttion eft l’arrangement des parties logiques
& grammaticales de la propofition. On doit distinguer
deux fortes de conftru&ion : l’une analytique,
& l’autre ufuelle.
La conftru&ion analytique eft celle où les mots font
rangés dans le même ordre que les idées fa préfen-
tent à l’efprit dans l’analyfe de la penfée.,Elle appartient
à la Grammaire générale, & elle eft la réglé
invariable & univerfelle qui doit farvir de bafe à la
conftruétion particulière de quelque langue que ce
fait ; elle n’a qu’une maniéré de procéder, parce
qu’elle n’envifage qu’un objet, l’expofuion claire &
fuivie de la penfée.
La conftrudion ufuelle, eft celle où les mots, font
rangés dans l’ordre autorifé par l’ulage de chaque
langue. Elle a différens procédés , à caufe de la
diverlité des vues qu’elle a à combiner & à concilier:,
elle ne-doit point abandonner totalement
la fucceffion analytique des idées ; elle doit fe prêter
à la fucceffion pathétique des .objets qui intéreffent
l’ame ; & elle ne doit pas négliger la fucceffion euphonique
des expreffions les plus propres à flater l’oreille.
Ce mélange de vues fouvent oppofées ne peut
fa faire fans avoir recours à quelques licences, fans
faire quelques inverfions à l’ordre analytique, qui eft
vraiment l’ordre fondamental : mais la Grammaire générale
approuve tout ce qui triene à fan but, à l’ex-
preffion hdele de la penfée. Ainfi quelque vrais &
quelque néceffaires que foient les principes fondamentaux
de la Grammaire générale fur l’énonciation
de la penfée ; quelque conformité que les ufages particuliers
dès langues puiffent avoir à ces principes,
on trouve cependant dans toutes, des locutions tout-
à-fait éloignées & des principes métaphyfiques &
des pratiques les plus ordinaires ; ce font des écarts
de l’ufage avoués même par la raifon. Là conftruc-
tion ufuelle eft donc fimple ou figurée : fimple, quand
elle fuit fans écart le procédé ordinaire de la langue;
figurée, quand elle admet quelque façon de parler
qui s’éloigiie des lois Ordinaires. On donne à ces
locutions particulières le nom de figures de cohfiruc-
tion, pour les diftinguer de celles dont nous avons
parié plus haiit, & qui.font des figures de mots, les
unels relatives âü matériel, & les autres au fans. Celles
ci font les di verfes altérations que les ufages des
langues autorifent dans la forme de la propofition.
(yoy. Figure 6* C o n s tr u c t io n ) C’eft communément
fur quelques-unes de ces figures, que font fondés
les idiotifmes particuliers des langues, & c’eft
en les ramenant à la conftruûion analytique que l’on
vient à-bout de les expliquer. C ’eft l’analyfe feule
qui remplit les vuides de l’ellipfe, qui juftifie les. redondances
du pléonafme, qui éclaire les détours de
l ’inverfion. V oilà, nous ofons le dire, la maniéré la
plus naturelle & la plus fûre d’introduire les jeunes
gens à l’intelligence du latin & du grec. Voye^ C onst
r u c t io n , I d io t ism e , In v er s io n , Mé th o d e .
On voit par cette distribution de l’Orthologie,
quelles font les bornes précifes de la Grammaire par
rapport à cet objet. Elle n’examine ce qui concerne
les mots, que pour les employer enfuite à l’expref-
fion d’un fens total dans une propofition. Faut-il réunir
plufieurs propofitions pour en compofer un dif-
cours? Chaque propofition ifolée fera toujours du ref-
fort de la Grammaire, quant à l’expreffion du fens que
l’on y envifagera ; mais ce qui concerne l’enfamble
de toutes ces propofitions, eft d’un autre diftriû. C ’eft
à la Logique à décider du choix & de la force dès rai-
fans que l’on doit employer pour éclairer l’efprit :
c’eft à la Rhétorique à régler les tours, les figures,
le ftyle dont on doit fe farvir pour émouvoir le coeur
par le fentiment, ou pour le gagner par l’agrément.
Ainfi la Logique enfaigne en quelque forte ce qu’il
faut dire ; la Grammaire, comment il faut le dire pour
être entendu; & la Rhétorique, comment il convient
de le dire pour perfaader.
De POrtographe. Les Arts n’ont pas été portés du
premier coup à leur perfeftion ; ils n’y font parvenus
que par degrés, & après bien des changemens. Ainfi
quand les hommes fongerent à communiquer leurs
penfées aux abfans, ou à les tranfmettre à la polté-
rité, ils ne s’aviferent pas d’abord des lignes les plus
propres à produire cet effet. Ils commencèrent par
employer desfymboles repréfentatifs des chofes, &C
ne fongerent à peindre la parole même, qu’après
avoir reconnu par une longue expérience l’infuffi-
fance de leur première pratique, & l’inutilité de leurs
efforts pour la perfectionner autant qu’il convenoit
à leurs befoins. Voye^ Ec r itu r e , C a r a c t è r e s ,
Hiérogly ph es.
L ’écriture fymboüque fat donc remplacée par
l’écriture ortographique, qui eft la repréfentation de
la parole. C ’en cette derniere feule qui eft l’objet de
la Grammaire ; & pour en expofar l’art avec méthode
, il n’y a qu’à fuivre le plan même de l’Orthologie.
O r nous avons d’abord confidéré à part les mots
qui font les élémens de la propofition, enfuite nous
avons envifagé l’enfamble de la propofition; ainfi la
Lexicologie & la Syntaxe (ont les deux branches générales
du traité de la parole. Celui de l’écriture
peut fe divifer également en deux parties correfpon-
dantes que nous nommerons Lexicographie & Logo-
graphie. R. R. \l%/ç, vocabulum; Xoyoç ,fermo ; & ypx-
iplet, feriptio : comme fi l’on difoit ortographe des mots,
& ortographe du difeours. L e terme de Logographie eft
connu dans un autre fens, mais qui eft éloigné du fans
étymologique que nous revendiquons ici, parce que
c eft le feùl qui puiffe rendre notre penfée.
I. L’office de la Lexicographie eft de preferire les
réglés convenables pour repréfanter le matériel des
mots, avec les cara&eres autorifés par l’ufage da
chaque langue. On confidere dans le matériel des
mots les élémens & la profadie ; de-là deux fartes
de cara&eres, caractères élémentaires, & caractèrespro-
fodiques. -
i° . Les c-arafteres élémentaires font ceux que l’u-
fage a deftinés primitivement à la repréfentation des
élémens dé la parole, favoir les fans & les articulations!
Ceux qui font établis pour repréfanter les
fans, fe nomment voyelles ; ceux qui font introduits
pour exprimer les articulations, s’appellent confon-
nes : les uns & les autres prennent le nom' commun
de lettres. La lifte de toutes les lettres autorifées par
l’ufage d’une langue, fe nomme alphabet; & on appelle
alphabétique, l’ordre dans lequel on a coutume
de les ranger (voye^ Alphabet, Lettres , Voyelles,
Consonnes). Les Grecs donnèrent aux lettres
des noms analogues à ceux que nous leur donnons:
ils les appellerent rroryua. , élémens, ou ypà/j./j.cvTcL,
lettres. Les termes d’élémens, de fions & d’articulations,
ne devroient convenir qu’aux élémens de la parole
prononcée ; comme ceux de lettres, de voyelles & de
confonnes , ne devroient fe dire que de ceux de la parole
écrite ; cependant c’eft affez l’ordinaire de confondre
ces termes, & de les employer les uns pour
les autres. C ’eft à cet ufage, introduitpar la maniéré
dont les premiers Grammairiens envifagerent
l’art de la parole, que l’on doit l’étymologie du mot
Grammaire.
i ° . Les caraôeres profodiques font ceux que l’ufage
a établis pour diriger la prononciation des mots
écrits. On peut en diftinguer de trois fortes: les uns
règlent l’expreffion même des mots ou de leurs élémens
; tels que la cédille, Yapoflrophe, le tiret, & la
diéréfe: les autres avertiffent de l’accent, c’eft-à-
dire de la mefure de l’élévation du fan ; ce font
Y accent aigu, Y accent grave , &C Y accent circonflexe :
d’autres enfin fixent la quantité ou la mefure de la
durée du fan ; & on les appelle longue, breve, &
douteufe, comme les fyllabes mêmes dont elles cara-
ftérifent le fan. Voye{Prosodie, Accent, Quantité
, & les mots que nous venons d ’indiquer.
II. L’office de la Logographie eft de prefa/rire les
réglés convenables pour repréfanter la relation des
mots à l’enfamble de chaque propofitiori, & la relation
de chaque propofition à l’enfembie du difeours*
i° . Par rapport aux mots confidérés dans la phra-
f a , la Logographie doit en général fixer le choix
des lettres capitales ou courantes ; indiquer les oc-
cafions où il convient de varier la forme du caractère
& d’employer l’italique ou le romain, & preferire
les lois ufuelles fur la maniéré de repréfanter
les formes accidentelles des mots, relatives à l’enfembie
de la propofition.
20. Pour ce qui eft de la relation de chaque propofition
à l’enfemble du difeours, la Logographie
doit donner les moyens de diftinguer la différence
des fens, & en quelque forte les différens degrés de
leur mutuelle dépendance. Cette partie s’appelle