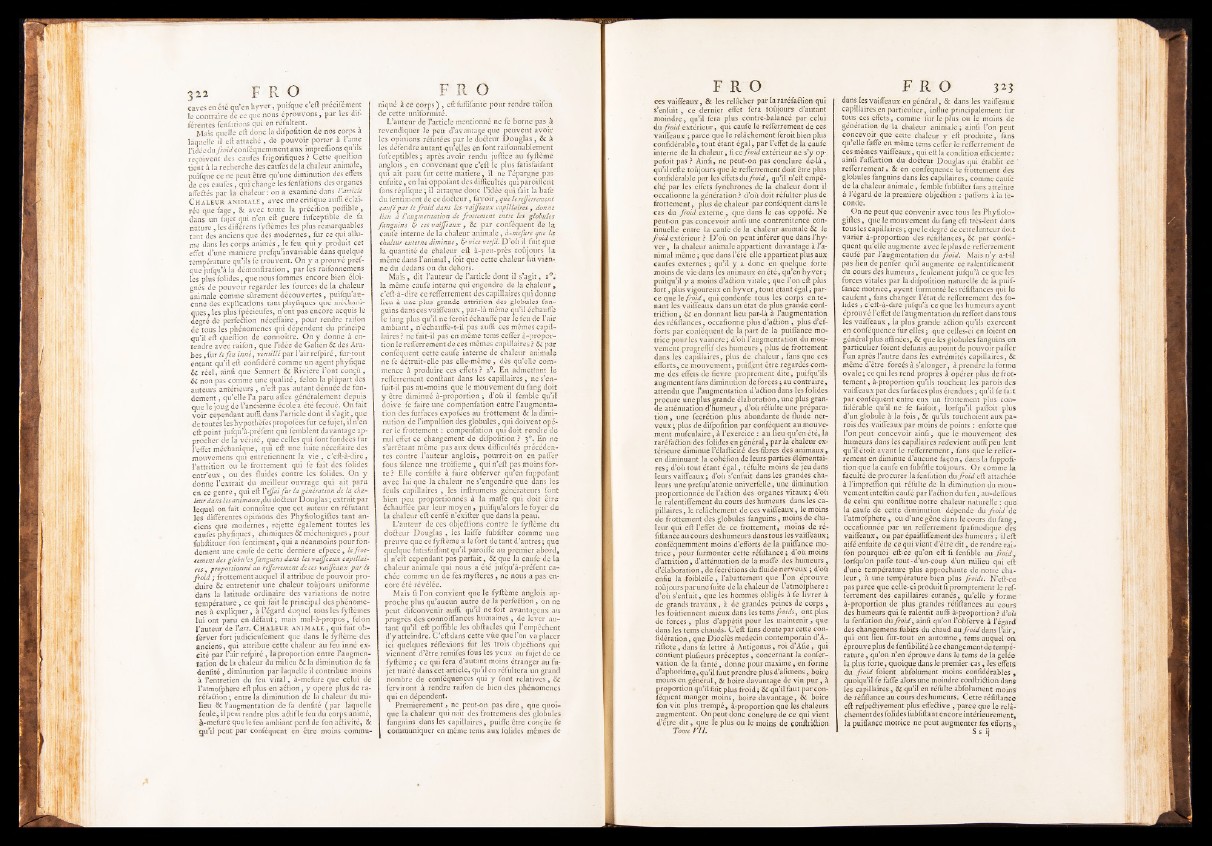
caves en été qu’en hyver, puifque c eft precifement
le contraire de ce que nous éprouvons, par les différentes
fenfations qui en refultent.
Mais quelle eft donc la difpofition de nos cofps à
laquelle il eft attaché , de pouvoir porter à l’ame
l’idée du froid conféquemment aux impreffions qu’ils
reçoivent des caufes frigorifiques ? Cette queftion
tient à la recherche des caufes de la chaleur animale,
puifque ce ne peut être qu’une diminution des effets
de ces caufes, qui change les fenfations des organes
affeâés par la chaleur : on a examiné dans l ’article
C h a l e u r a n im a l e , avec une critique auffi éclairée
que fage, & avec toute la précifion poflible ,
dans un fujet qui n’en eft guere fufceptible de fa
nature , les différens fyftèmes les plus remarquables
tant des anciens que des modernes, fur ce qui allume
dans les corps animés , le feu qui y produit cet
effet d’une maniéré prefqu’invariable dans quelque
température qu’ils fe trouvent. On y a prouvé pref-
que jufqu’à la démonftration, par les raifonnemens
les plus folides, que nous fommes encore bien éloignés
de pouvoir regarder les fources de la chaleur
animale comme sûrement découvertes, puifqu’au-
cune des explications tant phyfiques que méchani-
ques, les plus fpécieufes, n’ont pas encore acquis le
degré de perfeâion nécèffaire, pour rendre raifon
de tous les phénomènes qui dépendent du principe
qu’il eft queftion de connoître. On y donne à entendre
avec raifon, que l’idée de Galien & des Arabes
, fur le feu inné, venïdlè par l ’air refpiré, fur-tout
entant qu’il eft confidéré comme un agent phyfique
& réel, ainli que Sennert & Riviere l’ont conçu,
& non pas comme une qualité, félon la plupart des
auteurs antérieurs , n’eft pas autant dénuée de fondement
, qu’elle l’a paru affez généralement depuis
que le joug de l’ancienne école a été fecoué. On fait
voir cependant auffi dans l’article dont il s’agit, que
de toutes les hy pothèfes propofées fur ce fujet, il n’en
eft point jufqu’à-préfent qui femblent davantage ap- i
procher de la vérité, que celles qui fontfondées fur
l’effet méchanique, qui eft une fuite néceffaire des j
mouvemens qui entretiennent la vie , c ’eft-à-dire, j
l’attrition ou le frottement qui fe fait des folides 1
entr’eu x , ou des fluides contre les folides. On y
donne l’extrait du meilleur ouvrage qui ait paru
en ce genre, qui eft Veffai fur la génération de la chaleur
dans les animaux,du dorieur Douglas ; extrait par
lequel on fait connoître que cet auteur en réfutant
les différentes opinions des Phyfiologiftes tant anciens
que modernes, rejette également toutes les
caufes phyfiques, chimiques & méchaniques, pour
fubftituer fon fentiment, qui a néanmoins pour fondement
une caufe de cette derniere efpece, le frottement
des globu'es fanguins dans les vaijfeaux capillaires
proportionné au refferrement de ces vaiffeaux par le
froid ; frottement auquel il attribue de pouvoir produire
6c entretenir une chaleur toujours uniforme
dans la latitude ordinaire des variations de notre
température, ce qui fait le principal des phénomènes
à expliquer, à l’égard duquel tous les fyftèmes
lui ont paru en défaut ; mais mal-à-propos, félon
l ’auteur de Vart. C h a l e u r a n im a l e , qui fait ob-
ferver fort judicieufement que dans le fyftème des
anciens, qui attribue cette chaleur au feu inné excité
par l’air refpiré, la proportion entre l’augmentation
de la chaleur du milieu 6c la diminution de fa
denfité , diminution par laquelle il contribue moins
à l’entretien du feu v ita l, à-mefivre que celui de
l’atmofphere eft plus en aérion, y opéré plus de raréfaction
-, entre la diminution de la chaleur du milieu
6c l’augmentation de fa denfité (par laquelle
feule, il peut rendre plus a&iflefeu du corps animé,
à-mefure que le feu ambiant perd de fon aftivité, &
qu’il peut par conféquent en être moins communiqué
à cé côrps ) , eft fuffifante pour rendre raifon
de cette uniformité.
L’auteur de l’article mentionné ne fe borne pas à
revendiquer le peu d’avantage que peuvent avoir
les opinions réfutées par le do&eur Douglas , 6c à
les défendre autant qu’elles en font raifonnablement
fufceptibles ; après avoir rendu juftice au fyftème
anglois, en convenant que c’eft le plus fatisfaifant
qui ait paru fur cette matière, il ne l’épargne pas
enfuite, en lui oppofant des difficultés quiparoiffent
fans réplique ; il attaque donc l’idée qui fait la bafe
du fentiment de ce do&eur, favoir, que le refferrement
caufé par le froid dans les vaiffeaux capillaires , donne
lieu à U augmentation de frottement entre les globules
fanguins & ces vaijfeaux , 6c par conféquent de la
caufe interne de la chaleur animale, à-mefurè que la
chaleur externe diminue , & vice verfd. D ’oîi il fuit que
la quantité de chaleur eft à-peu-près toûjours la
même dans l’animal, foit que cette chaleur lui vienne
du dedans ou du dehors.
Mais, dit l’auteur de l’article dont il s’agit, i°.'
la même caufe interne qui engendre de la chaleur ,
c’eft-à-dire ce refferrement des capillaires qui donne
lieu à une plus grande attrition des globules fanguins
dans ces vaifleaux, par-là même qu’il échauffe
le fang plus qu’il ne feroit échauffé par le feu de l’air
ambiant, n’echauffe-t-il pas auffi ces mêmes capillaires
? ne fait-il pas en même tems ceffer à-proportion
le refferrement de ces mêmes capillaires ? 6c par
conféquent cette caufe interne de chaleur animale
ne fe détruit-elle pas elle-même, dès qu’elle commence
à produire ces effets ? 2°. En admettant le
refferrement confiant dans les capillaires, ne s’enfuit
il pas au-moins que le mouvement du fang doit
y être diminué à-proportion ; d’où il femble qu’il
doive fe faire une compenfation entre l’augmentation
des furfaces expofées au frottement & la diminution
de l’impulfion des globules, qui doivent opérer
le frottement : compenfation qui doit rendre de
nui effet ce changement de difpofition ? 30. En ne
s’arrêtant même pas aux deux difficultés précédentes
contre l’auteur anglois, pourroit-on en paffer
fous filence une troifieme, qui n’eft pas moins forte
? Elle confifte à faire obferver qu’en fuppofant
avec lui que la chaleur ne s’engendre que dans les
feuls capillaires , les inftrumens générateurs font
bien peu proportionnés à la maffe qui doit être
échauffée par leur moyen, puifqu’alors le foyer de
la chaleur eft cenfé n’exifter que dans la peau.
L’auteur de ces objections contre le fyftème du
dofteur Douglas , les laiffe fubfifter comme une
preuve que ce fyftème a le fort de tant d ’autres ; que
quelque fatisfaifant qu’il paroiffe au premier abord,
il n’eft cependant pas parfait, 6c que la caufe de la
chaleur animale qui nous a été jufqu’à-préfent cachée
comme un de fes myfteres, ne nous a pas encore
été révélée.
Mais fi l’on convient que le fyftème anglois approche
plus qu’aucun autre de la perfection, on ne
peut difconvenir auffi qu’il ne foit avantageux au
progrès des connoiffances humaines , de lever autant
qu’il eft poflible les obftacles qui l’empêchent
d’y atteindre. C’eft dans cette vue que l’on va placer
ici quelques réflexions fur les trois objections qui
viennent d’être remifes fous les yeux au fujet de ce
fyftème ; ce qui fera d’autant moins étranger au fujet
traité dans cet article, qu’il en réfultera un grand
nombre de conféquences qui y font relatives, 6c
ferviront à rendre raifon de bien des phénomènes
qui en dépendent.
Premièrement, ne peut-on pas dire, que quoique
la chaleur qui naît des frotremens des globules
fanguins dans les capillaires, puiffe être conçue fe
communiquer en même tems aux folides mêmes de
ces vaiffeaux, & les relâcher par la raréfaction qui
s’enfuit , ce dernier effet fera toujours d’autant
moindre, qu’il fera plus contre-balancé par celui
du froid extérieur, qui caufe le refferrement de ces
vaiffeaux ; parce que le relâchement feroit bien plus
confidérable, tout étant égal, par l’effet de la caufe
interne de la chaleur, fi ce froid extérieur ne s’y op-,
pofoit pas ? Ainfi, ne peut-on pas conclure de-là,
qu’il refte toûjours que le refferrement doit être plus
confidérable par les effets du froid, qu’il n’eft empêché
par les effets fynchrones de la chaleur dont il
occafionne la génération ? d’où doit réfulter plus de
frottement, plus de chaleur par conféquent dans le
cas du froid externe, que dans le cas oppofé. Ne
peut-on pas concevoir ainfi une contrenitence continuelle
entre la caufe de la chaleur animale 6c le
froid extérieur ? D ’où on peut inférer que dans l’hy-
v e r , la chaleur animale appartient davantage à l’animal
même ; que dans l’été elle appartient plus aux
caufes externes ; qu’il y a donc en quelque forte
moins de vie dans les animaux en été, qu’en hyver ;
puifqu’il y a moins d’aèrion vitale ; que l’on eft plus
fort, plus vigoureux en hyver, tout étant égal ; parce
que le froid, qui condenfe tous les corps en tenant
les vaiffeaux dans un état de plus grande conf-
tri&ion, 6c en donnant lieu par-là à l’augmentation
des réfiftances, occafionne plus d’aûion , plus d’ efforts
par conféquent de la part de la puiffance motrice
pour les vaincre ; d’où l’augmentation du mouvement
progreffif des humeurs , plus de frottement
dans les capillaires, plus de chaleur, fans que ces
efforts, ce mouvement, puiffent être regardés comme
des effets de fievre proprement dite, puifqu’ils
augmentent fans diminution de forces ; au contraire,
attendu que l’augmentation d’aftion dans les folides
procure une plus grande élaboration, une plus grande
atténuation d’humeur , d’où réfulte une préparation
, une fecrétion plus abondante de fluide nerveux
; plus de difpofition par conféquent au mouvement
mufculaire, à l’exercice : au lieu qu’en été, la
raréfaftion des folides en général, par la chaleur extérieure
diminue l’élafticité des fibres des animaux,
en diminuant la cohéfion de leurs parties élémentaires;
d’où tout étant égal, réfulte moins de jeu dans
leurs vaiffeaux ; d’où s’enfuit dans les grandes chaleurs
une prefqu’atonie univerfelle, une diminution
proportionnée de l’aftion des organes vitaux ; d’où
le ralentiffement du cours des humeurs dans les capillaires
, le relâchement de ces vaiffeaux, le moins
de frottement des globules fanguins , moins de chaleur
qui eft l’effet de ce frottement, moins de ré-
fiftance au cours des humeurs dans tous les vaiffeaux;
conféquemment moins d’efforts de la puiffance motrice
, pour furmonter cette réfiftance ; d’où moins
d’attrition, d’atténuation de la maffe des humeurs ,
d’élaboration, de fecrétions du fluide nerveux ; d’où
enfin la ffoibleffe , l’abattement que l’on éprouve
toûjours par une fuite de la chaleur de l’atmolphere :
d’où s’enfuit, que les hommes obligés à fe livrer à
de grands travaux, à de grandes peines de corps ,
les foûtiennent mieux dans les tems froids, ont plus
de forces, plus d’appétit pour les maintenir, que
dans les tems chauds. C ’eft fans doute par cette con-
fidération, que Dioclès médecin contemporain d’A-
riftote, dans fa lettre à Antigonus, roi d’Afie, qui
contient plufieurs préceptes , concernant la confer-
vation de la fanté, donne pour maxime, en forme
d’aphorifme, qu’il faut prendre plus d’alimens, boire
moins en général, & boire davantage de vin pur, à
proportion qu’il fait plus froid; 6c qu’il faut par conféquent
manger moins, boire davantage, 6c boire
fon vin plus trempé, à-proportion que les chaleurs
augmentent. On peut donc conclure de ce qui vient
d’être dit, que le plus ou le moins de conftrièrion
Tome F IL
dans les vaiffeaux en général, & dans les vaiffeaux
capillaires en particulier, influe principalement fur
tous ces effets, comme fur le plus ou le moins de
génération de-la chaleur animale; ainfi l’on peut
concevoir que cette chaleur y eft produite, fans
qu’elle faffe en même tems ceffer le refferrement de
ces memes vaiffeaux, qui eft la condition efficiente ;
ainfi l’affertion du do&eur Douglas qui établit ce
refferrement, & en conféquence le frottement des
globules fanguins dans les capillaires, comme caufe
de la chaleur animale, femble fubfifter fans atteinte
à l’égard de la première objeûion : paflons à ia fécondé.
On ne peut que convenir avec tous les Phyfiologiftes
, que le mouvement du fang eft très-lent dans
tous les capillaires ; que le degré de cette lenteur doit
varier à-proportion des réfiftances, 6c par confé-
quent qu’elle augmente avec le plus de refferrement
caufé par l’augmentation du froid. Mais n’y a-t-il
pas lieu de penfer qu’il augmente ce ralentiffement
du cours des humeurs, feulement jufqu’à ce que les
forces vitales par la difpofition naturelle de la puiffance
motrice, ayent furmonté les réfiftances qui le
caufent, fans changer l’état de refferrement des folides
, c’eft-à-dire jufqu’à ce que les humeurs ayent
éprouvé l’effet de l’augmentation du reffort dans tous
les vaiffeaux , la plus grande aérien qu’ils exercent
en conféquence fur elles ; que celles-ci en foient en
général plus affinées, 6c que les globules fanguins en
particulier foient defunis au point de pouvoir paffer
l’un après l’autre dans les extrémités capillaires, &
même d’être forcés à s’alonger, à prendre la forme
ovale ; ce qui les rend propres à opérer plus de frottement
, à-proportion qu’ils touchent les parois des
vaiffeaux par des furfaces plus étendues ; qu’il fe fait
par conféquent entre eux un frottement plus confidérable
qu’il ne fe faifoit, lorfqu’il paffoit plus
d’un globule à la fois, & qu’ils touchoient aux parois
des vaiffeaux par moins de points : enforte que
l’on peut concevoir ainfi, que le mouvement des
humeurs dans les capillaires redevient auffi peu lent
qu’il étoit avant le refferrement, fans que le refferrement
en diminue d’aucune façon, dans la fiippofi-
tion que la caufe en fubfifte toûjours. Or comme la
faculté de procurer la fenfation du froid eft attachée
à l’impreffion qui réfulte de la diminution du mouvement
inteftin caufé par l’aérion du feu, au-deffous
de celui qui conftitue notre chaleur naturelle : que
la caufe de cette diminution dépende du froid de
l’atmofphere , ou d’une gêne dans le cours du fang,
occafionnée par un refferrement fpafmodique des
vaiffeaux, ou par épaiffiffement des humeurs ; il eft
aifé enfuite de ce qui vient d’être dit, de rendre raifon
pourquoi eft-ce qu’on eft fi fenfible au froid,
lorfqu’on paffe tout-d’un-coup d’un milieu qui eft
d’une température plus approchante de notre chaleur
, à une température bien plus froide. N’eft-ce
pas parce que celle-ci produit fi promptement le refferrement
des capillaires cutanés, qu’elle y forme
à-proportion de plus grandes réfiftances au cours
des humeurs qui fe ralentit auffi à-proportion ? d’où
la fenfation du froid, ainfi qu’on l’obferve à l’égard
des changemens fubits du chaud au froid dans l’air,
qui ont lieu fur-tout en automne, tems auquel oa
éprouve plus de fenfibilité à ce changement de température
, qu’on n’en éprouve dans le tems de la gelée
la plus forte, quoique dans le premier cas, les effets
du froid foient abfolument moins confidérables ,
quoiqu’il fe faffe alors une moindre conftriérion dans
les capillaires, & qu’il en réfulte abfolument moins
de réfiftance au cours des humeurs. Cette réfiftance
eft refpeftivement plus effeérive , parce que le relâchement
des folides fubfiftant encore intérieurement,
la puiffance motrice ne peut augmenter fes efforts |