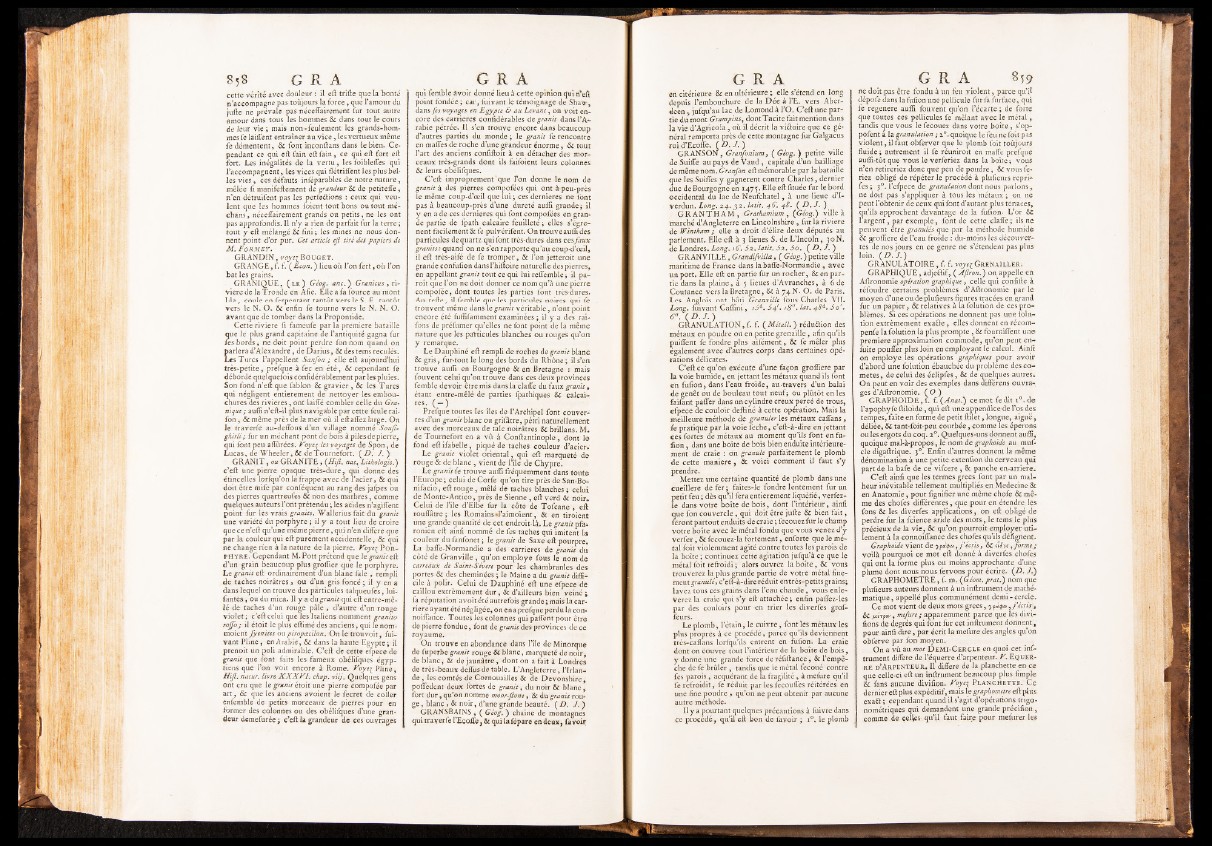
cette vérité avec douleur : il eft trifte que la bonté
n'accompagne pas toujours la force, que l’amour du
jufte ne prévale pas nécessairement fur tout autre
amour dans tous les hommes 8c dans tout le cours
de leur v ie ; mais non-feulement les grands-hommes
fe làiffent entraîner àu v ic e , les vertueux même
fe démentent, 8c font inconftans dans le bien. Cependant
ce qui eft fain eft fain, ce qui eft fort eft
fort. Les inégalités de la vertu, les foibleffes qui
raccompagnent, les vices qui flétriffent les plus belles
v ie s , ces défauts inféparables de notre nature,
mêlée fi manifeftement de grandeur 8c de petiteffe,
n’en détruifent pas les perfections ï ceux qui veulent
que les hommes foient tout bons ou tout mé-
chans, néceffairement grands ou petits, ne les ont
pas approfondis. Il n’y a rien de parfait fur la terre ;
tout y eft mélangé fini ; les mines ne nous donnent
point d’or pur. Cet article eß tiré des papiers de
M . F o r m e y .
GRÂNDIN, vqyr^BouGET.
GRANGE, f. f. ( Econ. ) lieu où l’on fert, oit l’on
bat les grains.
GRANIQUE, ( l e ) Gèog. anc.') Granicus, rivière
de la Troade en Afie. Elle a fa fource au mont
Ida, coule en ferpentânt tantôt vers le S. E. tantôt
vers le N. O. 8c enfin fe tourne vers le N. N. O.
avant que de tomber dans la Propontide.
Cette riviere fi faméufe par la première bataille
que le plus grand capitaine de l’antiquité gagna fur
fes bords, ne doit point perdre fon nom quand on
parlera d’Alexandre, de Darius, 8c des tems reculés.
Les Turcs l’appellent Sanfonj elle eft aujourd’hui
très-petite, prefque à fec en é té , 8c cependant fe
déborde quelquefois confidérablement par les pluies.
Son fond n’eft que fablon 8c gravier , 8c les Turcs
qui négligent entièrement de nettoyer les embouchures
des rivières, ont laiffé combler celle du Gra-
nique ; auffi n’eft-il plus navigable par cette feule rai-
fon , &même près de la mer où il eft affez large. On
le traverfe au-deflbus d’un village nommé Souß-
ghirli; fur un méchant pont de bois à piles de pierre,
qui font peu affûrées. Voyt{ les voyages de Spon, de
Lucas, de "Wbeeler, & deTournefort. (D . J . )
GRANIT, ou GRANITE, {Hiß. nat, Lithologie.)
c’eft une pierre opaque très-dure, qui donne des
étincelles lorfqu’on la frappe avec de l’acier, & qui
doit être mife par conféquent au rang des jafpes ou
des pierres quartreufes 8c non des marbres, comme
quelques auteurs l’ont prétendu ; les acides n’agiffent
point fur les vrais granits. Wallerius fait du granit
une variété du porphyre ; il y a tout lieu de croire
que ce n’eft qu’une même pierre, qui n’en différé que
par la couleur qui eft purement accidentelle, 8c qui
ne change rien à la nature de la pierre. Voye[ Porph
yr e . Cependant M.Pott prétend que le granit eft.
d ’un grain beaucoup plus grolîier que le porphyre.
Le granit eft ordinairement d’un blanc fale , rempli
de taches noirâtres , ou d’un gris foncé ; il y en a
dans lequel on trouve des particules talqueufes, luisantes
, ou du mica. Il y a du granit qui eft entre-mê-
lé de taches d’un rouge p â le , d’autre d’un rouge
v iole t; c ’eft celui que les Italiens nomment granito
roßo; il étoit le plus eftimé des anciens, qui le nom-
moient fyenites ou piropcecilon. On le trouvoit, fui-
vant Pline, en Arabie, 8c dans la haute Egypte; il
prenoit un poli admirable. C ’eft de cette efpeee de
granit que font faits les fameux obélifques égyptiens
que l’on voit encore à Rome. Foyer Pline,
Hiß. natur. livre X X X V I . chap. viij. Quelques gens
ont cru que le granit étoit une pierre compofée par
a r t , 8c que les anciens avoient le fecret de coller
enfemble de petits morceaux de pierres pour en
former des colonnes ou des obélifques d’une grandeur
demefurée ; c’eft la grandeur de ces ouvrages
qui femble avoir donné lieu à cette opinion qui n’ eft
point fondée ; car, fuivant le témoignage de Shaw,
dans fes voyages en Egypte & au Levant, on voit encore
des carrières confidérables de granit dans l’Arabie
pétrée» Il s’en trouve encore dans beaucoup
d’autres parties du monde ; le granit fe rencontre
en maffes de roche d’une grandeur énorme, 8c tout
l’art des anciens confiftoit à en détacher des morceaux
très-grands dont ils faifoient leurs colonnes
& leurs obélifques.
C ’eft improprement que fon donne ïè nom de
granit à des pierres compofées qui ont à-peu-près
le même coup-d’oeil que lui ; ces dernieres ne font
pas à beaucoup-près d’une dureté auffi grande; il
y en a de ces dernieres qui font compofées en grau»
de partie de fpath calcaire feuilleté ; elles s’égrènent
facilement & fe pulvérifent. On trouve auffi des
particules de quartz qui font très-dur es dans ces faux
granits: quand on ne s’en rapporte qu’au coup-d’oeil,
il eft très-aifé de fe tromper, & l’on jetteroit une
grande confufion dans l’hiftoire naturelle des pierres,
en appellant granit tout ce qui lui reffemble ; il pa-
roît que l’on ne doit donner ce nom qu’à une pierre
compofée, dont toutes les parties font très-dures.
Au refte, il femble que les particules noires qui fe
trouvent même dans le granit véritable, n’ont point
encore été fuffifamment examinées ; il y a des rai-
fons de préfumer qu’elles ne font point de la même
nature que les particules blanches ou rouges qu’on
y remarque.
Le Dauphiné eft rempli de roches de granit blanc
& gris, fur-tout le long des bords du Rhône ; il s’en
trouve auffi en Bourgogne & en Bretagne : mais
fouvent celui qu’on trouve dans ces deux provinces
femble devoir être mis dans la claffe du faux granit,
étant entre-mêlé de parties fpathiques 8c calcai-
res- ( - ) . v
Prefque'toutes les îles de l’Archipel font couvertes
d’un granit blanc ou grifâtre, pétri naturellement
avec des morceaux de talc noirâtres & brillans. M.
de Tournefort en a vu à Conftantinople, dont le
fond eft ifabelle, piqué de taches couleur d’acier.
Le granit violet oriental, qui eft marqueté de
rouge & de blanc, vient de 111e de Chypre.
Le granit fe trouve auffi fréquemment dans toute
l’Europe; celui de Corfe qu’on tire près de San-Bo-
nifacio, eft rouge, mêlé de taches blanches ; celui
de Monte-Antico, près de Sienne , eft verd & noir.
Celui de l’île d’Elbe fur la côte de Tofcane , eft
rouffâtre ; les Romains «l’aimoient, & en tiroient
une grande quantité de cet endroit-là. Le granit pfa-
ronien eft ainfi nommé de fes taches qui imitent la
couleur du fanfonet ; le granit de Saxe eft pourpre.
La baffe-Normandie a des carrières de granit du
côté de Granville , qu’on employé fous le nom de
carreaux de Saint-Sévere pour les chambranles des
portes 8c des cheminées ; le Maine a du granit difficile
à polir. Celui de Dauphiné eft une efpeee de
caillou extrêmement dur, & d’ailleurs bien veiné ;
fa réputation avoit été autrefois grande ; mais la carrière
ayant été négligée, on en a prefque perdu la con-
noiffance. Toutes les colonnes qui paffent pour être
de pierre fondue, font de granit des provinces de ce
royaume.
On trouve en abondance dans l’île de Minorque
de fuperbe granit rouge 8c blanc, marqueté de noir,
de blanc, & de jaunâtre , dont on a fait à Londres
de très-beaux deflùsde table. L’Angleterre, l’Irlande
, les comtés de Cornouailles & de Devonshire,
poffedent deux fortes de granit, du noir & blanc ,
fort dur, qu’on nomme moor-fione, & du granit rouge
, blanc , & noir, d’une grande beauté. ( D . J . )
GRANSBAINS , ( Géog. ) chaîne de montagnes
qui traverfe l’Ecoffe, & qui la fépare en deux, fa voir
en citérieure 8c en ultérieure ; elle s’étend en long
depuis l’embouchure de la Dée à l’E. vers Aberdeen
, jufqu’au lac de Lomond à l’O. C’eft une partie
dü mont Grampins, dont Tacite fait mention dans
la Vie d’Agricola, où il décrit la vittoire que ce général
remporta près de cette montagne fur Galgacus
roi d’Ecoffe. ( D . J. )
GRANSON, Granfonïum f ( Géog. ) petite ville ;
de Suiffe au pays de V au d, capitale d’un bailliage
de même nom. Granfon eft mémorable par la bataille
que les Suiffes y gagnèrent contre Charles, dernier
duc de Bourgogne en 1475. Elle eft fituée fur le bord
occidental du lac de Neufchatel, à une lieue d’I-
yerdun. Ldng. 2 4 .32. latit. 4(3. 48. ( D . J . )
G R AN T H A M , Grathamium , (Géog.) ville à
marché d’Angleterre en Lincolnshire , fur la riviere
de Wintham ; elle a droit d’élire deux députés au
parlement. Elle eft à 3 lieues S. de L’Incoin, 30N.
de Londres. Long. i€< 5x. latit. 62. 5 o. ( D . J. )
GRANVILLE, Grandifvilla , ( Géog. ) petite ville
maritime de France dans la baffe-Normandie, avec
un port. Elle eft en partie fur un rocher, 8c en partie
dans la plaine, à 5 lieues d’Avranches, à 6 de
Coutance vers la Bretagne, & à 74 N. O. de Paris.
Les Anglois ont bâti Granville fous Charles VIL
Long, fuivant Caffini, / id, 64'. 18". lut. 48d. 60'. WÊÊÊÈÈÊ GRANULATION, f. f. ( Métall. ) reduétion des
métaux en poudre ou en petite grenaille, afin qu’ils
puiffent fe fondre plus aifément, & fe mêler plus
également avec d’autres corps dans certaines opérations
délicates.
C’eft ce qu’on exécute d’une façon groffiere par
la voie humide, en jettant les métaux quand ils font
en fufion, dans l’eau froide, au -travers d’un balai
de genêt ou de bouleau tout neuf; ou plutôt en les
faifant paffer dans un cylindre creux percé de trous,
efpeee de couloir deftiné à cette opération. Mais la
meilleure méthode de granuler les métaux caffans ,
fe pratique par la voie leche, c’eft-à-dire en jettant
ces fortes de métaux au moment qu’ils font en fu-
lio n , dans une boîte de bois bien enduite intérieurement
de craie : on granule parfaitement le plomb
de cette maniéré, & voici comment il faut s’y
prendre.
Mettez une certaine quantité de plomb dans une
cueillere de fer ; faites-le fondre lentement fur un
petit feu ; dès qu'il fera entièrement liquéfié, verfez*
le dans votre boîte de bois, dont l’intérieur, ainfi
que fon couvercle, qui doit être jufte & bien fa it,
feront partout enduits de craie ; fecouez fur le champ
votre boîte avec le métal fondu que vous venez d’y
v erfe r, 8c fecouez-la fortement, enforte que le métal
foit violemment agité contre toutes les parois de
la boîte ; continuez cette agitation jufqu’à ce que le
métal foit refroidi ; alors ouvrez la boîte, 8c vous
trouverez la plus grande partie de votre métal finement
granulé, c’eft-à-dire réduit entrès-petitsgrains;
lavez tous ces grains dans l’eau chaude, vous enlèverez
la craie qui s’y eft attachée ; enfin paffez-les
par des couloirs pour en trier les diverfes grof-
ïeurs.
Le plomb , l’étain, le cuivre, font les métaux les
plus propres à ce procédé, parce qu’ils deviennent
très-caffans lorfqu’ils entrent en fufion. La craie
doht on couvre tout l’intérieur de la boîte de bois,
y donne une grande force de réfiftance, & l’empêche
de fe brûler, tandis que le métal fecoué contre
fes parois, acquérant de la fragilité , à mefure qu’il
fe refroidit, fe réduit par les fecouffes réitérées en
une fine poudre , qu’on ne peut obtenir par aucune
autre méthode.
Il y a pourtant quelques précautions à fuivre dans
ce procédé, qu’il eft bon de favoir ; i° . le plomb
ne doit pas être fondu à un feu violent, parce qu’il
dépofe dans la fufion une pellicule fur fa furface, qui
fe régénéré auffi fouvent qu’on l’écarte ; de forte
que toutes ces pellicules fe mêlant avec le métal,
tandis que vous le fecouez dans votre b o îte , s’op-
pofent a la granulation ; 20. quoique le féu ne foit pas
violent, il faut obferver que le plomb foit toujours
fluide ; autrement il fe réuniroit en maffe prefque
auffi-tôt que vous le verferiez dans la boîte ; vous
n’en retireriez donc que peu de poudre , 8c vous feriez
obligé de répéter le procédé à plufieurs repris
fes ; 30. l’efpece de granulation dont nous parlons,
ne doit pas s’appliquer à tous les 'métaux ; on ne
peut l’obtenir de ceux qui font d’autant plus tênaces,
qu’ils approchent davantage de la fufion. L’or 8c
l’argent, par exemple, font de cette claflë ; ils ne
peuvent être granulés que par la méthode humide
& groffiere de l’eau froide : du-moins les découvertes
de nos jours en ce genre ne s’étendent pas plus
loin. ( D . J . )
GRANULATOIRE, f. f. voyé'i GRen ail lEA*
GRAPHIQUE, adjeâif, ( Aflron. ) on; appelle eil
Aftronomie opération graphique, celle qui confifte à
réfoudre certains problèmes d’Aftronomie par lé
moyen d’une ou de plufieurs figures tracées en grand
fur un papier, & relatives à la folution de ces problèmes.
Si ces opérations ne donnent pas une folution
extrêmement exafre, elles donnent en récom-
penfe la folution la plus prompte , 8c fourniffent une
première approximation commode, qu’on peut en-
fuite pouffer plus loin en employant le calcul. Ainfi
on employé les opérations graphiques pour avoir
d’abord une folution ébauchée du problème des comètes
, de celui des éclipfes, 8c de quelques autres*
On peut en voir des exemples dans différens ouvrages
d’Aftronomie. ( O )
GRAPHOIDE, f. f. (Anat.) ce mot fe dit i° . de
l’apophy fe ftiloïde, qui eft une appendice de l’os des
tempes, faite en forme de petit ftilet, longue, aiguë ,
déliée, & tant-foit-peu courbée, comme les éperons
ou les ergots du coq. 20. Quelques-uns donnent auffi,
quoique mal-à-propos, le nom de graphoïde au muf-
cle digaftrique. 30. Enfin d’autres donnent la même
dénomination à une petite, extenfion du cerveau qui
part de la bafe de cë vifeere , & panche en-arriere.
C ’eft ainfi que les termes grecs font par un malheur
inévitable tellement multipliés en Medëcine &
en Anatomie, pour lignifier une même chofe & même
des chofes différentes, que pour en étendre lés
fons & les diverfes applications, on eft .obligé de
perdre fur la fcience aride des mots, le tems le plus
précieux de la v ie , & qu’on pourroit employer utilement
à la connoiffance des chofes qu’ils déngnent.
Graphoïde vient de ypelça f j'écris, 8c tïé'oç, forme;
voilà pourquoi ce mot eft donné à diverfes chofes
qui ont la forme plus ou moins approchante d’un.e
plume dont nous nous fervons pour écrire. (D. J.)
GRAPHOMETRE, f. m. (Géom. prat.) nom que
plufieurs auteurs donnent à un inftrument de mathématique
, appellé plus communément demi - cercle.
Ce mot vient de deux mots grecs, ypdçu, j'écris,
8c /Atrpov, mefure ; apparemment parce que les divi-
fions de degrés qui font fur cet inftrument donnent,
pour ainfi dire, par écrit la mefure des angles qu’on
obferve par fon moyen.
On a vû au mot D eMI-Cercle en quoi cet inf-
! trument différé de l’équerre d’arpenteur. V . Equer-
i re d’Arpenteur. Il différé de la planchette en ce
! que celle-ci eft un inftrument beaucoup plus fimple
& fans aucune divifion. Voye{ Plan ch e t te . Ce
I dernier eft plus expéditif, mais le graphometre eft plus
exafr ; cependant quand il s’agit d’opérations trigo-
nométriques qui demandent une grande précifion.,
comme de celles qu’il faut faire pour mefurer les