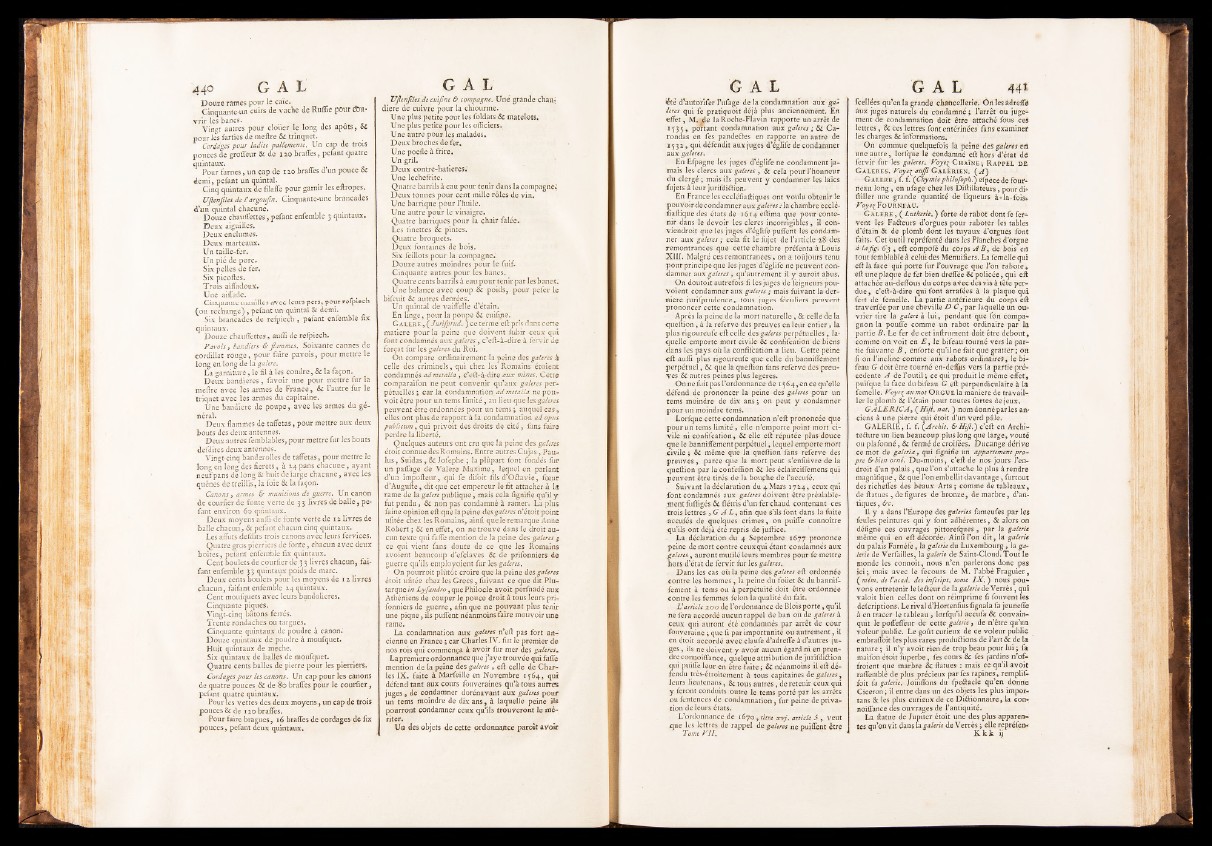
Douze rames pour le caïe.
Cinquante-un cuirs de vache de Kuffie pour cou*
yrir les bancs. A
Vingt autres pour cloiier le long des apots, &
pour les farties de meftre & trinquet.
Cordages pour ladite pallemente. Un cap de trois
pouces de groffeur & de 120 braffes, pefant quatre
quintaux.
Pour farnes, un cap de 120 braffes d’un pouce &
demi, pefant un quintal.
Cinq quintaux de filaffe pour garnir les eftropes.
UJlenJîles de Pargoufln. Cinquante-une brancades
d’un quintal chacune.
Douze chauffettes, pefant enfemble 3 quintaux.
Deux aiguilles.
Deux enclumes.
Deux marteaux.
Un taille-fer.
Un pié de porc.
Six pelles de fer.
Six picoftes.
Trois aiffadoux.
Une aiffade.
Cinquante manilles avec leurs pers, pour refpiech
(ou rechange) , pefant un quintal & demi.
Six brancades de refpiech , pafant enfemble fix
quintaux.
Douze chauffettes, aufîï de refpiech.
Pavois, bandiers & flammes. Soixante cannes de
cordillat rouge, pour faire pavois, pour mettre le
long en long de la galere.
La garniture, le fil à les coudre, & la façon.
Deux bandieres , favoir une pour mettre fur la
meftre avec les armes de France, & l’autre fur le
triquet avec les armes du capitaine.
Une bandiere de poupe, avec les armes du général.
Deux flammes de taffetas, pour mettre aux deux
bouts des deux antennes.
Deux autres femblables, pour mettre fur les bouts
defdites deux antennes.
Vingt-cinq banderolles de taffetas, pour mettre le
long en long des fierets, à 24 pans chacune, ayant
neuf pans de long & huit de large chacune, avec les
quênes de treillis, la foie & la façon.
Canons, armes & munitions de guerre. Un canon
de courfier de fonte verte de 3 3 livres de balle, pefant
environ 60 quintaux.
Deux moyens aufii de fonte verte de 12 livres de
balle chacun, & pefant chacun cinq quintaux.
Les affûts defdits trois canons avec leurs fervices.
Quatre gros pierriers de fonte, chacun avec deux
boîtes, pefant enfemble fix quintaux.
Cent boulets de courfier de 3 3 livres chacun, fai-
fant enfemble 3 3 quintaux poids de marc.
Deux cents boulets pour les moyens de 12 livres
chacun, faifant enfemble 24 quintaux.
Cent moufquets avec leurs bandolieres.
Cinquante piques.
Vingt-cinq bâtons ferrés.
Trente rondaches ou targues.
Cinquante quintaux de poudre à canon.'
Douze quintaux de poudre à moufquet.
Huit quintaux de meche.
Six quintaux de balles de moufquet.
Quatre cents balles de pierre pour les pierriers.
Cordages pour les canons. Un cap pour les canons
de quatre pouces & de 80 braffes pour le courfier,
pefant quatre quintaux.
Pour les vettes des deux moyens, un cap de trois
pouces & de 120 braffes.
Pour faire bragues, 16 braffes de cordages de fix
pouces, pefant deux quintaux.
Ujlenfllcs de cuiflne & compagne. Une* grande chaudière
de cuivre pour la chiourme. .
Une plus petite pour les foldats & matelots.;
Une plus petite pour les officiers.
Une autre pour les malades.
Deux broches de fer.
Une poefle à frire.
Un gril.
Deux contre-hatieres.’
Une lechefrite.
Quatre barrils à eau pour tenir dans la compagne*
Deux tonnes pour cent mille rôles de vin.
Une barrique pour l’huile.
Une autre pour le vinaigre.
Quatre barriques pour la chair falée.
Les tinettes & pintes.
Quatre broquets.
Deux fontaines de bois.
Six feillots pour la compagne.'
Douze autres moindres pour le fuif.
Cinquante autres pour les banes.
Quatre cents barrils à eau pour tenir par les banes.'
Une balance avec coup & poids, pour pefer le
bifcuit & autres denrées.
Un quintal de vaiffelle d’étain.
En linge, pour la poupe & cuifipe.
Galere , ( Jurifprud. ) ce terme cft pris dans cette
matière pour la peine que doivent fubir ceux qui
font condamnés aux galerts, c’eft-à-dire à fervir de
forçat fur les galeres du Roi.
On compare ordinairement la peine des galeres à
celle des criminels, qui chez les Romains étoient
condamnés admetalla, c’eft-à-dire aux mines. Cette
comparaifon ne peut convenir qu’aux galeres perpétuelles
; car la condamnation ad metalla ne pou-
voit être pour un tems limité, au lieu que les galeres
peuvent être ordonnées pour un tems ; auquel cas,
elles ont plus de rapport à la condamnation ad opus
publicum, qui privoit des droits de cité, fans faire
perdre la liberté.
Quelques auteurs ont cru que la peine des galeres
étoit connue des Romains. Entre autres Cujas, Pau-
lus, Suidas, & Jofephe ; la plupart font fondés fur
un paffage de Valere Maxime, lequel en parlant
d’un impofteur, qui fe dîfoit fils d’Oita vie, foeur
d’Augufte, dit que cet empereur le fit attacher à la
rame de la galere publique, mais cela lignifie qu’il y
fut pendu , & non pas condamné à ramer. La plus
faine opinion eft que la peine des galeres n’étoit point
ufitée chez les Romains, ainfi que le remarque Anne
Robert ; & en effet, on ne trouve dans le droit aucun
texte qui faffe mention de la peine des galeres ;
ce qui vient fans doute de ce que les Romains
avoient beaucoup d’efclaves & de prifonniers de
guerre qu’ils employoient fur les galeres.
On pourroit plutôt croire que la peine des galeres
étoit ufitée chez les Grecs, fuivant ce que dit Plutarque
in Lyfandro, que Philocle a voit perfuadé aux
Athéniens de couper le pouce droit à tous leurs prifonniers
de guerre, afin que ne pouvant plus tenir
une pique, ils puffent néanmoins faire mouvoir une
rame.
La condamnation aux galeres n’eft pas fort ancienne
en France ; car Charles IV. fut le premier de
nos rois qui commença à avoir fur mer des galeres.
La première ordonnance que j’aye trouvée qui faffe
mention de la peine des galeres , eft: celle de Charles
IX. faite à Marfeille en Novembre 1564, qui
défend tant aux cours fouveraines qu’à tous autres
juges, de condamner dorénavant aux galeres pour
lin tems moindre de dix ans, à laquelle peine ils
pourront condamner ceux qu’ils trouveront le mériter.
Un des objets de cette ordonnance paroît avoir
été d*autorifer l’ufage de la condamnation aux galeres
qui fe pratiquoit déjà plus anciennement. En
effet, M.jÿle la Roche-Flavin rapporte un arrêt de
1535 , portant condamnation aux galeres ; & Ca-
rondas en fes pandettes en rapporte un autre de
1 5 3 2 , qui défendit aux juges d’églife de condamner
aux galeresk
En Efpagne les juges d’églife hé condamnent jamais
les clercs aux galeres , & cela pour l’honneur
du clergé ; mais ils peuvent y condamner les laïcs
fujets à leur jurifdiirioh.
En France les eccléfiaftiques ont voulu obtenir le
pouvoir de condamner aux galeres : la chambre ècclé-
iiaftique des états de 1614 eftima que pour contenir
dans le devoir les clercs incorrigibles * il con-
viendroit que les juges d’églife puffent les condamner
aux galeres ; cela fit le fui et de l’article -2 8-des
remontrances que cette chambre préfénta à Louis
XIII. Malgré ces remontrances, on a toujours tenu
pour principe que les juges d’églife ne peuvent condamner
aux galeres, qu’autrément il y âtiroit abus.
On doutoit autrefois fi les juges de feigneurs pou*-
voient condamner aux galeres ; mais fuivant la dernière
jurifprudence, tous juges féculiers peuvent
prononcer cette condamnation.
Après la peine de la mort naturelle, & celle de la
queftion , à la referve des preuves en leur entier, la
plus rigoureufe eft: celle des galeres perpétuelles , laquelle
emporte mort civile & confifcarion de biens
dans les pays où. la confifcarion a lieu. Cette peine
eft auffi plus rigoureufe que celle du banniffement
perpétuel, & que la queftion fans referve des preuves
& autres peines plus legeres.
On ne fuit pas l’ordonnance de 1564, en ce qu’elle
défend de prononcer la peine des galeres pour un
tems moindre de dix ans; on peut y condamner
pour un moindre tems.
Lorfque cette condamnation n’eft prononcée que
pour un tems limité-, elle n’emporte point mort civile
ni confifcarion, & elle eft réputée plus douce
que le banniffement perpétuel, lequel emporte mort
.civile ; & même que la queftion fans referve des
preuves , parce que la mort peut s’enfuivre de la
queftion par la confeflion & les éclairciffemens qui
peuvent être tirés de la bouphe de l’accufé.
Suivant la déclaration du 4 Mars 1724, ceux qui
:font condamnés aux galeres doivent être préalablement
fuftigés & flétris d’un fer chaud contenant ces
trois lettres ,G A L , afin que s’ils font dans la fuite
aceufés de quelques crimes, on puiffe connoître
qu’ils ont déjà été repris de juftice.
La déclaration du 4 Septembre 1677 prononce
peine de mort contre ceux qui étant condamnés aux
galeres, auront mutilé leurs membres pour fe mettre
hors d’état de fervir fur les galeres.
Dans les cas où la peine des galeres eft ordonnée
contre les hommes, la peine du fouet & du banniffement
à tems ou à perpétuité doit être ordonnée
contre les femmes félon la qualité du fait.
Varticle 200 de l’ordonnance de Blois porte, qu’il
ne fera accordé aucun rappel de ban ou de galeres à
ceux qui auront été condamnés par arrêt de cour
fouveraine ; que fi par importunité ou autrement, il
en étoit accordé avec claufe d’adreffe à d’autres juges
, ils ne doivent y avoir aucun égard ni en prendre
connoiffance, quelque attribution de jurifdiérion
qui puiffe leur en être faite ; & néanmoins il eft défendu
très-étroitement à tous capitaines de galeres,
leurs lieutenans, & tous autres, de retenir ceux qui
y feront conduits outre le tems porté par les arrêts
ou fentences de condamnation, fur peine de privation
de leurs états.
L’ordonnance de 1670, titre xvj. article 5 , veut
que les lettres de rappel de galeres ne puiffent être
Tome V II.
fcèllées qu’en la grande chancellerie. Oh les âdreffé
aux juges naturels du condamné ; l’arrêt ou juge“
ment de condamnation doit être attaché finis ces
lettres, & Ces lettres font entérinées fans examine?
lès charges & informations.
Oh commue quelquefois la peiné des galeres eri
une autre, lorfqiie le condamné èft hors d’état dé
fervir fur lés galereSi Voyi{ Chaîne; Rappel DE
G alères. Voye^ aujfl Galérien, (A )
G alere > f. f. (Chymiephilofopki) efpècé de four*
neku'lOng , eh ufage cheiz lés Diftillateurs, pour di*
ftiller une grande quantité de liqueurs à-la-fois*
Voye^ Fourneau.
Ga l e r e , ( Lutherie. ) forte dé rabot dont fe fer«*,
vent les Fadeurs d’orgues pour raboter les tables
d’étain & de plomb dont les tuyaux d’orgues font
faits. Cèt Outil repréfenté dans les Planches d’orgue
àlafigi C j , eft compofé du corps A B , de bois en
tout lèmblable à celui des Menuifiers. La femelle qui
eft la face qui porte fur l’ouvrage que l’on rabote ;
eft une plaque de fer bien dréffée & policée, qui eft
attachée au-deffous du corps aVec des vis à tête per“
due* c’eft-à-dire qui font arrafées à là plaque qui
fert de femelle. La partie antérieure du corps eft
traverfée par une cheville D C , par laquelle un ouvrier
tire la galere à lui, pendant que fôn compa*
gnon la pouffe comme un rabot ordinaire par la
partie B. Le fer de cet infiniment doit être debout,
comme On.voit en E , le. bifeau tourné vers-la par“
tie fuivante B , enforte qu’il ne fait que gratter ; ou
fi on l’incline comme aux rabots ordinaires, le bifeau
G doit être tourné en-def&is vers la partie précédente
A de l’outil ; ce qui produit le même effet,
puifque la face du bifeau- G eft perpendiculaire à la
femelle. Voyer au mot Orgue la manière de travail“
1er le plomb & l’étain pour toutes fortes de jeux*
GA LERIC A , ( Hifl. nat. ) nom donné par les an*
ciens à une pierre qui étoit d’üfi verd pâle;
GALERIE, f. f. ( Archit. & Hifl.') c’eft eh Archi“
teélure un lieu beaucoup plus long que large* voûté
ou plafonné, & fermé de croifées. Ducange dérive
ce mot de galeria, qui lignine tiil appartement propre
&bien orné. Du-moins, c’eft de nos jours l’endroit
d’un palais, que l’on s’ attache le plus à rendre
magnifique, & que l’on embellit davantage, furtout
des richeffes des beaux Arts ; comme de tableaux,
de ftatues, défigurés de bronze, de marbre, d’antiques,
&c.
Il y a dans l’Europe dés galeries fanleufes par lés
feules peintures qui y font adhérentes, & alors on
défigne ces ouvrages pittorefques , par la galerie
même qui en eft décorée* Ainfi l’on dit, la galerit
du palais Farnèfe, la galerie du Luxembourg, la galerie
de Verfailles, la galerie de Saint-Cloud* Tout le
monde les connoît, nous n’en parlerons donc pas
ic i; mais avec le fecours de M. l’abbé Fraguier-,
( mém. de Pacad. des infcript. tome IX . ) nous pou“
vons entretenir le leûeur de la galerie de Verrès, qui
valoit bien celles dont on réimprime fi fouvent les
defcriptions. Le rival d’Hortenfiusfignala fa jeuneffe
à en tracer le tableau, lorfqu’il accufa & convainquit
le poffefléur de cette galerie , de n’être qu’un
voleur public. Le goût curieux de ce voleur public
embraffoit les plus rares produirions de l’art & de la
nature ; il n’y avoit rien de trop beau pour lui ; fa
maifon étoit fuperbe, fes cours & fes jardins n’ofi-
froient que marbre & ftatues : mais ce qu’il avoit
raffemblé de plus précieux par fes rapines, remplif-
foit fa galerie. Joiiiffons du fpeilacle qu’en donne
Cicéron ; il entre dans un des objets les plus impOr-
tans & les plus curieux de ce Dictionnaire, la eon*
noiffance des ouvrages de l’antiquité*
La ftatue de Jupiter étoit une des plus apparentes
qu’on vît dans la galerie de Verrès ; elle repréfen*-
K k k ij