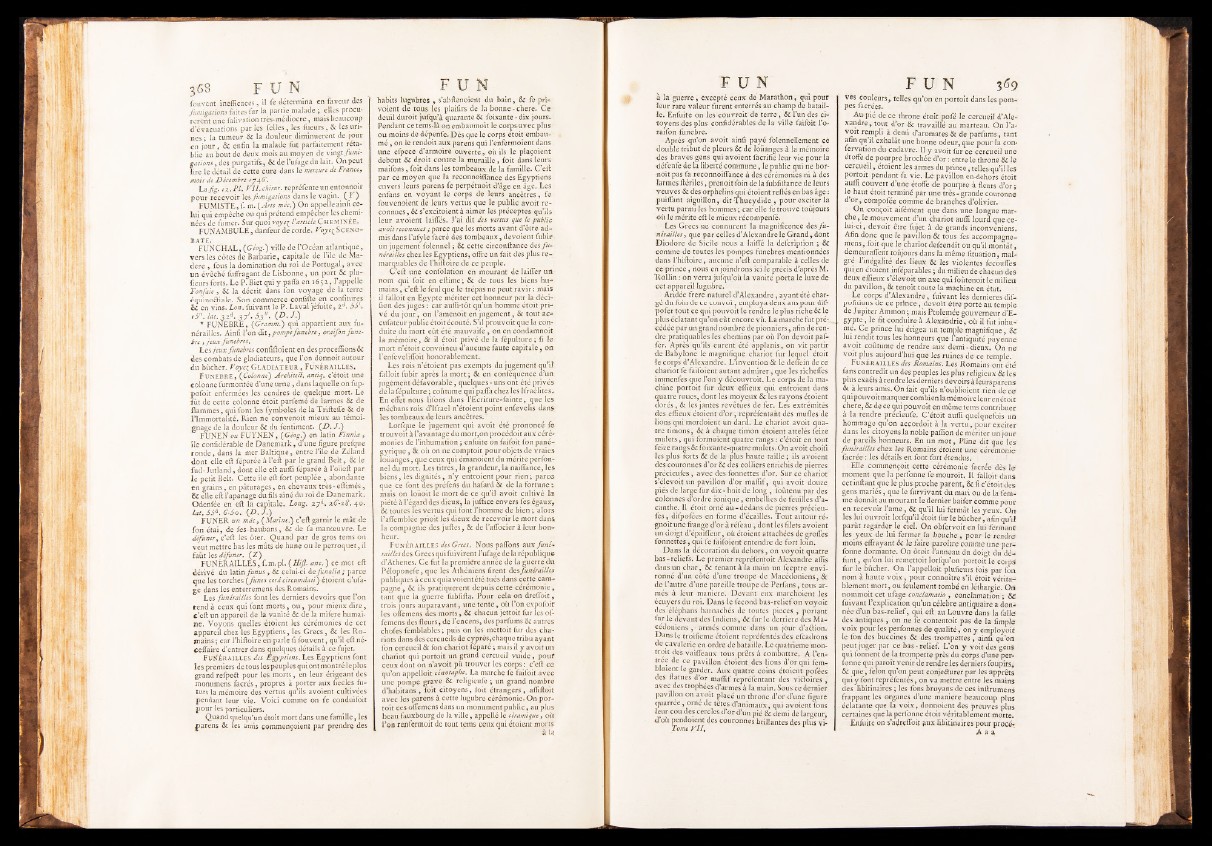
fouvent inefficaces, il fe détermina en faveur des
fumigations faites -fur la partie malade ; elles procu*
rerent une falivation très-médiocre , mais beaucoup
d’évacuations parles folles, les fueurs, & les urines
; la tumeur & la douleur diminuèrent de jour
en jour , & enfin la malade fut parfaitement rétablie
au bout de deux mois au moyen de vingt fumigations
, des purgatifs, 6c de l’-ufage du lait. On peut I
lire le détail de cette cure dans le mercure de France,
mois de Décembre 1746'.
La fig. ix. PL. VlLchirttr. repréfente un entonnoir
pour recevoir les fumigations dans le vagin. ( Y )
FUMISTE, f. m. {Arts mèc.) On appelleainfi celui
qui empêche ou qui prétend empêcher les cheminées
de fumer. Sur quoi voye[ Varticle Cheminee.
FUNAMBULE, danfeurde corde. /^oyc^ScENO-
BATE.
FUNCHAL, (Glogj) ville de l’Océan atlantique,
vers les côtes de Barbarie, capitale de l’île de Madère
, fous la domination du roi de Portugal, avec
un évêché fuffragant de Lisbonne, un port 6c plu-
fieurs forts. L e P.Biet qui y paffa en 1652, l’appelle
Fonfaie , 6c la décrit dans fon voyage de la terre
équinoûiale. Son commerce confine en confitures
& en vins. Lon. fuivant le P . Laval jéfuite, 2d. 55'-,
iSl'/la t.3 z i . 3 7 l. i 3 ' ' . ( D . J . ) ^
* FUNEBRE, (Gramm.) qui appartient aux funérailles.
Ainfi l ’on di t , pompe funèbre, ordifonfunèbre
, jeux funèbres.
Les jeux funèbres confiftoient en des proceffions&
des combats de gladiateurs, que l’on donnoit autour
du bûcher. Voyei Gladiateur , Funérailles.
FUNEBRE, ( Colonne) Architecl, antiq, c’étoit line
colonne furmontée d’une urne, dans laquelle on fup-
pofoit enfermées les cendres de quelque mort. Le
tut de cette colonne étoit parfemé de larmes 6c de
flammes, qui font les fymboles de la Trifteffe & de
l ’Immortalité. Rien ne. convenoit mieux au témoignage
de la douleur 6c du fentiment. (D . J .)
FUNEN ou FUYNEN, (Géog.) en latin Finnia,
île confidérable de Danemark, d’une figure prefque
ronde, dans la mer Baltique, entre l ’île de Zéland
dont elle eft féparée à l’eu par le grand Belt, 6c le
fud- Jutland, dont elle eft auffi féparée à l’oiieft par
le petit Belt. Cette île eft fort peuplée , abondante
en grains, en pâturages, en chevaux très- eftimés,
& elle eft l’apanage du fils aîné du roi de Danemark.
Odenfée en eft la capitale. Long. zy d. x<o-z8.4o.
lat. 55^-. €-5 o. {D. J.) ^
FUNER un mât, {Marine.") c’eft garnir le mât de
fon étai, de fes-haubans, 6c de fa manoeuvre. Le
difuner, c’eft les ôter. Quand par de gros tems on
veut mettre bas les mâts de hune ou le perroquet, il
faut les difuner. (Z )
FUNÉRAILLES, f.m.pl. ( Hifif. anc.) ce mot eft
dérivé du latin funus, 6c celui-ci de funalia; parce
que les torches {funes cerâ circumdati) étoient d’ufa-
ge dans les enterremens des Romains.
Les funérailles font les derniers devoirs que l’on
rend à ceux qui font morts, o u , pour mieux dire,
c ’eft un appareil de la vanité 6c de la mifere humaine.
Voyons quelles étoient les cérémonies de cet
appareil chez les Egyptiens, les Grecs, & les Romains
; car l’hiftoire en parle fi fouvent, qu’il eft né-
Ceffaire d’entrer dans quelques détails à ce fujet.
Funérailles des Egyptiens. Les Egyptiens font
les premiers de tous les peuples qui ont montré le plus
grand refpett pour les morts, en leur érigeant des
monumens facrés, propres à porter aux fiecles futurs
la mémoire des vertus qu’ils avoient cultivées
pendant leur vie. Voici comme on fe conduifoit
pour les particuliers.
Quand quelqu’un étoit mort dans une famille, les
parens & les amis commençoient par prendra des
habits lugubres , s’abftenoierit du bain , & fe pri*
voient de tous les plaifirs de la bonne -chere. Ce
deuil duroit jufqu’à quarante & foixante - dix jours.
Pendant ce tems-là on embaumoit le eorps'avec plus
ou moins de dépenfe. Dès que le corps étoit embaumé
, on le rendoit aux parens qui l’enfermoient dans
une efpece d’armoire ouverte, où ils le plaçoient
debout 6c droit contre la muraille, foit dans leurs
maifons, foit dans les tombeaux de la famille. C ’eft
par ce moyen que la reconnoiflance des Egyptiens
envers leurs parens fe perpétuoit d’âge en âge. Les
enfans en voyant le corps de leurs ancêtres, fe
fouvenoient de leurs vertus que le public avoit reconnues
, & s’excitoient à aimer les préceptes qu’ils
leur avoient laiffés. J’ai dit des vertus que le public
avoit reconnues ; parce que les morts avant d’être admis
dans l’afyle facré des tombeaux, dévoient fubir
un jugement folennel ; 6c cette circonftance des fu*
néraiUts chez les Egyptiens, offre un fait des plus remarquables
de l’hiftoire de ce peuple.
C ’eft une confolation en mourant de laiffer urt
nom qui foit en eftime; 6c de tous les biens hu-*
mains, c’eft le feul que le trépas ne peut ravir : mais
■ il falloit en Egypte mériter cet honneur par la déci-
fion des juges : car auffi-tôt qu’un homme étoit pri-»
vé du jour, on l’amenoit en jugement, & tout ac-
eufateur public étoit écouté. S’il prouvoit que la conduite
du mort eût été mauvaife, on en condamnoit
la mémoire, & il étoit privé de la fépulture ; fi le
mort n’étoit convaincu d’aucune faute capitale, om
. l’enfeveliffoit honorablement.
Les rois n’étoient pas exempts du jugement qu’il'
falloit fubir après la mort ; & en conféquence d’un
jugement défavorable, quelques-uns ont été privés
delà fépulture ; coûtume qui paffa chez les Ifraélites*
En effet nous lifons dans l’Ecriture-fainte, que les
méchans rois d’Ifrael n’étoient point enfevelis dans
les tombeaux de leurs ancêtres."
Lorfque le jugement qui avoit été prononcé fe
trouvoit à l’avantage du mort,on procédoit aux cérémonies
de l’inhumation ; enfuite on faifoit fon panégyrique
, & où on ne comptoit pour objets de vraies
louanges, que ceux qui émanoient du mérite perfon-
nel du mort. Les titres, la grandeur, la naiffance, les
biens, les dignités, n’y entroient pour rien ; parce
que ce font des préfens du hafard & de la fortune :
mais on loiioit le mort de ce qu’il avoit cultivé la
piété à l’égard des dieux, la juftice envers fes égaux,
ôc toutes les vertus qui font l’homme de bien ; alors
l’affemblée prioit les dieux de recevoir le mort dans
la compagnie .des juftes, & de l’affocier à leur bon*
heur.
F u n é r a il l e s des Grecs. Nouspaffons aux funé-
railles des Grecs qiii fuivirent l’ufage de la république
d’Athènes. Ce fut la première année de la guerre du
Péloponefe, que les Athéniens firent des funérailles
publiques à ceux quia voient été.tués dans cette campagne
, 6c ils pratiquèrent depuis cette cérémonie ,
tant que la guerre fubfifta. Pour cela on dreffoit,
trois jours auparavant, une tente, où l’on expofoit
les offemens des morts, 6c chacun jettoit fur les ol-
femens des fleurs, de l’encens, des parfums & autres
chofes femblables ; puis on les mettoit fur des chariots
dans des cercueils de cyprès,chaque tribu ayant
fon cercueil & fon chariot léparé ; mais il y avoit un
chariot qui portoit un grand cercueil vuide, pouf
ceux dont on n’avoit pû trouver les corps : c’eft ce
qu’on appelloit cénotaphe. La marche fe faifoit avec
une pompe grave 6c religieufe ; un grand nombre
d’habitans , loit citoyens, foit étrangers , affiftoit
avec les parens à cette lugubre cérémonie. On portoit
ces offemens dans un monument public, au plus
beau fauxbourg de la v ille, appellé le céramique, où
l’on renfçrmoit de tout tems ceux qui étoient morts
1 à la
à la guerre, excepté ceux de Marathon, qui pour
leur rare valeur furent enterrés au champ de bataille.
Enfuite on les couvroit de terre, 6c l’un des citoyens
des plus confidérables de la ville faifoit l’o-
raifon funebre.
Après .qu’on avoit ainfi payé folennellement cè
double tribut de pleurs & de loiianges à la mémoire
des braves gens qui avoient facrifié leur vie pour la
<léfenfe de la liberté commune, le public qui ne bor-
moit pas fa reconnoiflance à des cérémonies ni à des
larmes ftériles, prenait foin de la fubfillance de leurs
veuves & des orphelins qui étoient reftés en bas âge :
.puiffant aiguillon, dit Thucydide , pour exciter la
vertu parmi les hommes ; car elle fe trouve toûjours
où le mérite eft le mieux récompenfé.
Les Grecs ne connurent la magnificence des funérailles,
que par celles d’Alexandre le G rand, dont
Diodore de Sicile nous a laifle la defeription ; 6c
comme de toutes les pompes funèbres mentionnées
dans l’hiftoire, aucune n’eft comparable à celles de
ce prince, nous en joindrons ici le précis d’après M.
"Rollin : on verra jufqu’où la vanité porta le luxe de
cet appareil lugubre.
Aridée frere naturel d’Alexandre, ayant été chargé
du foin de ce convoi, employa deux ans pour dif-
pofer tout ce qui pouvoit le rendre le plus riche 6c le
plus éclatant qu’on eût encore vû. La marche fut pré-^
cédée par un grand nombre de pionniers, afin de rendre
pratiquables les chemins par où l’on devoit paf-
fer. Après qu’ils eurent été applanis, on vit partir
de Babylone le magnifique chariot fur lequel étoit
le corps d’Alexandre. L’invention & le deffein de ce
chariot fe faifoient autant admirer, que les richeffes
immenfes que l’on y découvroit. Le corps de la machine
portoit fur deux effieux qiii entroient dans
quatre roues, dont les moyeux 6c les rayons étoient
dorés, & les jantes revêtues de fer. Les extrémités
des effieux étoient d’oryrepréfentant des mufles de
lions qui mordoient un dard. Le chariot avoit quatre
timons, 6c à chaque timon étoient attelés feize
mulets, qui formoient quatre rangs : c’étoit en tout
feize rangs & foixante-quatre mulets. On avoit choifi
les plus Forts 6c de la plus haute taille ; ils avoient
des couronnes d’or 6c des colliers enrichis de pierres
précieufes , avec des fonnettes d?or. Sur ce chariot
s’élevoit un pavillon d’or maflif, qui avoit douze
piés de large fur dix - huit de long , foûtenu par des
colonnes d’ordre ionique, embellies de feuilles d’acanthe.
Il étoit orné au-dedans de pierres précieufe
s , difpofées en forme d’écailles. Tout autour ré-
gnoit une frange d’or à réfeau, dont les filets avoient
un doigt d’épaiffeur, où étoient attachées de groffes
fonnettes, qui fe faifoient entendre de fort loin.
Dans la décoration du dehors, on voyoit quatre
bas-reliefs. Le premier repréfentoit Alexandre affis
dans un char, 6c tenant à la main un feeptre environné
d’un côté d’une troupe de Macédoniens, &
de l’autre d’une pareille troupe de Perfans, tous armés
à leur maniéré. Devant eux marchoient les
écuyers du roi. Dans le fécond bas-relief bn voyoit
des éléphans harnachés de toutes pièces , portant
fur le devant des Indiens, 6c fur le derrière des Macédoniens
,• armés comme dans un jour d’aûion.
Dans, le troifieme étoient repréfentés des efeadrons
de cavalerie en ordre de bataille. Le quatrième montrait
des vaiffeaux tous prêts à combattre. A l’en-
tree de ce pavillon étoient des lions d’or qui fem-
bloient le garder. Aux quatre coins étoient pofées
des ftatues d’or maflif repréfentant des vi&oires ,
avec des trophées d’armes à la main. Sous ce dernier
pavillon on avoit placé un throne d’or d’une figure
quarree, orne de têtes d’animaux, qui avoient fous
leur cou des cercles d’or d’un pié 6c demi de largeur,
d ’où pendaient des couronnes brillantes des plus vi-
Tome V il.
ves couleurs, telles qu’on en portoit dans les pompes
facrées.
Au* pié de ce throne étoit pofé le cercueil d’Alexandre,
tout d’or 6c travaillé au marteau. On l ’a-
voit rempli à demi d’aromates & de parfums, tant
afin qu il exhalat une bonne odeur, que pour la con-
cadavre. Il y avoit fur ce cercueil une
étoffé de pourpre brochée d’or : entre le throne 6c le
cercueil, étoient les armes du prince, telles qu’il les
portoit pendant fa vie. Le pavillon en-dehors étoit
auffi couvert d’une étoffe de pourpre à fleurs d’or ;
le haut étoit terminé par une très-grande couronne
d’o r , compofée comme de branches d’olivier.
On conçoit aifément que dans une longue mar-
che, le mouvement d’un chariot auffi lourd que celui
ci, devoit être fujet à de grands inconvéniens.
Afin donc que le pavillon & tous fes accompagne-
mens, foit que le chariotdefeendît ou qu’il montât,
demeuraffent toujours dans la même fituation, mal-
1 inégalité des lieux & les violentes fecOuffes
qi,i.en etoient infeparables ; du milieu de chacun des
deux effieux s’élevoit un axe qui foûtenoit le milieu
du pavillon, & tenoit toute la machine en état.
Le corps d Alexandre, fuivant les dernieres dif-
pofitions de ce prince, devoit être porté au temple
de Jupiter Ammon ; mais Ptolemée gouverneur d’Egypte
, le fît conduire à Alexandrie, où il fut inhumé.
Ce prince lui érigea un temple magnifique, 6c
lui rendit tous les honneurs que l’antiquité payenne
avoit coutume de rendre aux demi-dieux. On ne
voit plus aujourd’hui que les ruines de ce temple.
Funérailles des Romains. Les Romains ont été
fans contredit un des peuples les plus religieux & les
plus exaéls à rendre les derniers devoirs à leursparens
& à leurs amis. On fait qu’ils n’oublioient rien de ce
qui pouvoit marquer combien la mémoire leur en étoit
chere, 6c de ce qui pouvoit en même tems contribuer
Jl la rendre precieufe. C ’étoit auffi quelquefois un
hommage qu’on accordoit à la vertu, pour exciter
dans les citoyens la noble pafïïon de mériter un jour
de pareils honneurs. En un mot, Pline dit que les-
funérailles chez les Romains étoient une cérémonie
facrée : les détails en font fort étendus.
Elle commençoit cette cérémonie facréfe dès le
moment que la perfonne fe mouroit. Il falloit- dans
cetinftant que le plus proche parent, & fi c’étoitdes
gens mariés, que le furvivant du mari ou de la femme
donnât au mourant le dernier baifer comme pour
en recevoir l’ame, 6c qu’il lui fermât les yeux. On
les lui ouvroit lorfqu’il étoit fur le bûcher, afin qu’il
parût regarder le ciel. On obfervoit en lui fermant
les yeux de lui fermer la bouche, pour le rendre5
moins effrayant & le faire paroître comme une perfonne
dormante. On ôtoit l ’anneau du doigt du défunt
, qu’on lui remettoit lorfqu’on portoit le corps'
fur le bûcher. On l’appelloit plufieurs fois par fon
nom à haute v o ix , pour connoître s’il étoit véritablement
mort, ou feulement tombé en léthargie. On
nommoit cet ufage conclamatio , conclamation • 6c
fuivant l’explication qu’un célébré antiquaire a don-»
née d’un bas-relief, qui eft au Louvre dans la falle
des antiques , on ne fe contentoit pas de la fimple
voix pour les perfonnes de qualité, on y employoit
le fon des buccines & des trompettes, ainfi qu’ori
peut juger par ce bas - relief. L’on y voit des gens
qui fonnent de la trompette près du corps d’une perfonne
qui paroît venir de rendre les derniers foupirs^
6c que, félon qu’on peut conje&urer par les apprêts
qui y font repréfentes, on va mettre entre les mains
des libitinaires ; les fons bruyans de ces inftrumenS
frappant les organes d’une maniéré beaucoup plus
. éclatante que la vo ix , donnoient des preuves plus
certaines que la perfonne étoit véritablement morte.
Enfuite on s’adreffoit aux libitinaires pour procès
A a a