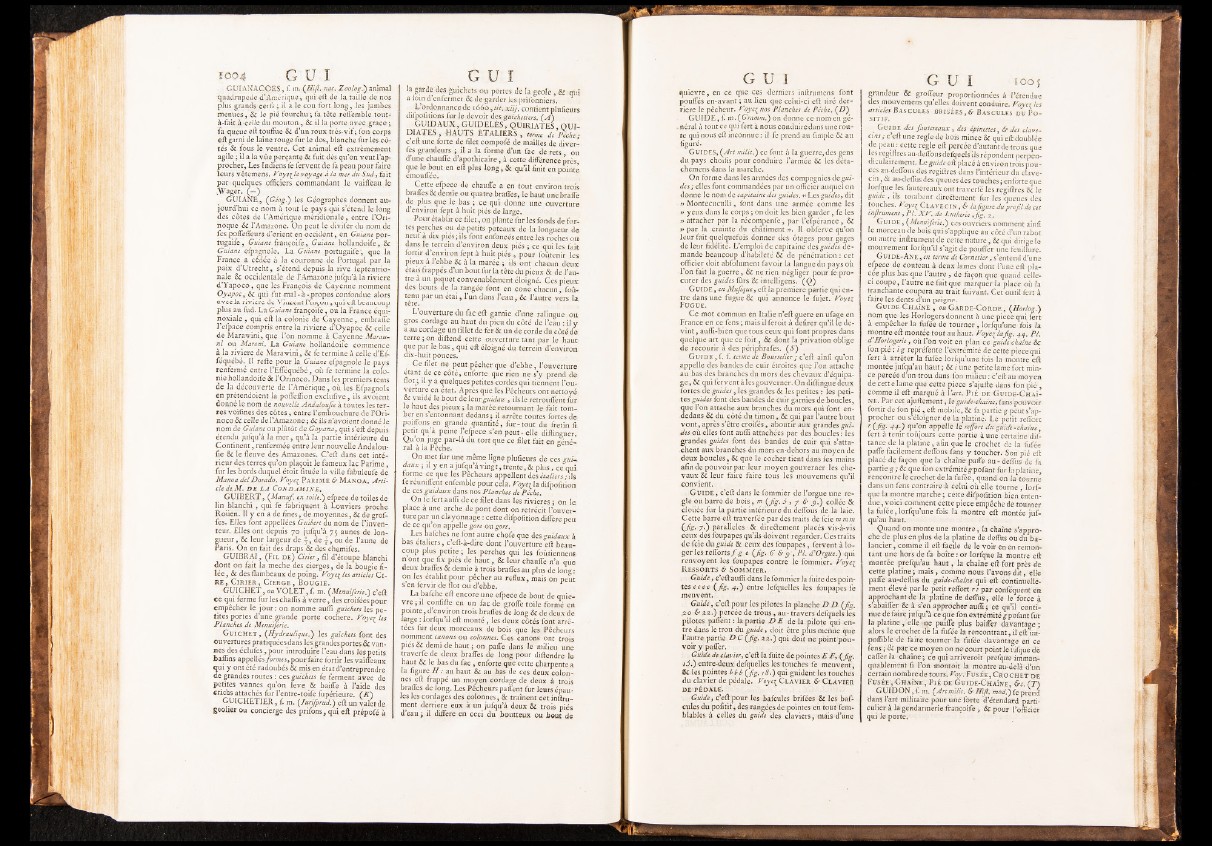
GUIANAGOES , f. m.(Hifi.nat. Zoolog.) animal
quadrupède d’Amérique, qui eft de la taille de nos
plus grands cerfs ; il a le cou fort long, les jambes
menues, & le pié fourchu; fa tête reflemble tout-
à-fait à'celle du mouton^ &. il la porte avec ..grâce ;
ïa queue eft touffue & d’un roux très-vif ; fbn corps
eft garni de laine rouge fur le dos, blanche fur les cô?
tés & fous le ventre. Cet animal eft extrêmement
agile ; il a la vue. perçante & fuit dès qu’on veut l ’approcher,
Les Indiens fe fervent de fa peau pour faire
leurs vêtemens. Voye^ le voyage-à La mer du Sud-, fait
par quelques officiers commandant le vaifîeau le
vWager. (—)
GUI ANE, (Géogî) les Géographes donnent aujourd’hui
ce nom à tout le pays qui s’étend le long
des côtes de l’Amérique méridionale, entre l’Ori-
noque & l’Amazone. On peut le divifer du nom de
fes poffeffeurs d’orient en occident, en Guiane por-
tugaife, Guiane françoife, Guiane hollandoife, &
Guiane efpagnole. La Guiane portugaifè', que la
France a cédée à la couronne de Portugal par la
paix d’Utrecht, s’étend depuis la rive feptentrio-
nale & occidentale de l’Amazone jufqu’à la riviere
d’Y apoco, que les François de Cayenne nomment
Oyapoc, & qui fut mal - à-propos confondue alors
avec la riviere de Vincent Pinçon, qui eft beaucoup
plus au fud. La Guiane françoife, ou la France équinoxiale
, qui eft la colonie de Cayenne, embraffe
l ’efpace compris entre la riviere d’Oyapoc & celle
de Marawini, que l’on nomme à Cayenne Marau-
ni ou Maroni. La Guiane hollandoife commence
à la riviere de Marawini, & fe termine à celle d’Ef-
féquébé. Il relie pour la Guiane efpagnole le pays
renfermé entre l’Efféquébé, où fe termine la colonie
hollandoife & l’Orinoco. Dans les premiers tems
de la découverte de l’Amérique, où les Efpagnols
en prétendoient la polfeffion exclufive, ils avoient
donné le nom de nouvelle Andaloufie à toutes les terres
voifmes des côtes, entre l’ embouchure de l’Ori-
noco & celle de l’Amazone ; & ils n’avoient donné le
nom de Guiane ou plutôt de Goyana, qui s’eft depuis
étendu jufqu’à la mer, qu’à la partie intérieure du
Continent, renfermée entre leur nouvelle Andalou-
lie & le fleuve des Amazones. C ’eft dans cet intérieur
des terres qu’on plaçoit le fameux lac Parime,
fur les bords duquel étoit fituée la ville fabuleufe de
Manoa del D or ado. V oyeç. Parime & MANOA. Article
de, M. D E LA Cou D AMINE.
GUIBERT, (Manuf. en toile.) efpece de toiles de
lin blanchi , qui fe fabriquent à Louviers proche
Roiien. Il y en a de fines, de moyennes, & de grof-
fes. Elles font appellées Guibert du nom de l’inventeur.
Elles ont depuis 70 jufqu’à 75 aunes de longueur
, & leur largeur de f , de f , ou de l’aune de
Paris. On en fait des draps & des chemifes.
GUIBR A I , (Fil de) Cirier , fil d’étoupe blanchi
dont on fait la meche des cierges, de la bougie filée
, & des flambeaux de poing. Voye^ les articles Cl-
r e , C ir ie r , Cie r g e , Bo u g ie .
GUICHET, ou VOLE T , f. m. (Menuiferie.) c’eft
ce qui ferme fur les chaffis à verre, des croifées pour
empêcher le jour : on nomme auffi guichets les petites
portes d’une grande porte cochere. Voyeç les
Planches de Menuiferie.
Gu ich e t , (Hydraulique.) les guichets font des
ouvertures pratiquées dans les grandes portes & vannes
des éclufes, pour introduire l’eau dans les petits
baffins appellésyô/vrcw, pour faire fortir les vaiffeaux
qui y ont été radoubés & mis en état d’entreprendre
ae grandes routes : ces guichets fe ferment avec de
petites vannes qu’on leve & baiffe à l’aide des
crichs attachés fur l’entre-toife fupérieure. (E )
GUICHETIER, f. m. (Jurifprud.) eft un valet?de
geôlier ou concierge des prifons, qui eft prépofé à
la gardé des guichets ou portes de la geôle , & qui
a foin d’enfermer & de garder les prilonniers.
L Ordonnance de i66o,wV. xüj. contient plufieurs
difpofitions fur le devoir des guichetiers (A )
GUIDAUX, GUIDELÉS, QUIRIATES, OUG
DIATES, HAUTS ÉTALIERS , terme de Pêche;
c’eft une forte de filet compofé de mailles de diver-
fes grandeurs ; il a la forme d’un fac de rets , ou
d’une chauffe d’apothicaire, à cette différence près,
<jue le bout en eft plus long, & qu’il finit en pointe
emouffée.
Cette efpece de chauffe a en tout environ trois
braffes & demie ou quatre braffes, le haut unebraffe
. de plus que le bas ; ce qui donne une ouverture
d’environ fept à huit piés de large.
Pour établir ce filet, on plante fur les fonds de fortes
perches ou de petits poteaux de la longueur de
neuf a dix pies; ils font enfoncés entre les roches ou
dans le terrein d’environ deux piés ; ce qui les fait
fortir d ’environ fept à huit piés , pour foûtenir les
pieux à l’ebbe & à la marée ; ils ont chacun deux
étais frappés d’un bout fur la tête du pieux & de l’autre
à un piquet convenablement éloigné. Ces pieux
des bouts de la rangée font en cône chacun, foû-
tenu par un etai, l’un dans l’eau, & l’autre vers la
tête.
L’ouverture du fac eft garnie d’une ralingue ou
gros cordage au haut du pieu du côté de l’eau : il y
a au cordage un tilletdefer& un de corde du côté de
terre ; on diftend cette ouverture tant par le haut
que par le bas, qui eft éloigné du terrein d’environ
dix-huit pouces.
Ce filet ne peut pêcher que d’ebbe, l’ouverture
étant de ce cote, enforte que rien ne s’y prend de
flot^; il y a quelques petites cordés qui tiennent l’ouverture
en état. Après que les Pêcheurs ont nettoyé.
& vuide le bout de leur guidau , ils le retroufîent fur
le haut des pieux ; la marée retournant le fait tomber
en s’entonnant dedans ; il arrête toutes fortes de
poiffons en grande quantité, fur-tout du fretin ü.
petit qu’à peine I’efpece s’en peut - elle diftinguer.
Qu’on juge par-là du tort que ce filet fait en général
à la Pêche.
On met fur une même ligne plufieurs de ces gui-
daux ; il y en a jufqu’à vingt, trente, & plus, ce.qui
forme ce que les Pêcheurs appellent des étaliers/ils
fe réunifient enfemble pour cela. Voye^la difpofition
de ces guidaux dans nos Planches de Pêche.
On le fert auffi de ce filet dans les rivières ; on le
place à une arche.de pont dont on rétrécit l’ouverture
par un clayonnage : cette difpofition diffère peu
de ce qu’on appelle gore ou gort.
Les bafehes ne font autre chofe que des guidaux à
bas étaliers, c’eft-à-dire dont l’ouverture eft beaucoup
plus petite ; les perches qui les foûtiennent
n’ont que fix piés de haut, & leur chauffe n’a que
deux braffes & demie à trois braffes au plus de long:
on les établit pour pêcher au reflux, mais on peut
s’en fervir de flot ou d’ebbe.
La bafehe eft encore une efpece de bout de quie-
vre ; il confifte en un fac de groffe toile formé en
pointe, d’environ trois braffes de long & de deux de
large : lorfqu’il eft monté, les deux côtés font arrêtées
fur deux morceaux de bois que les Pêcheurs
nomment canons ou colonnes. Ces canons ont trois
pies & demi de haut ; on paffe dans le milieu une
traverfe de deux braffes de long pour diftendre le
haut & le bas du fa c , enforte que cette charpente a
la figure H : au haut & au bas de ces deux colonnes
eft frappé un moyen cordage de deux à trois
braffes de long. Les Pêcheurs paffent fur leurs épaules
les cordages des colonnes, & traînent cet infiniment
derrière eux à un jufqu’à deux & trois piés
d’eau ; il différé en ceci du boutteux ou bout de
quievre, en çe que ces derniers inftrumens font
pouffés en-avant ; au lieu que celui-ci eft tiré derrière
le pêcheur. Voyx^ nos -Planches de Pêche. (D )
GUIDE, f. m. ( Gramm.) on donne ce nom en gé-
. néral à tout ce qui fert à nous conduire dans une route
qui nous eft inconnue : il fe prend au fimple & au
figuré.
G u id e s , (Art milit.) ce font à la guerre, des gens
du pays choifis pour conduire l’armée & les déta-
chemens dans la marche.
On forme dans les armées des compagnies de guides;
elles font commandées par un officier auquel on
. donne lé nom de capitaine des guides. « Les guides, dit
» Montecuculli, font dans une armée comme les
» yeux dans le corps ; on doit les bien garder, fe les
» attacher par la réçompenfe, par l’efpérance, &
» par la crainte du châtiment ». Il obferve qu’on
leur fait quelquefois donner des otages pour gages
de leur fidélité. L’emploi de capitaine des guides demande
beaucoup d’habileté & de pénétration : cet
officier doit abfolument favoir la langue du pays où
• l’on fait la guerre, & ne rien négliger pour fe procurer
des guides fûrs & intelligens. (Q)
G u ide , en Mujique, eft la première partie qui entre
dans une fugue & qui annonce le lùjet. V o y e ^
F u g u e .
Ce mot commun en Italie n’eft guere en ufage en
France en ce fens ; mais il feroit à defirer qu’il le devînt
, auffi-bien que tous ceux qui font propres dans
quelque art que ce fo it , & dont la privation oblige
de recourir à des périphrafes. (S)
G u i d e , f. f. terme de Bourrelier ; c’eft ainfi qu’on
appelle des bandes.de cuir étroites que l’on attache
au bas des branches du mors des chevaux d’équipag
e , & qui fervent àdes gouverner. On diftingue deux
fortes de guides, les grandes & les petites : les petites
guides font des bandes de cuir garnies de boucles,
que l’on attache aux branches du mors qui font en-
dedans & du côté du timon, & qui par l’autre bout
von t, après s’être croifés, aboutir aux grandes guides
où elles font auffi attachées par des boucles : les
grandes guides font des bandes de cuir qui s’atta-
chent aux branches du mors en-dehors au moyen de
deux boucles, & que le cocher tient dans fes mains
afin de pouvoir par leur moyen gouverner les chevaux
& leur faire faire tous les mouvemens qu’il
convient.
* G u id e , c’eft dans le fommier de l’orgue une réglé
ou barre de bois, m (fig. 5 , y & c>.) collée &
cloiiée fur la partie intérieure du deffous de la laie.
Cette barre eft traverfée par des traits de feie m mm
(.fig. 7 .) parallèles & directement placés vis-à-vis
ceux des foupapes qu’ils doivent regarder. Ces traits
de feie du guide & ceux dçs foupapes, fervent à loger
les refforts ƒ g e (fig. G & cy f PI. d'Orgue.) qui
renvoyent les foupapes contre le fommier. Voye^
R e s s o r t s & S o m m ie r .
Guide, c ’eft auffi dans le fommier la fuite des pointes
cce-c (fig. 4 .) entre lefquelles les foupapes fe
meuverit. ‘
Guidé., .c’eft pour les pilotes la planche D D.. (fig.
p . o & z z . ) percée de t ro u s , au-tra v er s defquels les
pilotes pafiënt : la partie D E de la pilote qui entre
dans le trou du guide , doit être plus menue que
l’autre partie D Ç (fig. 22.) qui doit ne point pôu -
v o ir y paffer.
Guide de davier, c’eft la fuite de pointes E F , (fia.
i S . ) entre-deux defqùelles les touches fe meuvent,
& les pointes b b b. (fig. 18.) qui guident les touches
du clav ier de pédale. V o y e { C l a v ie r & C tA v iE R
DE PÉDALE;.
Guide, c’eft pour les bafcules brifées & les b a s cules
du po fitif, des rangées de pointes en tout fem-
blables à celles du guide de? c lav ie rs , mais d’une
grandeur & groffeur proportionnées à l’étendue
des mouvemens qu’elles doivent conduire. Voyelles
articles BASCULES .BRISÉES,# BASCULES DU POSITIF.
G u id e des fautereaux, des épinettes, & des clavecins;
c’eft une réglé de bois mince & qui eft doublée
de peau: cette réglé eft percée d’autant de trous que
les regiftres au-deffoiis defquels ils répondent perpendiculairement.
Le guide eft placé à environ trois pouces
au-deffous des regiftres dans l’intérieur du clave-
cin, Ô£ au-deffus des queues des touches; enforte que
lorfque les faùtéreaux ont traverfé les regiftres & le
guide , ils tombent dire&ement fur les queues des
touches. Vyye{ C l a v e c in , & la figure du profil de cet
infiniment, Pl. XV. de Lutherie , fig. 2 . •>
G u id e , (Menuiferie.) ces ouvriers nomment ainfi
le morceau de bois qui s’applique au côté d’un rabot
ou autre infiniment de certe nature, & qui dirige le
mouvement lôrfqu’il s’agit de pouffer une feuillure.
G u id e -A ne , en terme de Cornetier, s’entend d’une
efpece de couteau à deux lames dont l’une eft placée
plus bas que l’autre, de façon que quand celle-
ci coupe, l’autre ne fait que marquer la place où la
tranchante coupera au trait fuivant. Cet outil fert à
faire les dents d’un peigne.
G u id e C h a în e , ou G a r d e -C o r d e , (Horlog.)
nom que les Horlogers donnent à une piece qui fert
à empêcher la fufée de tourner , lorfqu’une fois la
montre eft montée tout au haut. Voye^ la fig. 44. PL.
d'Horlogerie, où l’on voit en plan ce guide chaîne &
fon pié : ig repréfente l’extrémité de cette piece qui
fert à arrêter la fufée lorfqu’une fois la montre eft
montée jufqu’au haut ; & i une petite lame fort mince
percée d’un trou dans fon milieu : c’eft au moyen
de cette lame que cette piece s’ajufte dans fon pié ,
comme il eft marqué à l'art. Pié de G u id e -C h a î n
e . Par cet ajuftement, le guide-chaîne, fans'potivoir
fortir de fon pié , eft mobile, & fa partie g peut s’approcher
ou s’éloigner de la platine. Le petit reffort
r (fig- 44■ ) qu’on appelle le refort du guide-chaîne,
fert à tenir toujours cette partie à une certaine dif-
tance de la platine, afin que le crochet de la fufée
paffe facilement deffous fans y toucher. Son pié eft
placé de façon que la chaîne paffe au - deffus de fa
partie g;tte que fon extrémité#pofant fur la platine,
rencontre le crochet de la fufée, quand.on la-tourne
dans un fens contraire à celui où elle tourne , lorf-
que la montre marche ; cette difpofition bien entendue
, voici comment cette piece empêche de tourner
la fufée, lorfqu’une fois la montre eft montée jusqu’au
haut.
Quand on monte une montre, la chaîne s’approche
de plus en plus de la platine de deffus ou du balancier,
comme il eft facile de le voir en en remontant
une hors de fa boîte : or lorfque la montre eft
montée prefqu?au haut, la chaîne eft fort près de
cette platine ; mais, comme nous l’avons dit, elle
paffe au-deffus du -guide.chaîne qui eft continuellement
élevé parle petit reffort r: par conféquent eh
approchant de la platine de deffus, elle le force à
s’abaiffer & à s’en approcher auffi ; ce qu’il continue
défaire jufqu’à ce que fon extrémité g-pofant fur
la platine , elle «ne puiffe plus baiffer davantage ;
alors le crochet de la fufée la rencontrant, il eft im-
poffiblè de faire tourner la fufée davantage eh ce
fens ; & par ce moyen on ne court point le rifque dè
caffer la chaîne ; ce qui arriveroit prefqüe immanquablement
fi l’on montôit la montre au-delà d’un
certain nombre de tours. Poy. Fvsik., C r o c h e t d e
F u s é e , C h a în e , P ié ç e G u id e -C h a în e , &c. (T)
GUIDON , f. m. (Art milit. &■ Hifi. mod.) fe prend
dans l’art militaire pour une forte d’étendard particulier
à la gendarmerie françoife , & pour l’officier
qui le porte,