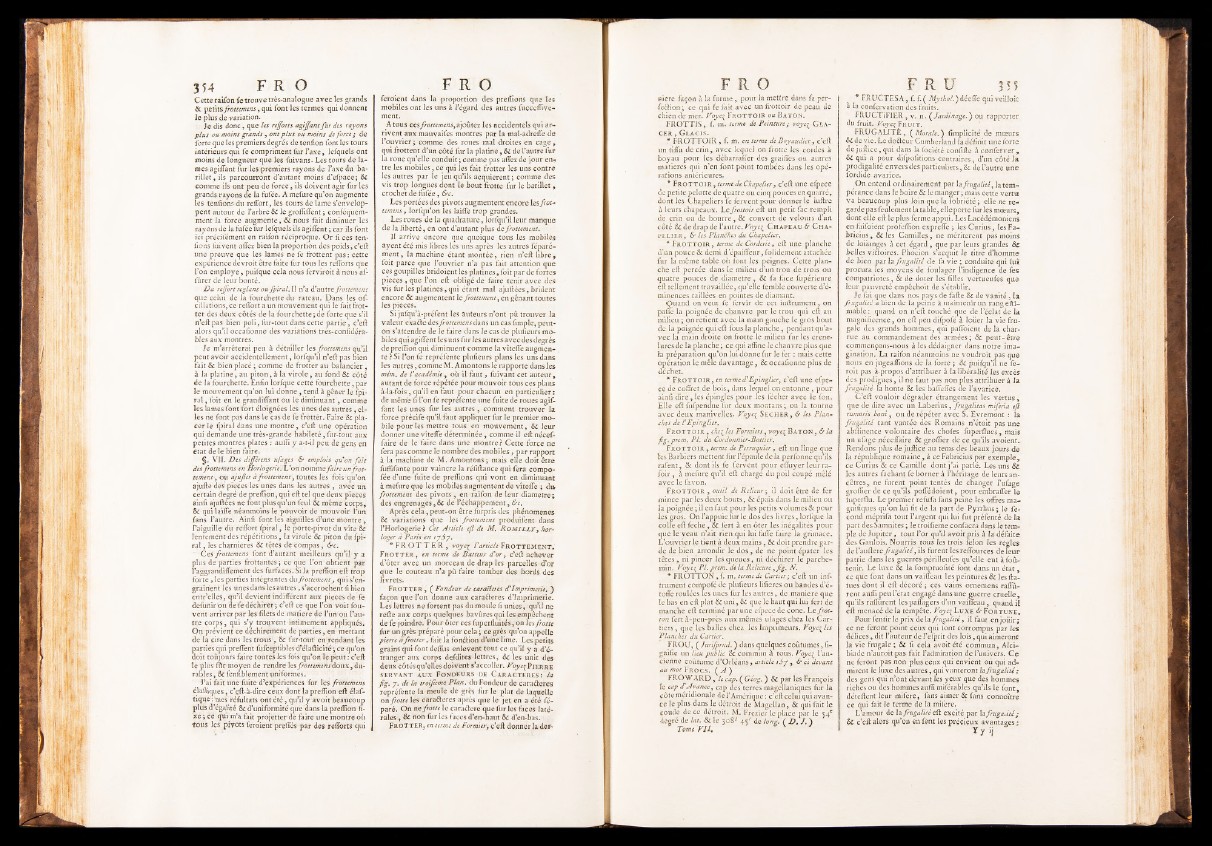
Cette raifon fe trouve très-analogue avec les grands
& petits frottemens, qui font les termes qui donnent
le plus de variation.
Je dis donc, que les rejjorts agijfant fur des rayons
plus ou moins grands , ont plus ou moins de force; de
forte que les premiers degrés de tenfion font les tours
intérieurs qui fe compriment fur l’axe, lefquels ont
moins de longueur que les fuivans. Les tours de lames
agiffant fur: les premiers rayons de l’axe du barillet,
ils parcourront d’autant moins d’efpace; Si
comme ils ont peu de force, ils doivent agir fur les
grands rayons de la fufée. A mefure qu’on augmente
les tendons du relïort, les tours de lame s’enveloppent
autour de l’arbre Si le groffiffent ; conféquem-
ment la force augmente, Si nous fait diminuer les
rayons de la fuféelùr lefquels ils agilfent ; car ils font
ici précifément en raifon réciproque. Or fi ces tendons
fui vent affez bien la proportion des poids, c’eft
une preuve que les lames ne fe frottent pas : cette
expérience devroit être faite fur tous les refforts que
l’on employé, puifque cela nous ferviroit à nous af-
fûrer de leur bonté.
Du rejfort réglant ou fpiral. Il n’a d’autre frottement
que celui de la fourchette du rateau. Dans les of-
dilations, ce reffort a un mouvement qui le fait frotter
des deux côtés de la fourchette ; de forte que s’il
n’eft pas bien poli, fur-tout dans cette partie, c’efl
alors qu’il occafionne des variations très-confidéra-
bles aux montres.
Je m’arrêterai peu à détailler les frottemens qu’il
peut avoir accidentellement, lorfqu’il n’eft pas bien
fait & bien placé ; comme de frotter au balancier,
à la platine, au piton, à la v irole, au fond Si côté
de la fourchette. Enfin lorfque cette fourchette, par
le mouvement qu’on lui donne , tend à gêner le fpiral
, foit en le grandiffant ou le diminuant, comme
les lames font fort éloignées les unes des autres , elles
ne font pas dans lé cas de fe frottér. Faire Si placer
le fpiral dans une montre, c’efl une opération
qui demande une très-grande habileté, fur-tout aux
petites montres plates : aufîi y a-t-il peu de gens en
état de le bien faire.
§ . VII. Des différens ufages & emplois qu'on fait
des frottemens en Horlogerie. L ’on nomme faire unfrot-
tertient-, où àjujler à frottement; toutes lès fois'qu?on
ajufte des pièces les unes dans les autres , avec un
certain degré de preffion, qui efl tel que deux pièces
ainfi ajuftées ne font plus qu’un feul Si même corps,
Si qui laiffe néanmoins le pouvoir de mouvoir l’un
fans l’autre. Àinfi font les aiguilles d’une montre,
l’aiguille du reffort fpiral, le porte-pivot du vite Sc
lentement des répétitions, la virole & piton du fpiral
, les charnières Si têtes de compas, &c.
“ Ces frottemens font d’autant meilleurs qu’il y a
plus de parties frottantes ; ce que l’on obtient par
î’aggrandiffement des furfaces. Si la preffion eft trop
forte , les parties intégrantes du frottementqùls’en-
grainent les unes dans les autres, s’accrochent fi bien
entr’elles, qu'il devient indifférent aux pièces de fe
defunir ou de fe déchirer ; c’efl cè que l’on voit fou-
vent arriver par les filets de matière de l’un ou l’autre
corps, qui s’y trouvent -intimement appliqués.
On prévient ce déchirement de parties, en mettant
de la cire dans les trous , Si fur-tout* entendant les
parties qui preffent fufceptibles d'élafticité ; ce qu’on
doit toujours faire toutes les fois qu’on le peut : c’efl
le plus fûr moyen de rendre les froetemehsdonx, durables,
Si fenfiblement uniformes.
J'ai fait tinè fuite d’expériences fur les frottemens
elaftiques, c’gft-à-dire ceux dont la preffion efl élaf-
tiqqe’: mes réfqltats ont été, qu’il y avoit beaucoup
plus d’égalité & d’uniformité que dans la preffion fixe
; ce qui m’a fait prôjetter de faire une montre oii
tous les pivots feroient preffés par des refforts qui
feroient dans la proportion des preffions que les
mobiles ont les uns à l’égard des autres fucceffive-
ment.
A tous ces frottemens, ajoutez les accidentels qui arrivent
aux mauvaifes montres par la mal-adrefl’e de
l’ouvrier ; comme des roues mal droites en cage,
qui frottent d’un côté fur la platine, & de l’autre fur
la roue qu’elle conduit ; comme pas affez de jour eni
tre les mobiles-, ce qui les fait frotter les uns contre
les autres par le jeu qu’ils acquièrent ; comme des
vis trop longues dont le bout frotte fur le barillet,
crochet de fufée, &c.
Les portées des pivots augmentent encore les frottemens
, lorfqu’on les laiffe trop grandes.
Les roues de la quadrature, lorfqu’il leur manque
de la liberté, en ont d’autant plus de frottement.
Il arrive encore que quoique tous les mobiles
ayent été mis libres les uns après les autres féparé-
ment, la machine étant montée, rien n’efl libre ,
foit parce que l’ouvrier n’a pas fait attention que
ces goupilles bridoient les platines, foit par de fortes
pièces, que l’on efl obligé de faire tenir avec des
vis fur les platines, qui étant mal ajuftées, brident
encore Si augmentent le frottement, en gênant toutes
les pièces.
Si jufqu’à-préfent les auteurs n’ont pu trouver la
valeur exaâe des frottemens dans un cas fimple, peut-
on s’attendre de le faire dans le cas de plufieurs mobiles
qui agiffent les uns fur les autres avec des degrés
de preffion qui diminuent comme la vîteffe augmente
? Si l’on fe repréfente plufieurs plans les uns dans
les autres, comme M. Amontons le rapporte dans les
mcm, de Vacademie, oii il faut, fuivant cet auteur ,
autant de force répétée pour mouvoir tous ces plans
à-la-fois, qu’il en faut pour chacun en particulier :
de mêm'e fi l’on fe repréfente une fuite de roues agiffant
les unes fur les autres, comment trouver la
force précife qu’il faut appliquer fur le premier mobile
pour les mettre tous en mouvement, Si leur
donner une vîteffe déterminée, comme il eft nécefi-
faire de le faire dans une montre? Cette force ne
fera pas comme le nombre des mobiles , par rapport
à la machine de M. Amontons; mais elle doit être
fuffifante pour vaincre la réfiftance qui fera compo-
fée d’une fuite de preffions qui vont en diminuant
à mefure que les mobiles augmentent de vîteffe ; di»
frottement des pivots , en raifon de leur diamètre;
des engrenages,& de l’échappement, &c.
Après cela, peut-on être ftirpris des phénomènes
Si variations que les frottemens produifent dans
l’Horlogerie ? Cet Article efl de M. R o m i l l y , horloger
à Paris en i j 5j .
* F R Q T T E R , voye^ l'article Frottement.
Fro t t e r , en terme de Batteur d'or, c’eft achever
d’ôter avec un morceau de drap les parcelles d’or
que le couteau n’a pu faire tomber des bords des
livrets.
Frotter , ( Fondeur de caractères d'imprimerie. )
façon que l’on donne aux cara&eres d’imprimerie.
Les lettres ne fortent pas du moule fi unies, qu’il ne
refte aux corps quelques bavures qui les empêchent
de fe joindre. Pour ôter ces fuperfluités, on les frotte
fur un grès préparé pour cela ; ce grès qu’on appelle
pierre àfrotter, fait la fonction d’une lime. Les petits
grains qui font deffus enlevent tout ce qu’il y a d’étranger
aux corps defdites lettres, & les unit des
deux côtés qu’elles doivent s’aceoller. Voye[ Pierre
SERVANT AUX FONDEURS DE CARACTERES : la
fig, y. de la troifieme Plan, du Fondeur de caraéleres
repréfente la meule de grès fur le plat de laquelle
on frotte lés cara&eres après que le jet en a été fé-
paré. On ne frotte le caraélere que fur les faces latérales,
& non fur les faces d’en-haut Si d’en-bas. '
Frotter, en terme de Formier, c’eft donner la derniere
façon à la forme, pour la mettre dans fa perfection
; ce qui fe fait avec un frottoir de peau de
chien de mer. Voye^ Frottoir ou Bâton.
FROTTIS, f. m. terme de Peinture; voye£ GLACER
, Glacis.
f FROTTO IR, f. m. en terme de Boyaudier, c’eft
un tiffu de crin, avec lequel on frotte les cordes à
boyau pour les débarraffer des graiffes ou autres
matières qui n’en font point tombées dans les opérations
antérieures.
* Frottoir , terme de Chapelier, c’eft une efpece
de petite pelotte de quatre ou cinq pouces en quarré,
dont les Chapeliers fe fervent pour donner le luftre
à leurs chapeaux. Le frottoir eft un petit fac rempli
de crin ou de bourre, & couvert de velours d’un
côté Si de drap de l’autre. Voyeç Chapeau & Chapelier,
& les Planches du Chapelier.
* Frottoir , terme de Corderie, eft une planche
d’un pouce & demi d’épaiffeur, folidement attachée
fur la même table où font les peignes. Cette planche
eft percée dans le milieu d’un trou de trois ou
quatre pouces de diamètre, Si fa face fupérieure
eft tellement travaillée, qu’elle femble couverte d’éminences
taillées en pointes de diamant.
Quand on veut fe fervir de cet inftrument, on
paffe la poignée de chanvre par le trou qui eft au
milieu ; on retient avec la main gauche le gros bout
de la poignée qui eft fous la planche, pendant qu’avec
la main droite on frotte le milieu fur les crene-
Jures de la planche ; ce qui affine le chanvre plus que
la préparation qu’on lui donne fur le fer : mais cette
opération le mêle davantage, Si occafionne plus de
déchet.
* Frottoir, en termed?Epinglier, c’eft une efpece
de coffret de bois, dans lequel on entonne, pour
àinfi dire, les épingles pour les fécher avec le fon.
Elle eft fufpendue fur deux montans ; on la tourne
avec deux manivelles. Voye£ Secher, & les Planches
de V Epinglier.
Frottoir , che^ les Formiers, voye^ Bâton , & la
fig. prem. PI. du Cordonnier-Bottier.
Frottoir , terme de Perruquier, eft un linge que
tes Barbiers mettent fur l’épaule delà perfonne qu’ils
rafent, & dont ils fe fervent pour effuyer leur ra-
foir , à mefure qu’il eft chargé du poil coupé mêlé
avec le favon.
Frottoir , outil de Relieur ; il doit être de fer
mince par les deux bouts, Si épais dans le milieu ou
la poignée ; il en faut pour les petits volumes & pour
les gros. On l’appuie fur le dos des livres, lorfque la
colle eft feche, Si fert à en ôter les inégalités pour
que le veau n’ait rien qui lui fafi’e faire la grimace.
L ’ouvrier le tient à deux mains, Si doit prendre garde
de bien arrondir le dos, de ne point épater les
têtes , ni pincer les queues, ni déchirer le parchemin.
Voyei PI. prem. de la Relieure ,fig. N.
* FROTTON , f. m. terme de Cartier; c’eft un inftrument
compofé de plufieurs lifieres ou bandes d’étoffe
roulées les unes fur les autres, de maniéré que
îe bas en eft plat Si uni, Si que le haut qui lui fert de
manche eft terminé par une efpece de cône. Le frot-
ton fert à-peu-près aux mêmes ulages chez les Car-
tiers , que les balles chez les Imprimeurs. Voye{ les
Planches du Cartier.
FROU, ( Jurifprud. ) dans quelques coutumes, lignifie
un lieu public Si commun à tous. Voyeç l’ancienne
coutume d’Orléans, article i5y , & ci devant
au mot Frocs. ( A )
FROWARD, le cap. ( Géog. ) Si par les François
le cap crAvance, cap des terres magellaniques fur la
côte méridionale de l’Amérique : c’eft celui qui avance
le plus dans le détroit de Magellan, & qui fait le
coude de ce détroit. M. Frezier le place par le 54e
degré de lat. Si le 3o8d 45' de long. ( D , J. )
Tome VII, v
* FRUCTESA, f. f. ( Mytkol.") déeffe qui veilloit
a la confervation des fruits.
FRUCTIFIER, v. n. ( Jardinage.) o u r a p p o r te r
d u fru it. Voye{ F r u i t .
FRUGALITÉ , ( Morale. ) fimplicité de moeurs
ôede vie. Le dofteur Cumberland la définit une forte
de juftice, qui dans la fociété confifte à conferver ,
Si qui a pour difpofitions contraires, d’un côté la
prodigalité envers des particuliers, Si de l’autre une
fordide avarice.
On entend ordinairement par la frugalité, la tempérance
dans le boire Si le manger; mais cette vertu
va beaucoup plus loin que la fobriété; elle ne regarde
pas feulement la table, elle porte fur les moeurs,
dont elle eft le plus ferme appui. Les Lacédémoniens
en faifoient profeffion expreffe ; les Curius, lesFa-
bricius, & les Camille^, ne méritèrent pas moins
de louanges à cet égard, que par leurs grandes Sc
belles viéloires. Phocion s’acquit le titre d’homme
de bien par la frugalité de fa vie ; conduite qui lui
procura les moyens de foulager l’indigence de fes
compatriotes, & de doter les filles vertueufes que
leur pauvreté empêchoit de s’établir.
Je fai que dans nos pays de fafte Si de vanité, la
frugalité a bien de la peine à maintenir un rangefti-
mable.: quand on n’eft touché que de l’éclat de la
magnificence, on eft peu difpofé à Ioiier la vie frugale
des grands hommes, qui paffoient delà charrue
au commandement des armées; Si peut-être
commençons-nous à les dédaigner dans notre imagination.
La raifon néanmoins ne voudroit pas que
nous en jugeaffions de la forte ; Si puifqu’il ne fe-
roit pas à-propos d’attribuer à la libéralité les excès
des prodigues, il ne faut pas non plus attribuer à la
frugalité la honte Si les baffeffes de l’avarice.
C ’eft vouloir dégrader étrangement les vertus ,
que de dire avec un Laberius, frugalitas miferia ejl
rumoris boni, ou de répéter avec S. Evremont : la
frugalité tant vantée des Romains n’étoit pas une
abftinence volontaire des choies fuperflues, mais
un ufage néceffaire Si groffier de ce qu’ils avoient.
Rendons plus de juftice au tems des beaux jours de
la république romaine, à ce Fabricius par exemple,
ce Curius & ce Camille dont j’ai parlé. Les uns Sc
les autres fachant fe borner à l’héritage de leurs ancêtres,
ne furent point tentés de changer l’ufage
groffier de ce qu’ils poffédoient, pour embraffer le
fuperflu. Le premier refufa fans peine les offres magnifiques
qu’on lui fit de la part de Pyrrhus ; le fécond
méprifa tout l’argent qui lui fut préfenté de la
part desSamnites ; le troifieme confacra dans le temple
de Jupiter, tout l ’or qu’il avoit pris à la défaite
des Gaulois. Nourris tous les trois félon les réglés
de l’auftere frugalité, ils furent les reflources de leur
patrie dans les guerres périlleufes qu’elle eut à foû-
tenir. Le luxe Si la fomptuofité font dans un état,
ce que font dans un vaiffeau les peintures Si les fta-
tues dont il eft décoré ; ces vains ornemens raffû-
rent auffi peu l’état engagé dans une guerre cruelle ,
qu’ils raffûrent les paflagers d’un vaiffeau, quand il
eft menacé de la tempête. Voye[ L u x e & F o r t u n e .
Pourfentirle prix delà frugalité, il faut en joiiir;
ce ne feront point ceux qui font corrompus par les
délices, dit l’auteur de l’efprit des lois, qui aimeront
la vie frugale ; Sc fi cela avoit été commun, Alcibiade
n’auroit pas fait l’admiration de l’iinivers. Ce
ne ferpnt pas non plus ceux qui envient où qui admirent
le luxe des autres, qui vanteront la frugalité:
des gens qui n’ont devant les yeux que des hommes
riches ou des hommes auffi miférables qu’ils le font,
détellent leur mifere, fans aimer & fans connoître
ce qui fait le terme de la mifere.
L ’amour de la frugalité eft excité par la frugaàté;
Si c’eft alors qu’on en fent les précieux avantages :
Y y ij